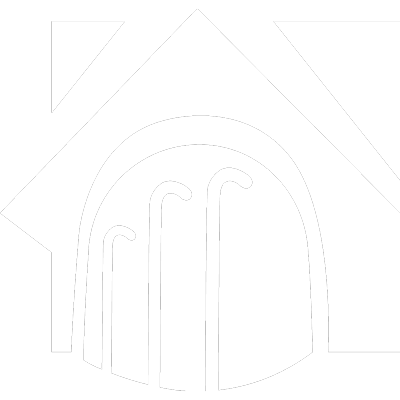I) Introduction
Depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit de la protection de l’adulte, le mandat pour cause d’inaptitude est devenu un outil essentiel du droit suisse, permettant à toute personne majeure et capable de discernement d’organiser à l’avance sa protection juridique en cas de perte future de discernement.
Ce dispositif vise à renforcer l’autonomie individuelle en offrant la possibilité de désigner un ou plusieurs mandataires chargés de représenter la personne concernée dans ses affaires personnelles, patrimoniales ou juridiques. Ce mécanisme se distingue du régime de curatelle en ce qu’il repose sur une démarche volontaire et anticipée du mandant, tout en restant encadré par l’Autorité de protection de l’adulte (APEA), qui veille à sa mise en œuvre effective et à sa conformité avec les intérêts du mandant.
Dans cette perspective, la gestion du patrimoine occupe une place centrale. En l’absence de normes spécifiques applicables aux mandataires désignés par un mandat pour cause d’inaptitude, plusieurs questions se posent quant aux obligations, limites et responsabilités liées à cette fonction, notamment en matière de stratégie de placement, de préservation des avoirs et de gestion des risques.
Cette problématique prend une dimension particulière dans un contexte où les enjeux financiers et les attentes sociétales en matière de protection des personnes vulnérables ne cessent de croître.
II) Le mandat pour cause d’inaptitude en droit suisse
Pour rappel, le mandat pour cause d’inaptitude est un mécanisme juridique instauré par la révision du droit de la protection de l’adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013, et régi par les articles 360 à 369 du Code civil suisse (CC). Il permet à toute personne majeure et capable de discernement de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour la représenter dans le cas où elle deviendrait incapable de discernement à la suite d’une maladie, d’un accident ou de la vieillesse.
Ce mandat peut porter sur la gestion des biens, la prise en charge personnelle, ou les relations juridiques de la personne concernée (art. 360 al. 1 CC). Le mandant peut définir de manière détaillée les tâches du mandataire, ses pouvoirs, ainsi que ses limites.
Pour être valable, le mandat doit être établi sous forme d’un acte public (reçu par un notaire) ou rédigé de manière manuscrite, daté et signé, par le mandant lui-même (art. 361 CC). Il ne produit ses effets que lorsque la personne devient effectivement incapable de discernement, et son entrée en vigueur est soumise à la vérification de l’Autorité de protection de l’adulte (APEA), qui contrôle la validité du mandat, confirme l’incapacité du mandant et habilite le mandataire à agir (art. 363-365 CC).
L’APEA peut également, si nécessaire, surveiller le mandataire, exiger des rapports ou des comptes, ou encore adapter ou révoquer le mandat en cas de mauvaise exécution (art. 366-368 CC).
Le mandat pour cause d’inaptitude constitue une alternative au régime de curatelle imposé par l’État. Il permet de garantir une meilleure autonomie et une anticipation des besoins personnels, familiaux ou patrimoniaux, tout en renforçant la volonté et la liberté de choix du mandant. Ce dispositif est particulièrement recommandé dans les situations où une perte de discernement est prévisible ou simplement pour toute personne souhaitant planifier sa protection juridique de manière préventive.
III) La gestion du patrimoine dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude
A. Généralités
Dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude, la gestion du patrimoine représente un élément fondamental permettant d’assurer la continuité des affaires financières du mandant lorsqu’il est devenu incapable de discernement. Le mandant peut confier à une personne de confiance la responsabilité de gérer tout ou partie de ses biens. Cette mission peut inclure le paiement des dépenses courantes, la gestion des comptes bancaires, l’encaissement de revenus (comme une rente AVS, des loyers ou des dividendes), la gestion immobilière, ou encore la prise de décisions en matière de placements. Ces tâches doivent être exercées conformément à la volonté exprimée par le mandant dans le mandat et dans le respect de son intérêt.
S’agissant de l’ouverture de comptes bancaires ou de la procuration, le mandataire est habilité à agir uniquement une fois le mandat reconnu par l’Autorité de protection de l’adulte (APEA). Une simple procuration bancaire accordée avant l’inaptitude ne suffit plus dès que la capacité de discernement du mandant est perdue. Le mandat peut toutefois prévoir expressément que le mandataire pourra ouvrir un nouveau compte au nom du mandant, dans l’intérêt de la gestion du patrimoine. En tout état de cause, il est impératif d’éviter toute confusion entre les biens du mandant et ceux du mandataire, notamment en ne mélangeant pas les fonds sur un même compte personnel.
Le risque de conflits d’intérêts doit être pris au sérieux dans la gestion patrimoniale. Le mandataire doit agir exclusivement dans l’intérêt du mandant. S’il existe un lien personnel, comme une relation familiale ou successorale, le mandataire doit veiller à ne pas se favoriser lui-même, sauf si le mandat contient une clause explicite en ce sens. En cas de doute, ou si une opération risque de lui profiter personnellement (par exemple une vente entre lui et le mandant), il est tenu d’en informer l’APEA, qui pourra prendre des mesures ou nommer un curateur pour superviser ou autoriser certains actes.
B. La politique de gestion du patrimoine
1. L’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT)
La politique de gestion du patrimoine du mandant est un domaine important à définir.
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle législation suisse sur la protection de l’adulte au 1er janvier 2013, l’Ordonnance du 23 août 2023 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT ; RS 211.223.11) devient l’instrument de référence en matière de gestion patrimoniale pour les curateurs désignés selon les articles 390 et suivants CC. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, remplaçant celle du 4 juillet 2012, et vise à clarifier et simplifier la gestion des patrimoines sous curatelle ou tutelle, en tenant compte des évolutions législatives et des besoins pratiques identifiés depuis la réforme de 2013.
Cependant, l’OGPCT ne s’applique pas au mandat pour cause d’inaptitude. En effet, malgré des demandes de la part de certains cantons (Vaud notamment) et associations professionnelles (Association suisse des gestionnaires de fortune), souhaitant que celle-ci s’applique par analogie au mandat pour cause d’inaptitude, lorsque celui-ci ne contient pas de prescriptions quant au placement du patrimoine, le Conseil fédéral suisse a explicitement précisé dans son rapport explicatif que l’OGPCT règle uniquement le placement et la préservation des biens qui sont gérés par un mandataire dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle.
Les recommandations de l’Association suisse des banquiers ASB et de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) relatives à la gestion du patrimoine (ci-après les « Recommandations de l’ASB ») précisent également que « sauf instruction contraire, le mandataire n’est pas lié par les prescriptions en matière de placement de l’OGPCT ».
Or, il n’existe, à ce jour, aucune norme équivalente encadrant la gestion du patrimoine par un mandataire agissant sur la base d’un mandat pour cause d’inaptitude. Ce vide normatif soulève plusieurs interrogations quant aux obligations du mandataire, notamment en matière de stratégie de placement et de gestion des risques.
2. Le comblement de la lacune de la loi ou du mandat
Conformément à l’article 360 al. 2 CC, le mandant doit non seulement définir les tâches qu’il entend confier au mandataire, mais il peut également prévoir des instructions sur la façon dont ces tâches doivent être exécutées. Ainsi, par exemple, en matière de gestion du patrimoine, il n’est pas rare que le mandat contienne une disposition d’exécution telle que :
« La gestion des titres et avoirs en compte doit se poursuivre conformément à la stratégie de placement définie et/ou déposée auprès de la banque et/ou du gestionnaire de fortune au moment de l’entrée en vigueur du présent mandat pour cause d’inaptitude. Les mandataires chargés de la gestion du patrimoine sont autorisés, mais non obligés, à adapter la stratégie le cas échéant et de choisir un profil de placement présentant moins de risques. L’application de l’article 408 du Code civil suisse est exclue, y compris s’agissant du patrimoine immobilier du mandant. Les mandataires sont expressément autorisés à donner à la banque des ordres de gestion du patrimoine ».
Or, que se passe-t-il si le mandat pour cause d’inaptitude est silencieux sur la question de la gestion des avoirs du mandant ? Dans ce cas, le mandataire pourrait demander à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de préciser le contenu du mandat.
Quoi qu’il en soit, à défaut de précision, les règles ordinaires sur l’exécution du mandat s’appliquent (art. 365 al. 1 CC).
L’article 398 al. 2 CO stipule que le mandataire reste tenu d’exécuter le mandat avec diligence et dans l’intérêt du mandant. Les Recommandations de l’ASB reprennent cette même formulation sans donner plus de détails.
Il convient alors de distinguer deux cas de figure :
♦ Si la fortune du mandant est déjà administrée par un gestionnaire de fortune – par exemple une banque –, la stratégie existante peut éventuellement être maintenue, sous réserve qu’elle demeure dans l’intérêt du mandant ;
♦ En revanche, si aucun gestionnaire n’était en charge, le mandataire peut soit déléguer la gestion à un professionnel, soit définir lui-même une stratégie de placement, à condition d’en avoir les compétences.
Dans l’hypothèse où le mandataire élabore sa propre stratégie, il peut s’appuyer sur les choix antérieurs du mandant, y compris ceux intégrant un certain niveau de risque.
Toutefois, ce maintien ne saurait être automatique. Le changement de situation – à savoir la perte de discernement du mandant – impose une réévaluation des risques.
Le mandataire doit désormais garantir non seulement la pérennité du patrimoine, mais aussi sa disponibilité pour couvrir les besoins vitaux du mandant (frais de subsistance, traitements médicaux, soins, etc.). La conservation de la substance du patrimoine devient alors l’objectif prioritaire.
À ce titre, l’OGPCT, bien qu’inapplicable de manière formelle, peut servir de référence utile pour guider la gestion de fortune.
L’article 2 de cette ordonnance, prévoit notamment de manière générale que :
« 1. Les biens gérés sont placés de manière sûre et, si possible, rentable.
2. Les risques de placement sont minimisés par une diversification adéquate.
3. Les frais liés au placement doivent être proportionnés à la fortune placée et aux revenus escomptés ».
L’article 5 OGPCT constitue un pivot fondamental, en imposant au mandataire de fonder toute décision de placement sur la situation personnelle de la personne protégée. Cela inclut des éléments tels que l’âge, l’état de santé, les besoins courants, les revenus, la fortune, la couverture d’assurance, ainsi que – autant que possible – la volonté exprimée (antérieurement) par la personne. Le mandataire doit également prendre en compte les prestations attendues (retraite, assurance-maladie, accident, dépendance) ainsi que les besoins extraordinaires prévisibles, de sorte à garantir une couverture financière adaptée dans le temps.
Ce principe de personnalisation oriente l’application des articles suivants qui distinguent deux grandes catégories d’actifs : d’une part, les placements sûrs et liquides (art. 6 OGPCT), tels que les dépôts à terme ou les obligations étatiques suisses, destinés à couvrir les besoins courants sur plusieurs années ; d’autre part, les placements à potentiel de rendement plus élevé (art. 7 OGPCT), émis par des émetteurs très solvables, tels que les obligations et actions suisses, les fonds réglementés (obligataires, actions, mixtes), certains produits d’assurance, les produits structurés suisses garantis, les biens immobiliers de valeur stable (non destinés à l’usage personnel), des participations, des placements fiduciaires en CHF, et certains fonds en métaux précieux (or/argent entièrement stockés).
L’ordonnance fixe des limites indicatives sur la fortune totale pour certains types d’actifs :
- ♦ Actions et participations : max. 25 %
- ♦ Titres d’entreprises étrangères : max. 50 %
- ♦ Fonds immobiliers suisses : max. 10 %
- ♦ Fonds investis en or ou argent : max. 10 %
3. L’application de la gestion du patrimoine par les cantons
En application de l’article 11 alinéa 2 OGPCT en matière de gestion du patrimoine, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) du canton de Genève a par exemple édicté une directive détaillée visant à préciser les conditions de placement des avoirs des personnes concernées. Ce document, dont la dernière version date de janvier 2025, encadre de manière rigoureuse les investissements admis et fixe notamment des plafonds, des exigences de notation et des critères de liquidité en fonction de la situation financière de la personne protégée.
La directive prévoit ainsi, conformément à l’article 7 al. 3 OGPCT, une possibilité de dérogation lorsque la fortune financière de la personne concernée atteint ou dépasse 3 millions de francs. Dans ce cas, des investissements supplémentaires peuvent être autorisés pour la part excédant ce seuil, à condition de respecter les principes de prudence et de diversification. Cela permet notamment d’accéder à des produits habituellement exclus pour des patrimoines modestes, tout en assurant une gestion du patrimoine adaptée aux capacités de risque réelles.
Dans ce cadre exceptionnel (investisseurs qualifiés au sens de l’article 10 de la Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux, LPCC, RS 951.31), des investissements alternatifs sont autorisés à hauteur de 15 % de la fortune financière, avec des sous-limites claires : 10 % pour les hedge funds ou le private equity, 10 % pour les fonds immobiliers, 5 % pour les matières premières dans des fonds indiciels de matières premières, et 3 % pour les cryptomonnaies (ou trackers liés) à condition qu’ils soient déposés auprès d’un établissement suisse. Ces investissements ne sont permis que dans un portefeuille distinct, sous mandat de gestion séparé.
Concernant les devises, la directive impose un plafond général de 20 % de la fortune financière pour les placements en monnaies étrangères, dont un maximum de 10 % dans des devises autres que l’euro et le dollar. En cas de fortune très élevée (art. 7 al. 3), ce plafond est porté à 50 %. Les cryptomonnaies sont expressément assimilées à des investissements en devises étrangères pour le calcul de ces plafonds.
S’agissant des obligations, la directive distingue deux niveaux de notation : en gestion standard, seule une note minimale de A-/A3/A(low) est admise ; dans les cas de fortune excédant 3 millions, des obligations ayant une notation minimale de BBB-/Baa3/BBB(low) peuvent être acceptées, avec une maturité ne dépassant pas six ans et une exposition individuelle plafonnée à 10 % de la fortune financière.
Enfin, le mandataire est tenu, selon l’article 8 OGPCT, de mettre le patrimoine en conformité avec l’ordonnance et la directive dans un délai de six mois dès sa prise de fonction (si la fortune financière dépasse CHF 100’000), ou dans un délai de trois mois en cas d’entrée exceptionnelle de fonds (ex. : succession, vente immobilière > 500’000 CHF). Ce respect des délais constitue une obligation de diligence stricte, contrôlée lors de la reddition annuelle des comptes.
Comme déjà relevé, cette directive, de même que l’OGCPT, ne s’applique pas au mandat pour cause d’inaptitude, mais leur contenu peut servir de référence utile pour guider le mandataire dans une gestion du patrimoine prudente et personnalisée, en particulier en l’absence de directives spécifiques dans le mandat.
En tout état de cause, il paraît important d’insister sur une stratégie de diversification et de conservation de valeur, principes que le mandataire gagne à suivre pour éviter tout reproche de gestion imprudente.
En effet, en cas de non-respect de ces principes, la responsabilité du mandataire pourrait être engagée, en particulier si la stratégie poursuivie expose le patrimoine à des risques injustifiés compte tenu de la nouvelle situation du mandant.
Enfin, il convient de s’interroger sur la validité d’une stratégie de gestion risquée mise en place avant la perte de discernement, dans le cadre d’un contrat conclu avec un gestionnaire de fortune. Dans ce cas également, la prudence s’impose ; à notre sens, le mandat pour cause d’inaptitude ne saurait servir à maintenir une stratégie initiale manifestement inadaptée à la situation actuelle. Le mandataire doit ainsi procéder à un réexamen et, le cas échéant, abandonner toute stratégie de gestion du patrimoine excessive, au profit d’une approche plus conservatrice et protectrice.
4. La jurisprudence du Tribunal fédéral
à noter enfin que le Tribunal fédéral s’est récemment prononcé sur la responsabilité civile d’un tuteur en lien avec les activités de gestion du patrimoine de son pupille (arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019).
Cet arrêt, certes rendu selon l’ancien droit de la protection de l’adulte et non directement applicable au mandat pour cause d’inaptitude, met néanmoins en évidence certains aspects de la responsabilité du tuteur et comporte des éléments importants sur la façon dont les biens doivent être gérés.
Ainsi, « de manière générale, en application de l’art. 413 al. 1er aCC, le tuteur a l’obligation de gérer les biens du pupille avec diligence. Il lui incombe en premier lieu d’en préserver la substance, éventuellement de l’accroître (ATF 136 III 113 consid. 3.2.1), mais surtout d’écarter, dans la mesure du possible, les risques de dépréciation (ATF 52 II 319 consid. 2). Le maintien de la fortune, voire son augmentation, ne sont pas un but en soi ; il faut bien plus préserver le mieux possible les intérêts généraux du pupille, et la fortune doit être administrée en tenant compte des circonstances concrètes. Cela signifie que le tuteur doit planifier les dépenses du pupille de telle sorte qu’après une évaluation prudente, son train de vie ne soit pas restreint à la fin de sa vie (ATF 136 III 113 consid. 3.2.1). Dans cette optique, la fortune qui n’est pas utilisée pour les dépenses nécessaires ou pour d’autres dépenses adaptées à l’état du patrimoine doit être investie dans un placement sûr pour le pupille ; ce faisant, le tuteur doit agir avec la plus grande prudence et s’abstenir de tous placements ou affaires spéculatifs (ATF 136 III 113 consid. 3.2.1 et les références ; 52 II 319 consid. 2). La plus grande prudence lui est imposée. S’il croit devoir, sans motifs impérieux, tenter une opération purement spéculative, il le fait à ses risques et périls et ne saurait décliner sa responsabilité en arguant que des motifs désintéressés l’animaient (ATF 52 II 319 consid. 2 in fine) ».
IV) Conclusion
La gestion du patrimoine dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude constitue un volet sensible et technique de ce dispositif juridique. Si le mandat pour cause d’inaptitude permet à une personne de déléguer la gestion de ses biens en cas de perte de discernement, cette délégation doit s’inscrire dans un cadre strictement orienté vers la préservation des intérêts économiques du mandant. Le droit suisse, tout en reconnaissant une grande liberté au mandant (art. 360 al. 2 CC), n’encadre toutefois que de manière indirecte la manière dont cette gestion doit être exercée. Contrairement aux curateurs, les mandataires désignés par mandat ne sont pas soumis aux prescriptions de l’Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT), ce qui crée un vide normatif source d’incertitudes pratiques.
En l’absence de directives spécifiques dans le mandat, le mandataire doit se référer aux principes généraux du droit des obligations, en particulier à l’article 398 al. 2 CO, qui impose une gestion diligente, prudente et conforme à l’intérêt du mandant. Dans ce contexte, toute décision patrimoniale – qu’il s’agisse de placements, de désinvestissements ou de gestion immobilière – doit être guidée par la situation personnelle du mandant : ses besoins actuels et futurs, son âge, son état de santé, son niveau de fortune, ainsi que ses engagements préexistants. Le mandataire est également tenu de minimiser les risques, d’assurer la liquidité nécessaire pour les dépenses courantes, et de privilégier la conservation de la substance du patrimoine au détriment de la performance.
En l’absence d’instructions précises, et en raison de l’absence de cadre réglementaire, le mandataire prudent peut utilement s’inspirer de l’OGPCT ou des directives cantonales pour adopter une gestion diversifiée et prudente. Il lui appartient aussi de documenter ses choix et, le cas échéant, de consulter l’APEA lorsque l’interprétation du mandat ou la situation économique le justifie.
Enfin, la responsabilité civile du mandataire peut être engagée en cas de gestion du patrimoine fautive ou inadaptée. La jurisprudence du Tribunal fédéral, bien qu’issue de cas de tutelle, insiste sur l’impératif de prudence, la protection de la fortune du mandant, et l’interdiction de comportements spéculatifs. La gestion patrimoniale dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude doit être rigoureusement planifiée, adaptée aux circonstances concrètes, et orientée vers la protection durable des intérêts du mandant.
Bien entendu, outre la prise en compte du comportement du mandant lorsqu’il disposait de sa capacité de discernement (par exemple en cas de gestion dynamique), la situation financière du mandant doit être considérée, dans la mesure où l’on pourra accepter une prise de risque plus importante en présence d’une fortune personnelle importante. Une capacité financière élevée permet en effet d’absorber plus aisément les fluctuations des marchés ou la baisse temporaire de certains actifs, sans compromettre la couverture des besoins vitaux du mandant, tels que les soins, l’hébergement ou les dépenses courantes. Dans ce contexte, une diversification plus large du portefeuille, incluant éventuellement des placements à rendement plus élevé – tels que les métaux précieux, certains fonds spécialisés ou des produits structurés – peut être envisagée, à condition que ces choix soient compatibles avec le profil de risque global du mandant, son horizon de placement, et ses préférences exprimées avant la perte de discernement.