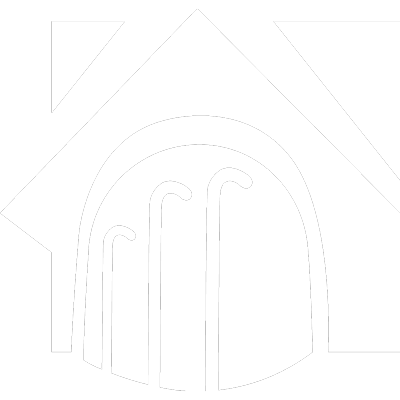Table des matières
- Contrat de mariage : prévoir le pire pour vivre le meilleur
- Remarques introductives
- Quel est le for et le droit applicable en matière de régime matrimonial dans les situations internationales ?
- Quel est le régime matrimonial applicable en l’absence d’un contrat de mariage ?
- Comment se passe la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts ?
- Qu’est-ce qu’un contrat de mariage et quelles sont ses conditions ?
- Sur quoi peut porter le contrat de mariage ?
- Quelles sont les alternatives à l’application de l’article 199 CC par contrat de mariage ?
- Peut-on régler d’autres aspects dans un contrat de mariage ?
- Les conventions réglant par anticipation les effets du divorce sont-elles admises en droit suisse ?
- Qu’en est-il de l’établissement d’un inventaire des biens dans le cadre du contrat de mariage ?
- Comment fonctionne le régime matrimonial de la séparation de biens ?
- Quelles sont les règles de la communauté de biens ?
Contrat de mariage : prévoir le pire pour vivre le meilleur
En amour comme en affaires, l’inconscience peut coûter très cher. Les plus cyniques diront qu’un mariage se gère comme une entreprise et qu’il vaut mieux prévoir plutôt que d’essuyer les plâtres. Cela est d’autant plus vrai que vous avez statistiquement environ 40% de chances de divorcer.
L’institution du mariage et ses effets sont globalement connus de tous (devoir de fidélité et d’assistance, d’entretien et d’éducation des enfants, etc.) ; toutefois, beaucoup de couples ne prennent conscience des effets patrimoniaux du mariage qu’à la dissolution de celui-ci par suite de décès ou de divorce, et donc à un moment où il n’existe pratiquement plus aucune possibilité d’aménagement. Or, le choix du régime matrimonial est stratégiquement important. Paradoxalement, les Suisses ne recourent que rarement à la conclusion d’un contrat de mariage, à tort.
Certes, un accord prénuptial représente un aspect peu romantique du mariage et lorsque les cloches sonnent, le ciel est bleu sans nuage à l’horizon, l’amour et le romantisme prédominent, les conjoints sont convaincus que leur union sera éternelle et qu’ils peuvent se faire mutuellement confiance. Pourtant, une crise dans le couple, un décès, la création de sa propre entreprise ou une situation de surendettement sont des facteurs de risque.
Dans le cadre d’un divorce, lorsque le patrimoine des époux est peu important, les conséquences financières seront minimes. Les biens seront répartis selon le régime ordinaire de la participation aux acquêts et le divorce ne sera bientôt qu’un malheureux souvenir, à conditions de s’entendre sur le sort des enfants. La situation est en revanche complètement différente en présence d’une fortune substantielle des époux, ou si leur patrimoine comporte des immeubles ou une entreprise. Dans de tels cas de figure, il n’est pas rare que l’un des conjoints doive vendre ses biens afin d’indemniser l’autre dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, faute de liquidités suffisantes. En effet, légalement en cas de divorce et en l’absence de contrat de mariage, la moitié des acquêts est attribuée au conjoint. De nombreux entrepreneurs et patrons de PME sous-estiment ce risque de nature privée. En outre, la question de la transmission de l’entreprise n’est souvent pas abordée ni anticipée.
Il paraît donc impératif de planifier les effets de la liquidation du régime matrimonial au moyen d’un contrat de mariage, afin de prévenir toute mauvaise surprise, que cela soit dans le cadre d’un potentiel divorce ou d’une succession. Certes, un accord prénuptial n’offrira aucune garantie du succès d’un couple, mais il peut au moins empêcher des conséquences financières désastreuses pour la famille.
Sans aller dans des extrêmes dignes d’un feuilleton américain – il est en effet fréquent aux États-Unis de trouver dans les contrats de mariage des clauses dites « de relation », destinées à fixer le temps minimum que le couple doit passer ensemble hebdomadairement ou de fidélité, établissant des pénalités, notamment pécuniaires, en cas de tromperie de l’un des partenaires -, il est également possible en Suisse d’étendre le contrat de mariage à d’autres aspects non patrimoniaux du mariage. Ainsi, on songera par exemple à un accord sur la répartition des tâches au sein du couple, aux soins voués aux enfants, à l’aide du conjoint dans l’entreprise familial ou même à des clauses réglant par anticipation les effets d’un potentiel divorce (attribution du logement familial, de la garde des enfants, du montant de la pension, du nom de famille, etc.).
En tant qu’instrument juridique de plus en plus courant, un contrat de mariage n’est pas uniquement réservé à des individus fortunés ou des stars de cinéma. Un accord prénuptial permet à tout couple qui a l’intention de se marier de régler les problèmes d’un divorce potentiel au début de la relation lorsque les deux parties sont plus susceptibles de traiter équitablement et généreusement l’une avec l’autre. Il peut également être vu comme un moyen de garantir au futur conjoint que ses sentiments sont sincères et non pas construits sur des arrière-pensées.
Les avocats d’Onyx Trust assistent la clientèle du Family Office dans la préparation et la rédaction de contrat de mariage en droit suisse. Ils disposent d’une longue expérience en la matière et s’efforcent de trouver des solutions personnalisées compte tenu de la situation patrimoniale et familiale des conjoints.
Vous trouverez ci-dessous une présentation sommaire des règles juridiques en matière de régimes matrimoniaux ainsi que des possibilités offertes dans le cadre de la rédaction d’un contrat de mariage, étant précisé que les conseils d’un expert sont fortement recommandés tant la matière peut s’avérer complexe.
Un mariage valablement célébré à l’étranger est en principe reconnu en Suisse. Ainsi, il suffit que l’État où le couple s’est marié reconnaisse la célébration ou que celle-ci soit reconnue par un pays dont l’un des époux a la nationalité ou le domicile.
S’agissant du régime matrimonial, les conjoints sont libres, d’après les règles suisses en matière de droit international privé, de choisir (alternativement) le droit de l’État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage, le droit de l’État dans lequel le mariage a été célébré, ou le droit d’un État dont l’un d’eux a la nationalité (article 52 LDIP). L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire. Par ailleurs, le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix. Ainsi, par exemple, si les époux se sont mariés en Italie et ont soumis par contrat de mariage leur régime matrimonial au droit italien mais déménagent par la suite à Genève, ils resteront assujettis au droit italien, nonobstant le changement de domicile. Par contre, ils peuvent faire élection de droit suisse avec effet rétroactif au jour de leur union par contrat de mariage passé devant un notaire en Suisse. S’agissant des conditions de forme, le contrat de mariage doit prendre la forme écrite ou celle imposée par la loi régissant le régime matrimonial ou le droit du lieu où l’acte a été passé (la forme authentique en Suisse par exemple).
En l’absence d’élection de droit, l’article 54 LDIP prescrit un rattachement en cascade : le régime matrimonial est régi tout d’abord par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. A défaut encore, les conjoints sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. En cas de transfert du domicile des époux d’un État dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité et le régime matrimoniale sera ainsi divisé dans le temps en plusieurs tranches correspondant aux changements de domicile des conjoints. Cette décision des époux n’entraîne en principe pas la dissolution du régime antérieur. Au jour de la dissolution (divorce, décès, etc.), le régime précédent sera liquidé en premier lieu, puis le résultat sera reporté dans le nouveau régime.
Au niveau du for, en cas de décès de l’un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses en charge de liquider la succession seront compétentes pour la dissolution du régime matrimonial. En cas de divorce ou de séparation de corps, les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur dans la procédure ou ceux du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse, seront généralement compétents (subsidiairement lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit). Une élection de for n’est pas autorisée.
Enfin, dans les autres cas (soit hors décès ou procédure de divorce), la compétence reviendra généralement aux autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage à savoir celles du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle suisse de l’un des époux (subsidiairement si les époux n’ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine seront compétentes si l’action ne peut être intentée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit). Une élection de for est possible dans cette hypothèse.
A noter que l’Union européenne dispose entre autres d’un règlement spécifique (Règlement UE n° 2016/1103 du 24 juin 2016) en matière de régimes matrimoniaux pouvant provoquer des conflits positifs de lois avec la Suisse en l’absence d’élection de droit. En effet, la Suisse prévoit la mutabilité automatique de la loi régissant le régime matrimonial, avec effet rétroactif (55 LDIP) alors que le droit européen stipule la permanence de la loi régissant le régime matrimonial nonobstant un déménagement ultérieur des époux (article 26 par. 1 du Règlement). A relever qu’il existe également une Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 à laquelle la Suisse n’est pas partie.
Enfin, selon l’article 23 CPC au niveau national, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions en matière de liquidation du régime matrimonial. Toutefois, en cas de succession, le for successoral l’emporte sur le for matrimonial.
Remarques introductives
Dans le cadre du mariage, y compris entre personnes du même sexe (la Suisse ayant introduit le mariage pour tous et toutes au 1er juillet 2022), le régime matrimonial définit le statut des époux·ses quant à leurs biens. En d’autres termes, il exprime l’influence que le mariage exerce sur le sort du patrimoine des conjoints, non seulement dans les rapports juridiques entre eux, mais également s’agissant des rapports avec les tiers (propriété, jouissance, gestion des biens, responsabilité pour les dettes, etc.).
Les régimes matrimoniaux sont réglés à partir des articles 181 et suivants du Code civil. Le législateur n’a pas imposé un régime unique matrimonial applicable à tous ; au contraire, le droit suisse distingue trois régimes distincts, à savoir celui de la participation aux acquêts, de la communauté de biens et de la séparation de biens (un régime extraordinaire de séparation de biens existe en sus afin de protéger les intérêts des époux ou des créanciers dans des situations spéciales, comme par exemple à la demande de l’un des époux en cas de mesures de protection de l’union conjugale ou pour justes motifs ou encore de faillite de l’un des conjoints dans le cadre d’une communauté de biens). Si les époux ne prévoient rien de particulier, ils sont automatiquement soumis au régime de la participation aux acquêts. On appelle ce dernier, le « régime matrimonial ordinaire » qui représente la très grande majorité des cas (90% en Suisse). Si, en revanche, les époux souhaitent choisir la communauté de biens ou la séparation de biens, ils doivent obligatoirement conclure un contrat de mariage passé par devant un notaire. Ainsi, il est possible pour les conjoints d’aménager le régime de leurs biens dans le cadre du mariage, dans les limites toutefois imposées par la loi. Il est également possible de passer d’un régime à un autre durant le mariage voire même de le modifier si la loi ouvre cette possibilité (voir ci-dessous).
Quel est le for et le droit applicable en matière de régime matrimonial dans les situations internationales ?
Un mariage valablement célébré à l’étranger est en principe reconnu en Suisse. Ainsi, il suffit que l’État où le couple s’est marié reconnaisse la célébration ou que celle-ci soit reconnue par un pays dont l’un des époux a la nationalité ou le domicile.
S’agissant du régime matrimonial, les conjoints sont libres, d’après les règles suisses en matière de droit international privé, de choisir (alternativement) le droit de l’État dans lequel ils sont tous deux domiciliés ou seront domiciliés après la célébration du mariage, le droit de l’État dans lequel le mariage a été célébré, ou le droit d’un État dont l’un d’eux a la nationalité (article 52 LDIP). L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire. Par ailleurs, le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix. Ainsi, par exemple, si les époux se sont mariés en Italie et ont soumis par contrat de mariage leur régime matrimonial au droit italien mais déménagent par la suite à Genève, ils resteront assujettis au droit italien, nonobstant le changement de domicile. Par contre, ils peuvent faire élection de droit suisse avec effet rétroactif au jour de leur union par contrat de mariage passé devant un notaire en Suisse. S’agissant des conditions de forme, le contrat de mariage doit prendre la forme écrite ou celle imposée par la loi régissant le régime matrimonial ou le droit du lieu où l’acte a été passé (la forme authentique en Suisse par exemple).
En l’absence d’élection de droit, l’article 54 LDIP prescrit un rattachement en cascade : le régime matrimonial est régi tout d’abord par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. A défaut encore, les conjoints sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. En cas de transfert du domicile des époux d’un État dans un autre, le droit du nouveau domicile est applicable et rétroagit au jour du mariage. Les époux peuvent convenir par écrit d’exclure la rétroactivité et le régime matrimonial sera ainsi divisé dans le temps en plusieurs tranches correspondant aux changements de domicile des conjoints. Cette décision des époux n’entraîne en principe pas la dissolution du régime antérieur. Au jour de la dissolution (divorce, décès, etc.), le régime précédent sera liquidé en premier lieu, puis le résultat sera reporté dans le nouveau régime.
Au niveau du for, en cas de décès de l’un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses en charge de liquider la succession seront compétentes pour la dissolution du régime matrimonial. En cas de divorce ou de séparation de corps, les tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur dans la procédure ou ceux du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse, seront généralement compétents (subsidiairement lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit). Une élection de for n’est pas autorisée.
Enfin, dans les autres cas (soit hors décès ou procédure de divorce), la compétence reviendra généralement aux autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage à savoir celles du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle suisse de l’un des époux (subsidiairement si les époux n’ont ni domicile ni résidence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine seront compétentes si l’action ne peut être intentée devant l’autorité du domicile ou de la résidence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit). Une élection de for est possible dans cette hypothèse.
A noter que l’Union européenne dispose entre autres d’un règlement spécifique (Règlement UE n° 2016/1103 du 24 juin 2016) en matière de régimes matrimoniaux pouvant provoquer des conflits positifs de lois avec la Suisse en l’absence d’élection de droit. En effet, la Suisse prévoit la mutabilité automatique de la loi régissant le régime matrimonial, avec effet rétroactif (55 LDIP), alors que le droit européen stipule la permanence de la loi régissant le régime matrimonial, nonobstant un déménagement ultérieur des époux (article 26 par. 1 du Règlement). A relever qu’il existe également une Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978 à laquelle la Suisse n’est pas partie.
Enfin, selon l’article 23 du Code de procédure civile (CPC) au niveau national, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions en matière de liquidation du régime matrimonial. Toutefois, en cas de succession, le for successoral l’emporte sur le for matrimonial.
Afin d’établir la masse successorale qui sera dévolue aux héritiers, il convient avant toute chose de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Quel est le régime matrimonial applicable en l’absence d’un contrat de mariage ?
Le régime de la participation aux acquêts est le régime légal ordinaire en Suisse, s’appliquant aux couples mariés n’ayant pas conclu un contrat de mariage. Il distingue les biens propres des acquêts.
Il est toutefois important de garder à l’esprit que chaque époux reste propriétaire de ses biens propres et de ses acquêts, dont il en a la jouissance, l’administration et la disposition (dans les limites des règles sur le mariage comme par exemple la protection du logement familial (article 169 CC) ou le droit du conjoint de représenter l’union conjugale pour les besoins courants de la famille (article 166 al. 1 CC)). En outre, les conjoints répondent toujours de leurs dettes sur tous leurs biens, conformément aux règles du Code des obligations. Aussi, contrairement à une idée reçue, chacun des époux a ses propres dettes, nées avant ou pendant le mariage, et son conjoint n’est nullement tenu de celles-ci (sauf exceptions s’agissant notamment du pouvoir de représentation du conjoint pour les besoins courant de la famille comme l’entretien du logement, les frais de nourriture, les assurances, les loisirs raisonnables, etc. et ceci peu importe le régime matrimonial adopté ou encore la protection des créanciers en cas de changement de régime matrimonial (article 193 al. 2 CC)). Enfin, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.
Les biens propres constituent pour chaque époux un patrimoine séparé, dont la substance n’a pas à être partagée avec le conjoint. En d’autres termes, chacun des époux est propriétaire de ses biens propres pendant le régime matrimonial et les reprend à la dissolution, supportant une éventuelle moins-value ou profitant d’une éventuelle plus-value. Les biens propres dits « légaux » comprennent exhaustivement :
- les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel (par exemple les vêtements, les bijoux, les livres, les équipements de sport, etc. qui ne sont pas utilisés en commun par les conjoints et qui sont la propriété de l’époux considéré) ;
- les biens qui lui appartiennent au début du régime (par exemple les économies du travail d’un époux avant le mariage) ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit (par exemple via une donation, un partage successoral ou un leg) ;
- les créances en réparation d’un tort moral. Celles-ci constituent des indemnisations visant à compenser des violations des droits de la personnalité. En raison de leur lien étroit avec la personne de l’intéressé, elles font partie des biens propres ;
- les biens acquis en remploi des biens propres (par exemple l’achat d’une voiture au moyen du produit de la vente d’un bijou hérité).
Alors que les biens propres sont énoncés de manière exhaustive, le législateur donne une définition abstraite des acquêts, complétée par une énumération non-exhaustive de certains acquêts. En clair, tout ce qui n’est pas compris dans la masse des biens propres est un acquêt.
Ainsi, d’après l’article 197 al. 1 CC tous les biens acquis à titre onéreux par un conjoint pendant la durée du régime matrimonial doivent en principe être attribués à ses acquêts. Le second alinéa de cet article précise ce postulat ; les acquêts d’un époux comprennent ainsi notamment :
- le produit de son travail, soit tout gain réalisé par un époux du fait d’une activité intellectuelle ou physique (salaire, pourboire, etc. résultant d’une activité dépendante ou indépendante, régulière ou non). En revanche, sauf exception, les revenus du capital issus d’investissements ne tombent pas dans cette catégorie ;
- les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale, soit les prestations en espèces attribuées sous forme de rente ou de capital du 1er et du 2ème piliers provenant des fonds de pensions, de l’assurance vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage, etc. (les versements en capital par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de sa capacité de travail font l’objet de règles spécifiques dans le cadre d’un divorce ou d’un changement de régime) ;
- les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail ;
- les revenus de ses biens propres (dividendes, intérêts, loyers, revenus d’une entreprise, parts de bénéfice d’une société de personne, etc. mais non le bénéfice de liquidation d’une société) ;
- les biens acquis en remploi de ses acquêts (par exemple l’achat d’un véhicule au moyen de son salaire).
Il ressort de ce qui précède que le régime matrimonial de la participation aux acquêts comprend quatre masses :
- les biens propres du premier conjoint ;
- les biens propres du second conjoint ;
- les acquêts du premier conjoint ;
- les acquêts du second conjoint.
Ces différentes masses de biens doivent être clairement identifiées avant de procéder au partage lorsqu’il y a décès, divorce, annulation du mariage, séparation de corps ou changement de régime matrimonial. La loi prévoit que quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve. À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (généralement les cadeaux de mariage par exemple). Par ailleurs, tout bien d’un époux est présumé être acquêt, sauf preuve du contraire. Enfin, les actifs doivent toujours être affectés dans l’ensemble à une masse de biens.
Comment se passe la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts ?
Lors de la liquidation du régime matrimonial, chaque époux reprend ses biens propres arrêtés au jour de la dissolution du régime ainsi que ses acquêts, mais est débiteur envers son conjoint d’une somme correspondant à la moitié du bénéfice qu’il a réalisé sur ses acquêts pendant le régime. Ainsi, le bénéfice global réalisé par les époux sur leurs acquêts respectifs durant le régime est partagé entre eux par moitié.
Le régime matrimonial est dissous, c’est-à-dire qu’il prend fin, au jour du décès de l’un des époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime. En cas de divorce ou de séparation de corps, la dissolution rétroagit au jour du dépôt de la demande. C’est à ce moment que la composition des masses matrimoniales est arrêtée en vue de la liquidation.
Avant toute chose, il est important de retenir que la liquidation du régime matrimonial est un préalable au calcul de l’actif successoral dans le cadre d’un héritage. Par ailleurs, la dissolution du régime n’a en principe aucun impact sur les rapports juridiques des époux avec les tiers. Les actifs et les dettes sont simplement pris en considération pour établir les masses de biens de chacun des époux.
Préalablement à la liquidation, il faut régler les rapports juridiques entre les époux qui se sont noués indépendamment de leur statut matrimonial (contrat de prêt, de travail, administration des biens de l’autre conjoint par un mandat, partage des biens en copropriété, etc.).
La liquidation du régime matrimonial proprement dite consiste en premier lieu à dissocier le patrimoine des époux en définissant ce qui appartient à chacun d’eux et en récupérant la possession des biens en mains de l’autre. Dans une deuxième étape, il convient de déterminer ce qui appartient aux acquêts et aux biens propres de chaque conjoint.
La liquidation du régime matrimonial peut donner lieu à des situations complexes lorsqu’un bien a été financé par des masses différentes, qui peuvent appartenir à un même époux ou au conjoint. Tel est le cas par exemple si le mari a hérité de la maison de ses parents (biens propres de monsieur), mais que des travaux de rénovations ont été entrepris au moyen du salaire de l’épouse (acquêts de madame). Dans pareille situation, des mécanismes de récompenses interviennent entre les différentes masses de biens (et non pas une affiliation proportionnelle aux masses).
Ainsi, si monsieur hérite de la villa dont la valeur est fixée à CHF 800’000 et que madame ajoute CHF 200’000 de son salaire pour financer les travaux de celle-ci, lors de la liquidation du régime matrimonial, les acquêts de madame auront une récompense de CHF 200’000 qui seront réintégrés comptablement dans la masse. Si une plus-value est réalisée sur l’immeuble, celle-ci sera répartie proportionnellement entre les masses de biens qui ont financé l’objet. Ainsi, si la maison vaut à la date de la liquidation du régime matrimonial CHF 1’500’000, les acquêts de madame participeront à la plus-value à hauteur de CHF 100’000 en plus des CHF 200’000.
Tandis que les récompenses dans le cadre des masses de biens d’un conjoint participent tant à une plus-value qu’à une moins-value, une récompense ayant au moins le niveau de l’investissement initial revient aux masses de biens en cofinancement de l’un des conjoints vis-à-vis de la masse de biens concernée. En d’autres termes, l’autre conjoint participe toujours à une éventuelle plus-value mais il ne doit toutefois pas supporter une moins-value. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, si la maison suite à un tremblement de terre ne vaut plus que CHF 700’000, les acquêts de madame auront toujours une récompense de CHF 200’000. Les biens propres de monsieur ne seront eux plus que de CHF 500’000. En revanche, dans l’hypothèse où les travaux auraient été financés au moyen des acquêts de monsieur, ces derniers n’auraient plus qu’une récompense de CHF 140’000 (20% de CHF 700’000).
Par ailleurs, dans une perspective entrepreneuriale, si l’entreprise du conjoint entrepreneur constitue un bien propre du conjoint et si ce conjoint réinvestit pendant le mariage dans l’entreprise à partir des recettes courantes, il y aura récompense des acquêts vis-à-vis des biens propres. Le conjoint entrepreneur devra calculer ces investissements (éventuellement en tenant compte de la plus-value ou de la moins-value) dans ses acquêts à partir de ses biens propres, ce qui va faire augmenter le bénéfice à partager avec son conjoint. Ceci peut amener l’entreprise à se retrouver dans une impasse financière lors de la liquidation du régime matrimonial (voir ci-dessous).
Outre le règlement des récompenses, les conjoints doivent également régler des éventuelles dettes réciproques dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et effectuer, le cas échéant, des réunions aux acquêts selon l’article 208 CC. En effet, s’agissant de ce dernier point, dans la mesure où le droit au bénéfice du conjoint s’exprime par une créance, un époux a théoriquement la possibilité de rendre illusoire celui-ci en distrayant de la masse des acquêts de biens qui auraient contribués à constituer le bénéfice de l’autre époux. A l’instar des mécanismes prévu en droit successoral, le législateur a prévu un système de réunions matrimoniales. Sont ainsi réunis aux acquêts, en valeur, 1) les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage et 2) les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.
Pour autant que les dettes grevant les acquêts d’un conjoint ne dépassent pas la valeur totale de ces acquêts, il y a lieu à bénéfice qui sera partagé par moitié. Si le compte d’acquêts d’un époux présente un solde déficitaire, celui-ci sera à la charge de cet époux, le droit suisse ne prévoyant pas de participation d’un époux aux pertes subies par son conjoint. En revanche, l’époux dont le compte d’acquêts est déficitaire participe au bénéficie réalisé par son conjoint.
La participation au bénéfice consiste en une créance en argent, ce qui exclut un partage en nature des biens qui composent les acquêts de chaque époux. Des délais de paiement peuvent être octroyés si l’époux débiteur se retrouve exposé à des graves difficultés. De même, pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué (voir même la propriété si les circonstances le justifient) en imputation sur sa créance de participation. Il en va de même de l’attribution du mobilier de ménage en propriété.
Qu’est-ce qu’un contrat de mariage et quelles sont ses conditions ?
D’un point de vue strict, un contrat de mariage n’est rien d’autre qu’un contrat bilatéral par lequel les (futurs) époux règlent leur régime matrimonial, en s’écartant du régime ordinaire ou d’un régime conventionnel antérieur, le tout dans les limites fixées par la loi.
Seules les personnes capables de discernement peuvent conclure un contrat de mariage. Les personnes sous curatelle doivent être autorisées par leur représentant. En outre, le contrat de mariage étant de nature personnelle, il exige la présence effective des parties lors de la signature et ne peut donc pas être conclu par représentation.
Le contrat de mariage doit impérativement être passé en la forme authentique, c’est-à-dire par devant notaire. La même condition s’applique à la modification ou à la révocation de l’acte.
En principe, le contrat de mariage produit ses effets, à l’égard de époux et des tiers, immédiatement à la date de sa conclusion. Si les parties ne sont pas encore mariées, l’acte est subordonné à la célébration du mariage et produira ses effets dès ce moment. En cas de modification du régime matrimonial durant le mariage, il est possible de faire rétroagir cette modification jusqu’au début de leur union (dans les rapports internes des époux uniquement et non vis-à-vis des tiers).
La constitution de biens propres conventionnels par contrat de mariage permet de favoriser la pérennité et la transmission d’une entreprise, en soustrayant celle-ci des acquêts du conjoint entrepreneur.
Sur quoi peut porter le contrat de mariage ?
La liberté de contracter des époux est limitée par la loi. Ainsi, les conjoints sont tenus d’adopter l’un des régimes matrimoniaux acceptés (participation aux acquêts, communauté de biens, séparation de biens). A noter qu’il n’est pas possible de combiner plusieurs régimes, la totalité du patrimoine du couple devant être soumis au régime choisi.
Ensuite, les époux ont la faculté de modifier le régime auquel ils sont soumis sur les points qui sont expressément prévus par la loi.
S’agissant de la participation aux acquêts, il est possible de prendre des dispositions destinées à assurer la pérennité de l’entreprise du conjoint en cas de décès ou de divorce.
Article 199 al. 1 CC
Ainsi, tout d’abord, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres (article 199 al. 1 CC). En effet, si le patrimoine professionnel de l’un des époux se trouve dans la masse des acquêts, au moment de la dissolution du régime, la dette qui en résulte pourrait compromettre la poursuite de l’activité professionnelle ou de l’entreprise, voire même la reprise de cette dernière par les descendants. Sans recourir au régime de la séparation de biens, il est possible de pallier ce problème en affectant le patrimoine lié à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise (meubles, immeubles, créances, etc.) aux biens propres du conjoint, par contrat de mariage.
L’article 199 CC vise principalement les professions indépendantes comme les avocats, les cabinets de médecin, les exploitations d’un domaine agricole ou d’une usine, les instituts de beauté, etc. Dans certains cas, un époux qui exerce une activité dépendante, salariée, pourra avoir des biens professionnels comme pour un voyageur de commerce. La notion « d’entreprise » est large et englobe, outre la raison individuelle, la société de personne et même la société de capitaux (société anonyme, société à responsabilité limitée), à condition que le conjoint entrepreneur exerce dans cette dernière une fonction dirigeante et qu’il détienne une partie importante du capital ou soit actionnaire majoritaire.
Les biens affectés sont composés de tous les éléments qui figurent à l’actif du bilan de la raison individuelle, ou de la totalité de la valeur des actions ou des parts sociales qui sont la propriété de l’époux entrepreneur, si l’entreprise est exploitée sous la forme d’une société de capitaux. Par ailleurs, cette transformation vaudra tant pour les biens actuels se trouvant déjà dans le patrimoine de l’un des époux au moment de la signature du contrat de mariage que pour des biens futurs. Ainsi, par exemple, si l’époux achète une nouvelle machine industrielle au moyen de fonds provenant de l’exploitation de l’entreprise, celle-ci constituera un bien propre.
A noter toutefois, que le produit du travail de l’entrepreneur (salaire, bonus, etc.) tombera en tout état de cause dans la masse des acquêts, il n’est pas possible de déroger à cette règle par la conclusion du contrat de mariage. Ainsi, est soustrait aux acquêts, en vertu de l’article 199 al. 1 CC, le produit du travail réinvesti dans l’entreprise uniquement.
Article 199 al. 2 CC
Il est également possible de prévoir (article 199 al. 2 CC) par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. La convention peut ne viser que certains revenus (par exemple les loyers de la villa apportée dans le mariage par l’un des conjoints) ou l’ensemble de ceux-ci, à l’exclusion de la rémunération du travail de l’époux en tant que chef d’entreprise, qui demeure, comme relevé ci-dessus, un acquêt. En effet, cette dernière doit rentrer dans les acquêts, même si l’entreprise est rattachée aux biens propres. Pour déterminer les montants qui doivent rester dans les acquêts, il conviendra de prendre en considération ce qui serait versé à un tiers s’il dirigeait l’entreprise (« juste rémunération » de l’entrepreneur).
Si les conjoints entendent adopter une telle règle, il est judicieux de prévoir les modalités de calcul dans le contrat de mariage. A cet égard, diverses possibilités sont envisageables comme une rémunération fixe et/ou variable, indexée ou non, un pourcentage du bénéfice, une comparaison avec les rémunérations pratiquées dans la branche ou l’utilisation d’éléments d’appréciation en faisant appel aux normes fiscales concernant la fixation de la rémunération convenable.
Il va sans dire que le recours à l’article 199 al. 1 CC ou à la combinaison des alinéas 1 et 2 constitue un avantage pour le conjoint entrepreneur et vise à protéger le patrimoine professionnel de celui-ci. Son entreprise, de même que les revenus de celle-ci, si cela a été prévu dans le contrat de mariage, seront soustraits aux acquêts. Le conjoint entrepreneur dispose ainsi d’un avantage considérable en cas de divorce : en effet, il n’aura à partager avec son conjoint, uniquement le bénéfice résultant de ses acquêts « privés », mais non pas la valeur de l’entreprise en tant que telle. Il aura droit, en revanche, à la moitié des acquêts de son conjoint.
En cas de prédécès du conjoint, la part au bénéfice de celui-ci résultant de la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès, ne tiendra également pas compte de la valeur de l’entreprise, permettant ainsi au conjoint entrepreneur survivant de ne pas partager la valeur de son entreprise avec ses cohéritiers. Idem, lorsque le conjoint entrepreneur décède en premier, l’enfant qui envisage de reprendre l’entreprise a intérêt à ce que celle-ci figure dans les biens propres du défunt, et non dans ses acquêts. Cela a toute son importance lorsque les cohéritiers du conjoint survivant ne sont pas des enfants communs du couple ou sont des membres de la deuxième parentèle ou des tiers. L’utilisation d’un contrat de mariage permet ainsi de faciliter la transmission de son entreprise à ses descendants, idéalement en étant accompagné de dispositions pour cause de mort (testament, pacte successoral) appropriées en conséquence.
A noter toutefois que si le conjoint non entrepreneur investit pendant le mariage dans l’entreprise de l’autre conjoint à partir de ses masses de biens (notamment ses biens propres), une récompense à hauteur au moins du niveau minimal du montant investi lui reviendra, ceci nonobstant le contrat de mariage passé en vertu de l’article 199 CC. Selon l’importance des investissements réalisés, la récompense peut signifier un fardeau difficile à supporter pour l’entreprise ou pour le conjoint entrepreneur.
Bien entendu, du fait de l’article 199 CC, l’autre conjoint se retrouve dans une position défavorable, surtout dans l’hypothèse où il dispose d’acquêts importants (dans cette situation une séparation de bien semble plus appropriée). Il est également possible de rééquilibrer les choses en combinant l’application de l’article 199 al. 1 CC au conjoint entrepreneur et celle de l’article 199 al. 2 CC à l’autre conjoint, notamment si ce dernier possède des biens propres d’une certaine importance. Seuls seraient alors partagés, à la dissolution, les acquêts « non professionnels » du conjoint entrepreneur et l’éventuel produit du travail de l’autre conjoint.
Un tel contrat est le plus souvent passé en cours de mariage, puisqu’il s’agit de transformer des acquêts en biens propres. Il est néanmoins tout à fait possible de prévoir des biens propres conventionnels par anticipation, lors de la conclusion du mariage. Alternativement à l’article 199 CC, il est possible soit d’adopter par contrat de mariage une séparation de bien, soit de modifier la réparation du bénéfice de liquidation (discuté ci-dessous).
Comme relevé ci-dessus, l’adoption d’un contrat de mariage selon l’article 199 CC est de nature à léser les intérêts des héritiers de l’autre époux, notamment la réserve héréditaire de ses enfants non-communs. Contrairement à ce que la loi prévoit en cas de modification conventionnelle de la répartition du bénéfice de l’union conjugale, elle est toutefois admise par la loi.
A noter enfin qu’il n’est jamais possible par contrat de mariage d’affecter des biens propres en acquêts, sauf en cas de révocation d’un contrat de mariage ayant fait usage de l’article 199 CC.
Articles 211 et 214 CC
Lors de la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale, soit au prix qu’un bon père de famille, à qui l’opération ne s’impose pas en urgence, pourrait raisonnablement retirer dans un délai convenable compte tenu des conditions générales du marché. En outre, alors que la composition de la masse des acquêts est arrêtée au jour de la dissolution, ces derniers sont en revanche estimés à leur valeur à l’époque de la clôture de la liquidation (par exemple le jour où le jugement est rendu en cas de procès).
Par contrat de mariage, il est possible pour les époux de modifier tant la valeur d’estimation des biens (sauf pour le calcul de la réserve héréditaire des enfants non communs) que le moment de l’estimation.
Articles 215 et 216 CC
Enfin, par contrat de mariage, les conjoints peuvent convenir d’une répartition des bénéfices autre que le partage par moitié.
Ainsi, il est possible par exemple :
- de renoncer totalement à la participation au bénéfice (cela s’approche de la séparation de biens mais s’en distingue néanmoins sur plusieurs aspects comme les récompenses, la participation du conjoint aux plus-values et la protection des réserves de certains héritiers) ;
- d’attribuer des quotes-parts, par exemple ¼ et ¾, avec ou sans montant minimal et/ou maximal ;
- de décider qu’un des époux recevra un montant ou un bien déterminé ;
- de prévoir une répartition différente du bénéfice selon les causes de dissolution du régime (décès ou divorce) ;
- de convenir que la convention ne profitera qu’au conjoint mais non à ses héritiers ;
- d’exclure un bien (par exemple l’entreprise) de la participation au bénéfice ;
- d’imposer des clauses de reprise, par exemple en cas de remariage.
En revanche, une participation conventionnelle au déficit n’est pas possible.
Il convient de noter que la modification de la répartition du bénéfice par contrat de mariage ne doit pas nuire à la réserve héréditaire des enfants non communs et de leurs descendants (article 216 al. 2 CC). En effet, dans la mesure où la liquidation du régime matrimonial précède celle de la succession, il est possible par contrat de mariage, de rendre illusoires les réserves héréditaires en diminuant la masse successorale. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’essentiel des biens à partager consiste en des acquêts du de cujus et qu’il est convenu d’attribuer ces derniers en intégralité au conjoint survivant, les descendants ne recevant au final que des montants très limités. Lorsque les époux n’ont que des descendants communs, une attribution de plus de la moitié du bénéfice au conjoint survivant ne devrait pas avoir de conséquences fâcheuses puisqu’au final, ces derniers devraient quand même hériter de leur autre parent. En revanche, en présence d’enfants d’un premier lit, la situation est toute différente puisqu’ils n’hériteront jamais.
Par ailleurs, dans la mesure où le contrat de mariage modifiant la répartition du bénéfice vise à favoriser l’un des conjoints, la loi exige une mention expresse dans l’acte si les époux entendent maintenir cette répartition conventionnelle en cas de divorce, de séparation de corps, d’annulation du mariage ou de séparation de biens judiciaire.
Enfin, un mécanisme de protection des créanciers est prévu par la loi afin d’éviter que les époux ne lèsent les droits de ceux-ci par l’adoption de règles conventionnelles à leur détriment (récompenses, réunions, etc.). Il se traduit par un maintien de la garantie existante (les créanciers conservent la possibilité d’agir sur les biens qui constituaient leur garantie, comme si ceux-ci n’avaient pas changé de statut ou de titulaire) et une responsabilité personnelle subsidiaire de l’époux attributaire.
Quelles sont les alternatives à l’application de l’article 199 CC par contrat de mariage ?
Comme déjà relevé brièvement, il existe deux alternatives à l’article 199 CC. La séparation de biens comme exposée ci-dessous et la modification de la répartition du bénéfice (article 216 CC). La première solution présente l’avantage de la simplicité dans la mesure où les patrimoines des conjoints restent rigoureusement distincts. Toutefois, elle n’est intéressante que si elle est adoptée au moment ou peu après la conclusion du mariage. En effet, si les époux adoptent ce régime en cours de mariage, la liquidation du régime matrimonial antérieur peut déboucher sur la reconnaissance au conjoint d’une créance de participation importante, dont le règlement peut ici également mettre en péril l’existence de l’entreprise. En outre, elle est utile si le conjoint du cocontractant dispose lui-même de biens et de revenus.
S’agissant de la modification de la répartition du bénéfice, il est important de tenir compte que la liberté contractuelle des conjoints n’est pas entière. En effet, contrairement à l’article 199 CC, en présence d’enfants non communs, les réserves de ceux-ci sont protégées par l’article 216 al. 2 CC. Par ailleurs, la modification de la participation au bénéfice ne s’applique pas en cas de divorce, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire (art. 217 al. 2 CC).
Peut-on régler d’autres aspects dans un contrat de mariage ?
Dans une perspective plus large que celle développée ci-avant, il est possible de convenir par contrat de mariage d’autres aspects touchant de près ou de loin au régime matrimonial.
Tout d’abord, les conjoints peuvent décider d’exclure ou de convenir d’une autre répartition de la part à la plus-value d’un bien déterminé. Bien qu’il s’agisse là d’une modification du régime matrimonial, seule la forme écrite est exigée. En outre, dans la mesure où il ne s’agit que de la renonciation à une expectative par avance, les réserves héréditaires ne sont pas concernées.
Par ailleurs, un époux peut consentir par contrat de mariage à une libéralité faite par son conjoint et normalement soumise à réunion (article 208 al. 1 ch.1 CC), par exemple, une avance d’hoirie, une donation à une œuvre caritative, etc.. Il est également possible de se mettre d’accord sur la reprise des biens de chacun des époux lors de la dissolution du régime ou de renoncer l’attribution entière d’un bien en copropriété si l’un des conjoints justifie d’un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser l’autre (article 205 CC).
De même, les époux peuvent convenir des modalités de paiement ou de garanties de la créance de participation au bénéfice (article 218 CC) ou encore renoncer aux facultés accordées par l’article 219 CC, à savoir l’attribution du logement et du mobilier de ménage au conjoint bénéficiaire en compensation de sa créance au bénéfice contre son époux.
Autre point important, les époux peuvent se mettre d’accord sur des éléments qui concernent les effets généraux du mariage, comme par exemple la répartition des tâches et la charge de l’entretien au sein de la famille (articles 159 et 163 CC), les montants versés à l’époux au foyer qui voue ses soins au ménage ou aux enfants, ou qui aide l’autre dans sa profession ou son entreprise et laissé à sa libre disposition (article 164), ou encore le mandat de représenter l’union conjugale au-delà des besoins courants de la famille (article 166). Bien que nous recommandions de signer ces accords par devant notaire, ils ne sont soumis à aucune forme particulière et peuvent figurer ou être rappelés dans le contrat de mariage portant sur le régime matrimonial. Ces conventions ne doivent toutefois pas contredire les règles du régime matrimonial.
Les conjoints peuvent enfin également régler par anticipation les suites patrimoniales d’un éventuel divorce (voir ci-dessous). Il est ainsi possible de conclure en même temps un contrat de mariage portant sur le régime matrimonial (en la forme authentique) et une convention anticipée sur les effets du divorce (soumise à aucune forme particulière). A la différence du contrat de mariage qui demeure en toutes circonstances indépendant (le choix du régime matrimonial échappe au moment du divorce à tout pouvoir d’examen du juge même s’il apparaît manifestement inéquitable pour l’une des parties), la convention de divorce devra être ratifiée par le tribunal, le moment venu si une telle éventualité se produit.
Bien entendu, tous ces accords doivent rester dans les limites admissibles relatives à la protection de la personnalité (articles 27 et suivants CC). Ainsi, il serait exclu de prévoir par contrat de mariage, le nombre de relations intimes que le couple devrait entretenir hebdomadairement. Ceci constituerait un engagement excessif non acceptable au regard du droit suisse.
Par contrat de mariage, il est possible de régler non seulement les aspects liés au régime matrimonial des conjoints mais également d’autres points concernant par exemple la vie des époux durant le mariage, voire même les effets d’un hypothétique divorce par anticipation. Les formes à respecter pour la conclusion de ces accords divergent toutefois.
Les conventions réglant par anticipation les effets du divorce sont-elles admises en droit suisse ?
Bien que le législateur n’ait pas prévu cette possibilité, les conventions anticipées de divorce sont admises par les tribunaux. On entend par-là, tous les accords sur les effets du divorce conclus avant le mariage, au moment de celui-ci ou pendant la durée de l’union conjugale sans qu’une procédure de séparation ne soit pendante ou imminente.
L’intérêt porté à ce type de contrat de mariage ne cesse de croître : en effet, de nos jours il n’est pas rare de se marier en secondes voire en troisièmes noces et beaucoup de couples, cherchant de ne pas répéter les erreurs du passé, désirent s’assurer une certaine prévisibilité par voie conventionnelle. Par ailleurs, lorsqu’il existe une grande disparité d’âge ou de fortune entre les époux, il peut être souhaitable de protéger les intérêts du conjoint âgé fortuné ou au contraire d’assurer une certaine sécurité financière au partenaire plus jeune.
La plus souvent, une telle convention portera sur les effets patrimoniaux du divorce (versement d’une pension, partage de la prévoyance professionnelle, etc.) mais il est également possible de prévoir des règles sur les droits parentaux (garde des enfants, scolarité, droit de visite, etc.).
Comme relevé ci-dessus, et encore récemment rappelé par le Tribunal fédéral, le CPC impose à son article 279 que toutes les conventions de divorce soient ratifiées par le juge, peu importe le moment de leur conclusion (et donc y compris avant le mariage) et le type de procédure (divorce sur requête commune des époux ou demande unilatérale de l’un d’eux). Celui-ci doit s’assurer que l’accord a été conclu après mûre réflexion et du plein gré des conjoints, qu’il est clair et complet et enfin qu’il n’est pas manifestement inéquitable pour l’une des parties.
Une convention sur les effets du divorce sera manifestement inéquitable lorsqu’il existe une différence immédiatement reconnaissable (« eine eklatante, sofort erkennbare Differenz ») par rapport au jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention, sans que des considérations d’équité ne justifient la solution, s’écartant ainsi de la réglementation légale selon la volonté des parties. Il n’est donc pas suffisant que le juge eût statué différemment si les époux n’avaient pas conclu de contrat de mariage. Il ressort de ce qui précède que le juge refusera en principe de ratifier le moment venu une convention anticipée de divorce si les circonstances ont sensiblement évoluées depuis la conclusion du contrat de mariage et que les époux ne pouvaient pas entrevoir un tel changement (par exemple, la fortune de l’un d’eux a drastiquement diminuée, l’un des conjoints a pu se constituer une prévoyance importante, etc.). De manière générale, la favorisation trop grande de l’un des époux sera empêchée.
En guise de conclusion, il convient de retenir que la portée d’une convention anticipée de divorce demeure limitée puisqu’elle peut être remise en question lors du divorce. Toutefois, elle permet dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge, de planifier dans une certaine mesure les conséquences d’un divorce à l’avance. Il sera toutefois opportun d’établir clairement dans le contrat de mariage les motifs qui poussent les parties à conclure un tel accord ainsi que décrire leur situation patrimoniale respective à ce moment et à la documenter. Cela facilitera le travail du juge, au stade éventuel de sa ratification future ou de sa modification nécessaire.
A noter encore que le partage de la prévoyance professionnelle échappe largement à la libre disposition des époux. Ceux-ci ont néanmoins la faculté de se mettre d’accord sur ce point, mais la solution adoptée fera l’objet d’un examen approfondi par le juge (article 280 CPC, vérification en sus de la légalité et de la faisabilité du partage, qu’une prévoyance professionnelle vieillesse et invalidité adéquate reste assurée en cas de renonciation à tout ou partie du partage par l’un des époux). Enfin, le tribunal n’est jamais lié par l’accord des parents s’agissant des questions relatives aux enfants mineurs. Il doit toujours vérifier que la convention est conforme aux intérêts supérieurs de l’enfant. L’enfant a lui des droits dans la procédure, notamment de pouvoir être entendu par le juge dès l’âge de 6 ans.
Qu’en est-il de l’établissement d’un inventaire des biens dans le cadre du contrat de mariage ?
Nous recommandons aux époux de confectionner lors de l’adoption du régime matrimonial un inventaire des biens afin de constater la propriété des biens respective de leurs biens et l’appartenance de ceux-ci à une masse matrimoniale donnée. Il est possible d’établir cet inventaire sous seing privé mais afin de renforcer la valeur probante de celui-ci, il peut être opportun de confectionner un tel document par acte authentique (sous réserve d’éventuelles conséquences fiscales comme le paiement de droits d’enregistrement). La loi prévoit d’ailleurs cette faculté à chacun des époux en tout temps (article 195a CC). Le notaire se contentera de consigner les déclarations des parties concernant la propriété de leurs biens et l’appartenance éventuelle à une masse, mais ne vérifiera pas l’exactitude des indications fournies. La forme authentique consiste ainsi uniquement dans le constat officiel des déclarations concordantes des parties. En cas de désaccord entre les conjoints, il conviendra de saisir le juge.
En outre, l’exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse.
Enfin, il sied de relever qu’une estimation des biens dans l’inventaire est possible mais n’est pas prévue par la loi et ne bénéficiera ainsi pas de la présomption légale d’exactitude.
Comment fonctionne le régime matrimonial de la séparation de biens ?
Par contrat de mariage, les conjoints peuvent opter pour le régime matrimonial de la séparation de biens. Celui-ci est régi par les articles 247 à 251 CC. Comme son nom l’indique, la séparation de biens implique évidemment que chaque époux reste propriétaire de la totalité de ses biens durant toute la durée du mariage (à l’instar de la participation aux acquêts), mais surtout qu’aucun transfert de valeur ne s’opère du patrimoine d’un époux dans le patrimoine de l’autre. En outre, chacun possède, administre, dispose et jouit de son patrimoine en toute indépendance (sous réserve des effets généraux du mariage, comme les articles 159 al. 3 CC, 163 CC ou 169 CC) et bénéficie seul de la plus-value de ses biens et assume seul leur moins-value. Chaque conjoint demeure également seul responsable de ses dettes personnelles (sous réserve ici également des effets généraux du mariage, article 166 al. 3 CC).
En cas de divorce ou de décès, il n’y a aucun partage de biens entre les époux, à l’exception du 2ème pilier (prévoyance professionnelle) qui échappe aux règles sur le régime matrimonial de la séparation de biens.
La séparation de biens présente l’avantage de sa clarté et consacre l’autonomie des époux. Par ailleurs, en cas d’endettement de l’un d’eux, son conjoint n’aura pas à verser la moitié de ce qu’il a gagné pendant le mariage aux créanciers de l’époux débiteur lors de la dissolution du régime. En revanche, si ce régime convient bien lorsque les deux conjoints travaillent, il n’est pas du tout favorable si l’un des époux renonce à une activité lucrative afin de se consacrer à la famille. Ce dernier ne pourra ainsi pas épargner le fruit de son travail et ne recevra aucune part de son conjoint à la fin du régime. Une contribution d’entretien appropriée et fixée par le juge permettra éventuellement de compenser ce déséquilibre.
A noter encore que la séparation de biens peut être légale notamment en cas de faillite d’un époux soumis à la communauté de biens ou de séparation de corps ou encore imposée par le juge à la requête d’un époux pour de justes motifs.
Quelles sont les règles de la communauté de biens ?
La communauté de biens est le troisième régime matrimonial reconnu en droit suisse. Dans la pratique, il est rare que ce régime soit choisi, raison pour laquelle nous le présenterons de manière très succincte.
La communauté de biens est créée par contrat de mariage passé par devant notaire et comprend trois masses distinctes : les biens communs et les biens propres de chaque époux. Les premiers appartiennent indivisément aux époux qui forment une collectivité en main commune, y compris vis-à-vis des tiers. En d’autres termes, ils sont propriétaires communs des choses et des créances et possèdent chacun d’eux les mêmes droits sur celles-ci, même si l’un d’eux n’a rien apporté. En revanche, la masse commune ne comprend que des actifs et non les dettes des époux. Les biens communs ne font que garantir celles-ci. Tout bien est présumé commun s’il n’est pas prouvé qu’il est bien propre de l’un ou de l’autre des époux.
Les époux sont libres de déterminer la composition des masses ; ainsi dans sa forme la plus large (communauté universelle), deviennent des biens communs, tous les biens propres du régime de la participation aux acquêts (notamment ceux qui appartiennent aux époux au début du régime ou qui leur échoient par succession ou a quelque autre titre gratuit), ainsi que les biens qui seraient des acquêts dans le régime ordinaire (produit du travail, etc.), à l’exclusion :
- des effets exclusivement affectés à l’usage personnel d’un époux, même s’ils ont été acquis à titre onéreux (par exemple du matériel de sport) ainsi que les créances en réparation d’un tort moral et leur remploi ;
- des attributions à titre gratuit faites à un époux et comportant la clause que les biens, objets de la libéralité seront des biens propres ;
- lors de la dissolution du régime, les sommes en capital versées à un époux par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale et des dommages-intérêts résultant d’une incapacité de travail, à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux.
Dans sa forme plus étroite, les conjoints peuvent réduire les biens communs à ceux qui ont été acquis à titre onéreux pendant le mariage (on parle alors de communauté d’acquêts) ou exclure d’autres biens convenus par contrat de mariage (autres communautés réduites), par exemple les immeubles, le produit du travail d’un époux ou encore les biens d’un époux qui servent à l’exercice de sa profession ou à l’exploitation de son entreprise.
Concernant la gestion du patrimoine, les époux gèrent les biens communs dans l’intérêt de l’union conjugale. Dans les limites de l’administration ordinaire (à savoir les actes les moins importants qu’il est usuel ou habituel, sinon fréquent, d’accomplir et qui ne font pas courir de risques particuliers au conjoint), chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs. Au-delà de l’administration ordinaire (par exemple la vente d’un bien immobilier, la constitution de droits de gage, la liquidation d’une entreprise, etc.), les époux ne peuvent engager la communauté et disposer des biens communs que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre. Ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins que ceux-ci ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné. Certaines règles spécifiques sont en outre prévues pour le conjoint qui exerce seul une profession ou exploite seul une entreprise, ainsi que dans l’hypothèse de la répudiation ou de l’acceptation d’une succession. Chaque époux a en revanche l’administration et la disposition de ses biens propres.
S’agissant des dettes envers les tiers, les règles ordinaires du droit civil ou administratif désignent qui est le débiteur de celles-ci (par exemple l’article 166 al. 3 CC ou 193 al. 2 CC). En revanche, la question de savoir quels biens répondent des dettes fait l’objet de dispositions particulières. Ainsi, la loi fait une distinction entre les dettes générales dont un époux répond à la fois sur ses biens propres et sur les biens communs (par exemple les dettes qu’un époux a contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs) et les autres dettes (dites « dettes propres », par exemple les dettes de chaque époux antérieures au mariage ou au régime, celles grevant une succession échue à l’un des conjoints, etc.) dont l’un des conjoints répond sur ses biens propres et la moitié de la valeur des biens communs.
S’agissant des causes de dissolution du régime matrimonial, elles sont les mêmes que pour le régime ordinaire de la participation aux acquêts (décès, divorce, etc.), avec pour seule spécificité que la faillite de l’un des conjoints entraîne de plein droit la dissolution du régime.
Lorsque la communauté de biens prend fin par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime, elle se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers. A noter que par contrat de mariage les époux peuvent convenir d’un partage des biens communs autre que par moitié, à condition de ne pas porter atteinte à la réserve des descendants.
En cas de divorce par contre, chacun des époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Les biens communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
S’agissant du partage proprement dit, les parties sont libres de décider comme elles l’entendent. A défaut d’accord, des règles spécifiques s’appliquent sur certains biens comme pour le logement familial ou le mobilier de ménage.