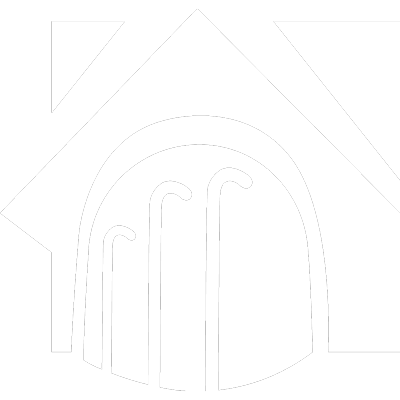Introduction
Le 22 décembre 2023, le Parlement suisse a adopté la révision du chapitre 6 sur les successions, contenu dans la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).
Pour rappel, ledit chapitre, soit les articles 86 à 96 LDIP, règle la compétence des autorités suisses et le droit applicable par ces dernières dans le cadre d’une succession internationale, de même que la reconnaissance des actes juridiques étrangers en la matière.
Après 10 ans de discussions, la nouvelle mouture vise un double objectif : d’une part, compléter et clarifier certains points développés par la jurisprudence et la doctrine et d’autre part, harmoniser, à tout le moins partiellement, le droit suisse avec le règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (ci-après « le règlement européen »).
Pour rappel, le règlement européen est entré en vigueur le 16 août 2012 et s’applique à tous les États de l’Union européenne à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni (qui est entretemps sorti de l’Union européenne) et de l’Irlande, et vaut pour la succession des personnes décédées après le 16 août 2015. Le règlement européen a essentiellement le même objet que le chapitre 6 de la LDIP et contient une règlementation semblable, mais diverge sur plusieurs points pouvant donner lieu à des difficultés, notamment dit de « conflits de compétence positifs ».
A titre d’exemple, d’après le règlement européen, les autorités de l’État (membre) national du défunt ou de l’État (membre) où sont situés une partie des biens ont une compétence subsidiaire lorsque la personne concernée avait sa résidence habituelle au moment de son décès dans un État non soumis au règlement européen (État tiers), tandis que la LDIP pose comme condition que les autorités étrangères ne s’occupent pas de la succession. Ainsi, un ressortissant français habitant en Suisse, laissant des biens en France et en Suisse verra du point de vue suisse fonder la compétence des autorités suisses pour l’ensemble de la succession. En revanche, en vertu du règlement européen (art. 20), il existe aussi une compétence globale en France, dont le défunt avait la nationalité et où il y a laissé des biens successoraux. Si les deux états se déclarent compétents, il risque d’en résulter des décisions contradictoires non souhaitables.
Ainsi, la nouvelle loi helvétique contient nombre de dispositions visant à éviter les conflits de compétence. A titre d’exemple, les personnes ayant une nationalité étrangère peuvent dorénavant prendre en compte une éventuelle revendication de compétence de l’État national en question en soumettant aux autorités de ce dernier les biens qui y sont situés, voire l’ensemble de leur succession. Les nouvelles dispositions cherchent également d’harmoniser le droit applicable. Par exemple, la nLDIP autorise sans restriction aux ressortissants suisses et étrangers, doubles nationaux compris, de choisir le droit de leur ou d’un de leurs États nationaux. Il suffit qu’ils possèdent la nationalité en question au moment de l’établissement du testament ou au moment du décès. Enfin, la loi clarifie certains points comme par exemple le droit applicable au statut juridique de l’exécuteur testamentaire et de l’administrateur d’une succession.
L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions a été fixée au 1er janvier 2025.
Nous vous présentons ci-après les principaux changements, étant précisé que le nouveau droit continue d’appliquer le principe de l’unité de la succession (même compétence et même droit applicable pour l’ensemble de la succession) et maintient le dernier domicile du défunt comme critère de rattachement principal.
I. La succession du défunt domicilié en Suisse
A. La compétence des autorités pour régler la succession
1. Selon l’ancien droit
Lorsqu’une personne, suisse ou étrangère, domiciliée en Suisse décède, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de sa succession et connaître des litiges successoraux. Si le de cujus laisse des immeubles situés à l’étranger, les autorités de l’État concerné peuvent avoir la compétence exclusive d’en régler la succession (art. 86 LDIP).
2. D’après le nouveau droit
Le nouveau régime n’apporte aucune modification à l’article 86 LDIP, les autorités suisses du dernier domicile du défunt demeurant ainsi compétente pour régler l’ensemble de la succession, sous réserve de la compétence exclusive revendiquée par un État étranger dans lequel se trouve un immeuble successoral.
En revanche, cette compétence est dorénavant exclue si le défunt a soumis, par un testament ou un pacte successoral, la totalité ou une partie de sa succession à la compétence d’un État national étranger et dans la mesure où les autorités de cet État s’en occupent. Le de cujus doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès (article 88b nLDIP).
Cette nouvelle règle permet d’éviter un conflit de compétence positif avec le règlement européen si la personne décédée avait son dernier domicile en Suisse. En effet, son article 10 par. 1 let. a, prévoit, pour la succession des ressortissants d’un État membre, la compétence de cet État dès lors qu’une partie de la succession se trouve sur son territoire. La prorogation de for rendue possible par l’article 88b nLDIP permet d’éviter pareil conflit : la Suisse renonce à sa compétence pour le cas où le disposant soumet sa succession à la compétence des autorités de son État national. A noter qu’une élection de droit en faveur d’un État national étranger n’emporte pas la présomption que les autorités de cet État sont aussi compétentes. Le but est ici d’écarter le risque que les autorités de cet État n’appliquent un autre droit que celui qu’a choisi le disposant et que l’élection de droit ne soit sans effet.
Aussi, la nouvelle loi autorise une prorogation de for partielle. Le disposant peut la limiter à certains biens, par exemple à ceux qui sont situés dans l’État national étranger.
Par ailleurs, à la différence de l’ancien régime concernant l’élection du droit (art. 90, al. 2 LDIP, voir ci-dessous), le pouvoir de soumettre la succession à la compétence d’un État national étranger est maintenant aussi accordé aux Suisses ayant une ou plusieurs autres nationalités.
A noter que la prorogation de for est également valable lorsque le disposant a perdu la nationalité en question avant son décès ou si la personne n’obtient celle-ci qu’après avoir disposé par testament ou pacte successoral.
Enfin, l’article 88b al. 2 nLDIP prévoit que les citoyens peuvent exclure la compétence suisse sur les immeubles situés à l’étranger au bénéfice de l’État en question. Il n’est toutefois dérogé à la compétence suisse que si l’État de situation de l’immeuble s’en occupe effectivement. Cette disposition permet là-aussi d’éviter un risque de conflits de compétence positifs puisque selon le règlement européen (art. 10, par. 2), l’État dans lequel sont situés des biens successoraux est en principe compétent pour statuer sur ces biens.
En résumé :
- La règle par défaut attribue la compétence des autorités suisses du dernier domicile du défunt ;
- Le de cujus peut soumettre sa succession à la compétence d’un État national étranger.
- Des règles spéciales peuvent s’appliquer pour les immeubles situés à l’étranger.
B. Le droit applicable
1. Selon l’ancien droit
La succession d’une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP).
Toutefois, une personne étrangère peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l’un des états dont il a la nationalité. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n’avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse (art. 90 al. 2 LDIP).
2. D’après le nouveau droit
Aucune modification n’est apportée à l’article 90 al. 1 LDIP. A noter que la nLDIP maintient le dernier domicile comme critère de rattachement et ne se réfère pas à la dernière résidence habituelle comme le fait le règlement européen.
En revanche, en matière d’élection de droit, il est dorénavant prévu qu’une personne, et non plus seulement un étranger, peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux. Le disposant doit avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Les Suisses ne peuvent déroger aux dispositions du droit suisse sur la quotité disponible (art. 91 al. 1 nLDIP).
Il ressort de cette nouvelle disposition que l’élection d’un droit national étranger est dorénavant aussi possible pour les Suisses ayant plusieurs nationalités, mais ces derniers n’ont toutefois pas la possibilité de déroger aux règles suisses sur la réserve héréditaire ; La nouvelle loi suit donc sur ce point l’article 22 du règlement européen, selon lequel une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité.
En résumé :
- Par défaut, le droit suisse est applicable aux personnes dont le dernier domicile était en Suisse ;
- Le défunt peut soumettre sa succession au droit d’un État national étranger.
- En pareil élection de droit, les Suisses doivent en tout état de cause respecter les règles sur la quotité disponible.
II. La succession du défunt suisse domicilié à l’étranger
A. La compétence des autorités pour régler la succession
1. D’après l’ancien droit
Les autorités suisses ne sont en principe pas compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès, sauf dans les cas suivants :
- si les autorités étrangères ne s’en occupent pas ; ou
- si, par un testament ou un pacte successoral, il soumet à la compétence ou au droit suisse l’ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse (professio juris).
Si l’une ou l’autre des ces conditions est remplies, les autorités du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession (art. 87 LDIP).
2. Selon le nouveau droit
La nouvelle loi reprend les mêmes concepts mais apporte les précisions bienvenues suivantes :
En premier lieu, les autorités du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas. Afin d’éviter des conflits de compétence, elles peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt, de l’État de sa dernière résidence habituelle, ou encore, dans le cas de biens successoraux isolés, de l’État du lieu de situation s’occupent de la succession (art. 87 al. 1 nLDIP).
Il ressort de la formulation adoptée que seul l’État du dernier domicile entre en ligne de compte, ceci afin d’éviter aux autorités suisses en matière de succession qu’elles fassent des recherches juridiques complexes pour déterminer tous les États dont les décisions pourraient être reconnues en Suisse et d’épargner aux héritiers la lourde tâche de contacter tous ces États avant de pouvoir établir la compétence des autorités suisses. En même temps, les autorités suisses ont la possibilité d’éviter des conflits de compétence positifs dans certaines situations énumérées à la deuxième phrase de l’article 87 al. 1 nLDIP.
En second lieu, les autorités du lieu d’origine sont toujours compétentes lorsque, par un testament ou un pacte successoral, un Suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger soumet à la compétence des autorités suisses ou, pour autant qu’il n’ait pas fait de réserve quant à la compétence, au droit suisse l’ensemble de sa succession ou certains biens se trouvant en Suisse (art. 87 al. 2 nLDIP).
Dans le cas où un Suisse de l’étranger choisit la Suisse comme for, il existe un risque de conflit de compétence positif. Tel est le cas par exemple si le disposant avait son dernier lieu de résidence habituelle dans un État appliquant le règlement européen ou qu’il en avait la nationalité et qu’il y a laissé des biens. La nouvelle loi supprime la présomption légale de l’ancienne disposition. Ainsi, lorsque la succession est soumise au droit suisse, la présomption d’une prorogation de for parallèle subsiste. Cette présomption se justifie dans la mesure où elle devrait généralement correspondre à l’intention du disposant. Elle assure en outre la convergence entre compétence et droit applicable. La nouveauté est que le disposant a maintenant la possibilité de renverser cette présomption en adoptant une clause contraire, c’est-à-dire de statuer qu’il ne choisit pas la compétence des autorités de l’État dont il a choisi le droit. Cette solution permet ainsi d’éviter les risques de conflit de compétence positif découlant de l’élection de droit du de cujus.
Par ailleurs, le disposant peut soumettre à la compétence suisse non seulement l’ensemble de sa succession ou de ses biens en Suisse, mais aussi une partie de ces derniers. A titre d’exemple, par le jeu des articles 87 al. 2 et 88b al. 2 nLDIP les Suisses sont libres de soumettre leur succession à la compétence des autorités de leur État national (soit la Suisse) et faire une réserve en faveur de l’État de situation pour leurs immeubles.
A noter encore que l’article 87 al. 2 nLDIP englobe le cas où le défunt n’a obtenu la nationalité suisse qu’après avoir disposé. Elle ne s’applique en revanche pas au cas inverse où le disposant perd ultérieurement la nationalité suisse.
Enfin, les Suisses binationaux domiciliés à l’étranger ont bien entendu toujours la possibilité de soumettre leur succession à la compétence des autorités de leur autre État national (prorogation de for) aux conditions de l’article 88b nLDIP (voir ci-dessus).
En résumé :
- Par défaut, la règle prévoit la compétence des autorités suisses si celles de l’État du dernier domicile ne s’occupent pas de la succession ;
- Idem, si le défunt fait une élection de for ; ou
- S’il choisit le droit suisse pour régler sa succession, sauf s’il adopte une clause contraire de compétence dans le testament ou le pacte successoral ;
- Enfin, le de cujus a la possibilité de soumettre sa succession à la compétence des autorités de son État national (autre que la Suisse), dans la mesure où les autorités de cet État s’en occupent ;
- Des règles spéciales peuvent s’appliquer pour les immeubles situés à l’étranger.
B. Le droit applicable
1. Selon l’ancien droit
Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l’article 87 LDIP, la succession d’un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n’ait réservé expressément le droit de son dernier domicile (art. 91 al. 2 LDIP).
2. D’après le nouveau droit
L’article 90 al. 3 nLDIP reprend en partie la disposition antérieure et prévoit que la succession est régie par le droit suisse dans la mesure où les autorités suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes en vertu de l’article 87 al. 1, à savoir en cas de succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès et si les autorités de l’État du domicile ne s’en occupent pas (voir ci-dessus).
Comme déjà relevé, l’article 91 nLDIP prévoit qu’un Suisse peut soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit d’un de ses États nationaux (à condition d’avoir eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès). Ainsi, il ressort de cette disposition que l’élection d’un droit national étranger, par exemple suisse, est aussi possible dans le cas où le disposant avait son dernier domicile à l’étranger et où le droit de cet État n’admet pas cette élection de droit. En revanche, cette possibilité présente l’inconvénient de permettre que le droit applicable à la part de la succession réglée en Suisse soit un droit différent de celui qui est appliqué à l’étranger au reste de la succession.
Attention toutefois, à l’instar du règlement européen, ni les Suisses, ni les ressortissants étrangers ne peuvent soumettre leur succession à l’État de leur dernier domicile si les règles de conflit de loi de cet État ne le permettent pas. Il s’agit là d’une différence par rapport à l’ancien article 91 al. 2 LDIP (in fine) qui l’autorisait pour les Suisses.
On relèvera aussi que lorsqu’un Suisse a soumis la totalité ou une partie de sa succession à la compétence des autorités suisses (art. 87, al. 2 nLDIP), les biens concernés sont, à défaut de dispositions contraires, présumés soumis au droit suisse (art. 91 al. 2 nLDIP). Il sied de relever que le de cujus qui n’a pas l’intention d’élire le droit suisse a seulement à déclarer que son testament ou son pacte successoral ne touche pas au droit applicable en vertu de la loi. Il n’a pas à procéder à l’élection d’un droit en particulier (approche opt-out).
A noter encore que l’élection de droit porte en principe sur l’ensemble de la succession. Il est toutefois possible de faire une élection de droit partielle prévoyant l’application du droit suisse pour les biens situés en Suisse (art. 91 al. 3 nLDIP) lorsqu’il existe une compétence correspondante des autorités suisses. Comme déjà examiné ci-dessus, cette dernière peut découler d’une prorogation parallèle du for par le disposant ou du fait qu’il n’a prévu aucune clause dans son élection de droit qui réserve la compétence (art. 87 al. 2 nLDIP).
En résumé :
- Le droit suisse est applicable si les autorités suisses du lieu d’origine du défunt sont compétentes, à savoir si celles de l’État du domicile ne s’occupent pas de la succession ;
- Les Suisses peuvent soumettre tout ou partie de leur succession au droit de leur état national (suisse ou autre) ; tel sera le cas en cas d’élection de droit expresse ou si le de cujus a soumis sa succession à la compétence des autorités suisses (sauf opting out).
III. La succession du défunt étranger domicilié à l’étranger avec des biens en Suisse
A. La compétence des autorités pour régler la succession
1. D’après l’ancien droit
L’article 88 LDIP stipule que si un étranger, domicilié à l’étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. S’il y a des biens en différents lieux, l’autorité suisse saisie la première est compétente.
2. Selon le nouveau droit
La nouvelle disposition (art. 88 nLDIP) remplace les termes « les autorités étrangères » par « les autorités de l’État du domicile » et ajoute la phrase suivante :
« Afin d’éviter des conflits de compétence, elles [les autorités judiciaires ou administratives suisses] peuvent décliner leur compétence si les autorités d’un État national étranger du défunt ou de l’État de sa dernière résidence habituelle s’occupent de la succession. »
Par ailleurs, comme pour les autres cas mentionnés ci-dessus, la Suisse renonce à sa compétence pour le cas où le disposant soumet sa succession à la compétence des autorités de son État national (art. 88b al. 1 nLDIP).
En résumé :
- Il existe un for suisse subsidiaire pour les biens successoraux situés en Suisse ;
- Mais le de cujus peut soumettre sa succession à la compétence d’un État national étranger.
B. Le droit applicable
1. Selon l’ancien droit
La succession d’une personne qui a eu son dernier domicile à l’étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP).
2. D’après le nouveau droit
Le nouveau régime reprend mots pour mots l’ancien article 91 al. 1 LDIP. Ainsi, la loi renvoie, dans le cas où le défunt avait son dernier domicile à l’étranger, non pas au droit successoral de l’État de domicile, mais à son droit international privé (règles de conflits de lois). Le droit successoral appliqué est donc celui que les règles de conflits de lois de l’État de domicile désignent.
Toutefois, afin d’éviter le problème du double renvoi, l’article 90 al. 2 nLDIP rajoute une phrase stipulant que « si ces règles renvoient au droit international privé suisse, le droit successoral matériel de l’État du dernier domicile du défunt est applicable. »
Pour rappel, le renvoi est un concept en droit international privé qui se produit lorsque la règle de conflit de loi d’un état renvoie à une autre règle de conflit de lois d’un autre état pour déterminer la loi applicable à une situation internationale.
Il y a double renvoi lorsque le règle de conflit de lois d’un état renvoie à la loi d’un autre État pour résoudre un conflit de lois, et que la règle de conflit de lois de l’autre état renvoie à nouveau à la loi de l’État d’origine. Ainsi pour illustrer, si la règle de conflit de lois suisse en matière de succession (art. 90 al. 2 nLDIP) renvoie aux règles de conflits du dernier domicile du défunt mais que celles-ci renvoient par exemple elles-mêmes aux règles de conflits de lois suisses correspondant au lieu de situation des biens en Suisse, il se produit un aller-retour sans fin entre les législations des deux états.
La nouvelle loi permet de casser ce ping-pong en renvoyant non plus au droit international privé étranger mais au droit matériel de l’État concerné, ceci dans les cas où le droit international privé étranger renverrait aux règles de conflits suisses.
Enfin, comme déjà détaillé ci-dessus, l’élection de droit en faveur de l’un de ses droits nationaux est désormais possible (art. 91 al. 1 nLDIP), à la condition d’avoir possédé le passeport national en question au moment de disposer ou au moment de son décès. En revanche, s’agissant des personnes domiciliées à l’étranger, cette possibilité présente l’inconvénient de permettre que le droit applicable à la part de la succession réglée en Suisse soit un droit différent de celui qui est appliqué à l’étranger au reste de la succession. En outre, l’élection de droit en faveur de l’État de son dernier domicile n’est pas possible si les règles de conflit de loi de cet État ne le permettent pas.
En résumé :
- En présence de biens en Suisse, la nLDIP renvoie aux règles de droit international privé de l’État dans lequel le défunt était domicilié en dernier ;
- En cas de double renvoi, le droit suisse renvoie au droit matériel du dernier domicile du de cujus ;
- Le défunt peut toujours élire l’application de son droit national.
IV. Autres nouveautés liées à la compétence et au droit applicable
S’agissant de la compétence, le nouveau droit précise explicitement que les tribunaux et les autorités suisses ne sont compétentes que lorsqu’aucune action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties dans un État dont la Suisse reconnaît la compétence (exception de litispendance, art. 9 LDIP et 88a nLDIP). Cette règle s’applique également au règlement non litigieux de la succession dans son ensemble (par exemple la demande d’émission du certificat d’héritiers) et pas uniquement aux procédures d’action.
Enfin, le nouvel article 89 LDIP prévoit que si le défunt laisse des biens en Suisse et que les article 86 à 88 LDIP ne fondent aucune compétence, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. Le but de cette disposition est d’assurer que la compétence des autorités suisses est également valable dans les cas où le défunt avait son dernier domicile en Suisse, mais que celle-ci n’est pas compétente pour la succession, en raison soit d’une litispendance à l’étranger (art. 88a nLDIP), soit d’une disposition correspondante du défunt (art. 88b nLDIP).
*****
Au niveau du droit applicable, l’article 92 LDIP permet de distinguer d’une part les questions soumises au droit désigné par les articles 90 et suivants LDIP (« statut successoral ») et d’autre part les questions qui restent soumises au droit du lieu d’ouverture de la succession (« statut d’ouverture »).
Ainsi, le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
Les modalités d’exécution sont elles régies par le droit de l’État dont l’autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l’exécution testamentaire.
La nouvelle loi explicite ce que l’on entend par exécution testamentaire afin de palier à toute insécurité juridique, indiquant qu’est soumis au statut d’ouverture les aspects procéduraux relatifs à l’exécution testamentaire ou à l’administration de la succession, ainsi que la question des droits de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur sur la succession et de son pouvoir de disposition sur celle-ci.
Ainsi, la surveillance exercée par les autorités sur l’exécuteur testamentaire, les voies de recours des héritiers contre lui, l’étendue de son pouvoir de disposition (par exemple l’aliénation ou le fait de grever des biens successoraux, mais aussi le fait de contracter des obligations à la charge de la succession) et son éventuelle qualité de propriétaire de la succession (y compris la possession et le droit à la possession) relèvent du droit du lieu d’ouverture de la succession.
En revanche, les tâches, les prérogatives, le devoir de diligence ou encore la rémunération de l’exécuteur testamentaire relèvent en principe du statut successoral.
V. La validité des testaments et des pactes successoraux
A. Les testaments
à l’exception de la capacité juridique de rédiger un testament, les questions relatives aux testaments ont été jusqu’à présent soumises au droit applicable à l’ensemble de la succession du défunt (« statut successoral ») (art. 94 LDIP), en utilisant les critères habituels du domicile, de la résidence habituelle ou de la nationalité au moment du décès.
Le nouveau droit, s’harmonisant avec le règlement européen (art. 24), introduit des critères de rattachement spéciaux pour ces questions, à l’instar de ce qui a déjà été prévu en matière de pactes successoraux (art. 95 LDIP).
Ainsi, la validité au fond, la révocabilité et l’interprétation d’un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose (art. 94 al. 1 nLDIP).
L’article 95b nLDIP précise que la validité au fond du testament comprend :
– l’admissibilité de principe du testament ;
– l’établissement du testament ;
– la capacité de disposer de la personne concernée, faisant déjà l’objet de l’article 94 LDIP ;
– possibilité de contester le testament ;
– l’admissibilité de ses dispositions.
En revanche, la quotité disponible demeure régie par le droit applicable à la succession.
La validité quant à la forme du testament n’entre pas dans le champ d’application de l’article 94 nLDIP, mais reste soumise à l’article 93 LDIP qui prévoit que celle-ci est réglée par la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.
Par ailleurs, si dans le testament en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession (et non pas une simple élection de droit partielle comme dans le cadre de l’article 91 al. 3 nLDIP) au droit d’un de ses États nationaux (art. 91 al. 1 nLDIP), ce droit s’applique en lieu et place du droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose, pour les questions liées au testament (art. 94 al. 2 nLDIP).
Enfin, le disposant peut soumettre le testament au droit d’un de ses États nationaux (art. 94 al. 3 nLDIP), étant précisé que cette élection de droit prévaut sur la règle prévue à l’article 94 al. 2 nLDIP. Il doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de disposer ou au moment de son décès.
B. Les pactes successoraux
À la différence du cas des testaments, la LDIP prévoit déjà à l’article 95 une réglementation spéciale complète pour les pactes successoraux. Le critère de rattachement est en principe le même que celui qui est prévu pour les testaments (art. 95 al. 1 nLDIP, domicile du disposant au moment de la conclusion du pacte). Il en va de même du champ d’application matériel de la réglementation spéciale prévue pour les testaments (art. 94 al. 1 et 95b nLDIP), à l’exception de la notion d’ « effets contraignants » qui remplace celle de « révocabilité ».
La validité quant à la forme des pactes successoraux est réglée à l’article 93 LDIP, comme pour les testaments.
A l’instar de ces derniers, si, dans le pacte successoral en question ou une disposition antérieure, le disposant a soumis toute sa succession au droit d’un de ses États nationaux (art. 91 al. 1 nLDIP), ce droit s’applique en lieu et place du droit le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte (art. 95 al. 2 nLDIP).
Par ailleurs, le nouveau droit prévoit (art. 95 al. 3 nLDIP) qu’en présence de dispositions d’un pacte successoral impliquant deux parties ou plus, chacune d’elle est évaluée selon le droit dont elle relève, à savoir soit le droit d’un des États nationaux (art. 95 al. 2 nLDIP ci-dessus), soit le droit de l’État du dernier domicile du disposant (art. 95 al. 1 nLDIP ci-dessus). Le pacte successoral n’est pris en considération, par contre, que si toutes les dispositions sont valables selon le droit en question et ont des effets contraignants entre les parties (c’est-à-dire que le disposant ne peut pas les modifier unilatéralement).
En revanche, il n’est pas exigé que chaque disposition satisfasse aux exigences de la totalité des ordres juridiques impliqués (ceux de l’État national ou de l’État de domicile de chacun des disposants).
A noter que le règlement européen s’écarte de la solution suisse en retenant le droit qui présente les liens les plus étroits avec le pacte successoral, et appliquant celui-ci à l’ensemble des dispositions. En d’autres termes, le règlement européen ne soumet pas chaque disposition à un droit distinct. Il ne prévoit l’applicabilité cumulative de plusieurs ordres juridiques que dans le domaine restreint de la recevabilité de principe du pacte successoral.
Les parties ont toutefois la possibilité de soumettre l’intégralité des dispositions du pacte successoral au droit de l’État national du disposant ou de l’un des disposants, selon qu’il s’agit d’un pacte successoral unilatéral ou mutuel ou au droit de l’État dans lequel un des disposants est domicilié au moment de la conclusion du pacte (pour les pactes successoraux comptant deux disposants ou plus uniquement) (art. 95 al. 4 nLDIP). Le disposant concerné doit avoir eu la nationalité de l’État en question au moment de la conclusion du pacte ou au moment du décès du premier disposant.
L’élection de droit ci-dessus porte uniquement sur le pacte successoral et les dispositions qu’il contient. Elle prévaut sur l’article 95 al. 2 nLDIP.
Enfin, les dispositions sur le pacte successoral (art. 95 nLDIP) s’appliquent par analogie aux autres dispositions contractuelles pour cause de mort, comme par exemple la donation pour cause de mort (art. 95a nLDIP).
VI. La reconnaissance des décisions, les mesures et les actes étrangers dans le cadre d’une succession
Le nouveau droit (art.96 nLDIP) prévoit que les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d’une succession ouverte à l’étranger, sont reconnus en Suisse :
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État du dernier domicile du défunt ou lorsqu’ils sont reconnus dans cet État ;
- lorsqu’ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État dans lequel ces biens sont situés ou s’ils sont reconnus dans cet État ;
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l’État concerné, ou
- lorsqu’ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l’État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l’État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l’étranger et que l’État concerné ne s’occupe pas de la succession.
Par contre, les actes juridiques étrangers ne sont pas reconnus si le défunt avait la nationalité suisse et qu’il avait soumis sa succession à la compétence des autorités suisses, soit directement par une prorogation de for, soit indirectement par une élection de droit (art. 87 al. 2 nLDIP).
S’agissant d’un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus.
Enfin, les mesures conservatoires prises dans l’État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse.
VII. Les objectifs sont-ils atteints ?
Dans les grandes lignes, la nouvelle LDIP s’harmonise avec le règlement européen sur les successions, offrant aux citoyens suisses et de l’Union européenne davantage de sécurité juridique et de prévisibilité dans le déroulement de leur succession.
Deux divergences notables demeurent toutefois : tout d’abord, le rattachement du règlement européen au dernier lieu de résidence habituelle du défunt plutôt qu’à son dernier domicile comme c’est le cas dans la LDIP. Cette distinction ne devrait toutefois pas poser de problème en général, dans la mesure où dans la quasi-totalité des cas, le domicile du de cujus correspondra à sa résidence. Des difficultés pourraient surgir dans l’hypothèse où une personne retraitée domiciliée en Suisse passerait une grande partie de son temps dans sa résidence secondaire située sur le territoire de l’Union européenne.
Par ailleurs, contrairement au droit suisse (art. 95 al. 3 LDIP), qui soumet chaque disposition d’un pacte successoral réciproque à un droit distinct (celui de l’État national ou de l’État de domicile de chacun des disposants), le règlement européen prévoit comme applicable, s’agissant de la validité au fond et des effets contraignants du pacte, le droit qui présente les liens les plus étroits avec celui-ci (art. 25 par. 2).
En outre, le règlement européen ne permet pas que les parties puissent soumettre le pacte successoral au droit dans lequel un des disposants est domicilié (art. 95 al. 4 nLDIP).
Au-delà de ces divergences et nonobstant l’harmonisation, on ne saurait totalement exclure des conflits de compétence avec la nouvelle LDIP, notamment avec des états tiers.
Aussi, malgré la possibilité de choisir l’un de leur droit national étranger, les binationaux suisses devront toujours respecter les règles suisses sur les réserves héréditaires. Ceci implique par exemple pour un ressortissant britanno-suisse, la possibilité certes d’attribuer l’ensemble de ses biens à un trust post mortem par testament, en faisant une élection de droit anglais, mais l’empêchant néanmoins d’exclure son épouse et/ou ses enfants en tant que bénéficiaires du trust à constituer.
Au final, si l’on peut saluer l’harmonisation du droit suisse avec celui européen, on regrette néanmoins la complexification des règles relatives à la succession internationale du défunt. Plus que jamais, le recours a des spécialistes est nécessaire en vue de bien planifier sa succession.
On notera enfin que la Grèce et l’Italie sont liés à la Suisse par un traité qui prime les dispositions de la LDIP. Ces deux accords comprennent des différences notables par rapport à la LDIP et au règlement européen ; dès lors une adaptation de ces textes sera nécessaire à l’avenir