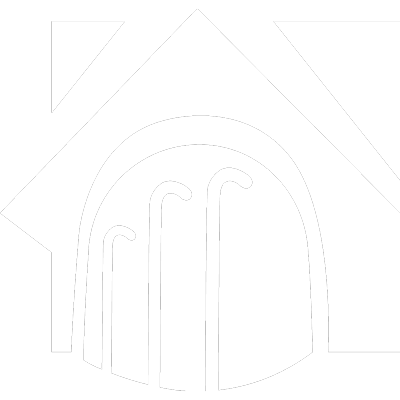Résumé de l’arrêt du Tribunal fédéral
Les biens mis dans un trust discrétionnaire et irrévocable du vivant du settlor ne font en principe pas partie de la succession à son décès. Cela reste vrai même si le défunt se désigne lui-même premier bénéficiaire (sous réserve d’un sham trust). Le fait que les avoirs du trust soient soumis à l’impôt sur les successions est sans importance du point de vue du droit successoral.
La présence d’un trust révocable ou irrévocable, créé du vivant du settlor, désignant les seconds bénéficiaires uniquement au décès de ce dernier, constitue un acte entre vifs et non une disposition pour cause de mort, et dès lors est non sujet à des formalités particulières, réservées par exemple aux testaments (forme authentique ou olographe, etc.).
Les distributions faites dans le cadre d’un trust fixe sont en principe sujettes au rapport de l’article 626 CC. Il n’en va pas ainsi s’agissant des libéralités non encore effectuées d’un trust discrétionnaire, dans la mesure où les bénéficiaires n’ont aucun droit ferme sur les avoirs du trust et qu’il n’est pas certain qu’ils recevront des distributions un jour.
Introduction
Dans un arrêt du 16 décembre 2024 (BGer 5A_89/2024), le Tribunal fédéral suisse a franchi une étape décisive en clarifiant le traitement des trusts dans un contexte successoral, un domaine où la jurisprudence demeure rare. En se prononçant sur le cas d’un trust liechtensteinois, dont les actifs détenus étaient contestés dans le cadre d’une succession ouverte en Suisse, notre Haute cour a notamment clarifié les questions suivantes :
– l’inclusion des biens mis en trust dans la masse successorale du settlor (défunt) ;
– la nature des droits des bénéficiaires désignés ;
– l’obligation de rapport des distributions passées et futures.
Cette décision, sans doute en partie politique suite à l’entrée en vigueur de la loi sur les établissements financiers (LEFin, RS 954.1) en 2020, qui impose aux trustees professionnels de disposer d’une licence de la FINMA, renforce le cadre juridique des trusts et ouvre la voie à une reconnaissance accrue en Suisse.
Onyx Trust vous présente dans le détail cet arrêt essentiel pour le praticien et toute personne désireuse de constituer un trust avec des implications successorales en Suisse.
I) Les faits retenus par le Tribunal fédéral
Le litige porte sur la succession de G.A. (« le défunt »), décédé en 2013, laissant pour héritiers ses enfants A, B et C, ainsi que ses petits-enfants D, E et F, issus de la fille H du de cujus, prédécédée. En 2014, un accord a été conclu entre les parties selon lequel les petits-enfants cédaient leurs parts héréditaires à B et C en échange d’une indemnité de CHF 1,8M. Toutefois, en 2019, la découverte d’un « trust » liechtensteinois, le « I. Trust Reg. », plus précisément une entreprise fiduciaire (Treuunternehmen), détenant CHF 1,37M, a relancé les tensions familiales. Bien que le défunt ait été le seul bénéficiaire du trust de son vivant, ses deux fils, B et C, avaient été désignés comme 2èmes bénéficiaires après son décès.
Lorsque les actifs du trust ont été ajoutés à l’inventaire successoral, D, E et F ont intenté une action en justice contre les autres héritiers, réclamant que ces fonds soient officiellement intégrés à la succession et redistribués en conséquence. Leur demande a d’abord été rejetée en 2021, mais en 2024, l’Obergericht du canton de Soleure a partiellement fait droit à leur requête, reconnaissant que les actifs du trust faisaient bien partie du patrimoine successoral, tout en refusant leur redistribution. Contestant cette décision, les enfants du défunt ont porté l’affaire devant le Tribunal fédéral.
II) Le raisonnement juridique du Tribunal fédéral
A) La qualification juridique de l’entreprise fiduciaire liechtensteinoise et le droit applicable
L’autorité précédente a fondé son analyse juridique sur la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2007 (CLaHT ; RS 0.221.371). Ce point n’a pas été suivi par le Tribunal fédéral.
En effet, selon le droit liechtensteinois, une entreprise fiduciaire, constituée conformément à l’article 932a de la loi liechtensteinoise du 20 janvier 1926 sur les personnes et les sociétés (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR ; Lilex 216.0), dispose d’une personnalité juridique propre. Ainsi, les actifs fiduciaires ne sont pas juridiquement détenus par le trustee, contrairement à ce que stipule l’article 2 al. 2 let. b CLaHT. Le fiduciaire ne dispose que d’un droit de gestion et de disposition sur les actifs, sans en posséder la propriété.
En conséquence, l’entreprise fiduciaire I. Trust Reg. n’entre pas dans le champ d’application de la CLaHT, bien qu’elle en partage certaines caractéristiques. Dès lors, cette structure est régie par le droit des sociétés conformément à l’article 154 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP ; RS 291).
Il ressort de cette disposition que l’entreprise fiduciaire est soumise au droit de l’État dans lequel elle a été constituée, à condition de respecter les obligations de publicité et d’enregistrement prévues par ce droit (théorie de l’incorporation).
Selon l’article 1 des statuts de la société, l’entreprise fiduciaire a été créée conformément au droit liechtensteinois. Pour le Tribunal fédéral, il n’existe aucune preuve que les obligations légales en matière de publicité ou d’enregistrement n’auraient pas été respectées. Même les intimés (D, E et F) reconnaissent que la validité formelle de la création du I. Trust Reg., et celle-ci n’a jamais été remise en question, ni par eux, ni par les tribunaux cantonaux. Ainsi, la société fiduciaire doit être automatiquement reconnue.
En outre, comme le rappelle le Tribunal fédéral, aucune violation de l’ordre public suisse (article 17 LDIP) ne saurait être en cause en l’espèce, dans la mesure où la Suisse reconnaît les trusts étrangers conformément à la CLaHT (même si l’entreprise fiduciaire n’en est formellement pas un) et que l’article 335 al. 2 du Code civil (CC ; RS 210) (interdiction de constituer des fidéicommis de famille) n’est pas une disposition impérative du droit suisse au sens de l’article 18 LDIP, ne faisant donc pas obstacle à l’application du droit étranger (ATF 135 III 614).
Enfin, d’après le Tribunal fédéral, bien que cette entreprise fiduciaire ne soit pas un trust au sens de la CHaLT, elle présente des similitudes avec les trusts traditionnels. Ainsi, les principes applicables aux trusts s’appliquent partiellement par analogie au présent cas. Le Tribunal fédéral termine son analyse sur ce point en rappelant les distinctions entre :
- – Les trusts inter vivos (créés du vivant du setllor), des trusts mortis causa (créés pour cause de mort, appelés testamentary trusts).
- – Les trusts révocables qui peuvent être révoqués à tout moment par le settlor, par opposition aux trusts irrévocables.
- – Les trusts discrétionnaires, par lesquels le trustee dispose d’une liberté d’appréciation quant à la distribution des biens aux bénéficiaires, des trusts à intérêts fixes, où les bénéficiaires ont un droit déterminé sur les distributions.
B) Le trust fait-il partie des actifs successoraux ?
L’autorité inférieure est parvenue à la conclusion implicite que le I. Trust Reg. était un trust révocable, au motif que le défunt avait conservé, de son vivant, la qualité de premier et unique bénéficiaire du trust. Ainsi, bien que le de cujus ait renoncé de manière irrévocable à tout droit sur l’entreprise fiduciaire et ses actifs (conformément à l’article 6 des statuts), le patrimoine fiduciaire était resté sous son contrôle effectif.
Partant, le défunt ne s’étant pas définitivement dessaisi de ses biens, les actifs détenus par le I. Trust Reg. devaient, selon la juridiction cantonale, être intégrés dans sa succession. En décider autrement reviendrait à admettre que celui-ci aurait pu transférer l’intégralité de son patrimoine dans un trust de son vivant et ainsi contourner les règles du droit successoral suisse.
Le Tribunal fédéral conteste cette approche. Conformément au principe de l’universalité de la succession inscrit à l’article 560 CC, les héritiers acquièrent, de plein droit, l’ensemble de la succession au moment du décès. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les créances et actions, les droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt sont automatiquement transférés aux héritiers, tandis qu’ils sont personnellement tenus de ses dettes (article 560 al. 2 CC). La succession comprend l’ensemble des rapports juridiques non intrinsèquement liés à la personne du défunt.
Or, le de cujus a, de son vivant, créé le I. Trust Reg., une entreprise fiduciaire liechtensteinoise qui doit être reconnue en Suisse. Ce dernier a renoncé de manière irrévocable à tout droit sur l’entreprise et ses actifs (art. 6 des statuts fiduciaires) et ne s’est réservé aucun droit en la matière. Le défunt a également constitué, de son vivant, le patrimoine fiduciaire, initialement doté de 30’000 CHF (art. 3 et 4 des statuts). Aucune invalidation quant aux transferts des biens dans l’entreprise fiduciaire n’a été alléguée ni démontrée. Ainsi, en transférant ses biens le I. Trust Reg. dotée de la personnalité juridique et en renonçant irrévocablement à tout droit sur ces actifs, le défunt s’est définitivement dessaisi de ses biens.
Ces actifs ont donc été exclus du patrimoine de de cujus et ne font pas partie de sa succession.
C) L’exception du « sham trust » selon le Tribunal fédéral
D’après le Tribunal fédéral, une exception pourrait s’appliquer si la structure mise en place s’apparentait à un « sham trust » (trust fictif), c’est-à-dire si le settlor avait conservé le contrôle effectif sur les biens fiduciaires. Dans ce cas, il s’agirait d’une simulation et le trust serait inefficace (arrêt du Tribunal fédéral 5A 436/2011 du 12 avril 2012).
Cependant, dans le cas d’espèce, rien dans le dossier ne permet d’établir que le défunt avait la liberté de disposer des actifs du I. Trust Reg. de son vivant. Faute de fondement factuel, il n’est donc pas possible de qualifier ce trust de « sham trust ».
D) La levée du voile juridique
D’après le Tribunal fédéral, la levée du voile juridique (Durchgriff, principe de la transparence) constitue une exception au principe de la personnalité juridique distincte des personnes morales. Elle suppose une dépendance entre la personne morale et la personne qui la contrôle, ainsi qu’une identité d’intérêts économiques entre elles.
La levée du voile est justifiée si :
- – L’indépendance juridique est utilisée abusivement pour contourner la loi, empêcher l’exécution de contrats ou porter atteinte aux droits des tiers.
- – Elle vise à obtenir un avantage injustifié s’apparentant à un abus de droit.
Si les conditions sont remplies, il peut être justifié, de manière exceptionnelle, de faire abstraction de la séparation juridique entre la personne morale et la personne qui la contrôle (ATF 149 III 145).
Cependant, dans le cas présent :
- – Le défunt a renoncé irrévocablement à tout droit sur l’entreprise et ses actifs (art. 6 des statuts fiduciaires).
- – Le conseil fiduciaire disposait d’une pleine autonomie pour désigner les bénéficiaires et déterminer la nature, l’étendue et les modalités des distributions (art. 8 al. 3 des statuts), sans que le défunt ou les recourants ( B et C) n’en fassent partie (art. 7 al. 3 des statuts).
- – Le fait que le défunt était le premier bénéficiaire, et que B et C deviendraient les seconds bénéficiaires après son décès, ne changeaient rien aux pouvoirs du conseil fiduciaire et partant était non pertinent en l’espèce.
Ainsi, le I. Trust Reg. ne pouvait être assimilé à une société unipersonnelle et les arguments des intimés en faveur d’une levée du voile étaient insuffisants.
Le Tribunal fédéral relève encore que la situation juridique civile (trust discrétionnaire et irrévocable) peut différer de celle fiscale. En définitive, même si l’entreprise fiduciaire a bel et bien été soumise à l’impôt sur les successions, les biens trustaux n’ont jamais fait partie de la succession sur le plan civil.
E) La désignation des seconds bénéficiaires constitue-t-elle une libéralité entre vifs ou une disposition pour cause de mort ?
L’instance inférieure a conclu que la désignation de B et C en tant que bénéficiaires à la mort du settlor devait être considérée comme une disposition à cause de mort. Toutefois, celle-ci ne respectait pas les formes légales (testament, pacte successoral, etc.) requises par le droit suisse.
Les intimés, en tant qu’héritiers, pouvaient donc invoquer l’invalidité formelle de cette désignation.
Par ailleurs, selon le principe de l’article 608 al. 3 CC, en l’absence de volonté clairement exprimée par le défunt, l’attribution d’un bien successoral à un héritier doit être interprétée comme une simple règle de partage et non comme un legs.
Dans la mesure où la volonté du défunt n’était pas clairement identifiable en l’espèce, il convenait de considérer cette désignation comme une directive de partage.
Une fois de plus, le Tribunal fédéral conteste ce point de vue. Pour déterminer si la désignation des bénéficiaires a été faite du vivant du de cujus (inter vivos) ou pour cause de mort (mortis causa), il convient d’examiner si l’acte en cause affecte le patrimoine de l’auteur de son vivant ou seulement après son décès (arrêt 5A 890/2021 du 26 avril 2022). Le critère déterminant est donc le moment où l’acte doit produire ses effets. Selon le Tribunal fédéral, la différence réside dans le fait que les actes entre vifs créent des obligations juridiques avant le décès de l’auteur, tandis que les dispositions à cause de mort produisent leurs effets seulement après la mort (ATF 144 III 81).
Dans un arrêt concernant une assurance décès souscrite de son vivant par le défunt, financée avec ses fonds propres et dans laquelle un bénéficiaire avait été désigné, le Tribunal fédéral a jugé que la désignation du bénéficiaire crée un droit propre à l’encontre de la compagnie d’assurance-vie, indépendant de la qualité d’héritier. Ce droit naît dès la conclusion du contrat, ou, si le défunt s’est réservé la possibilité de modifier cette clause, il est suspendu jusqu’à son décès. Il ne s’agit donc pas d’un avantage successoral, mais bien d’un acte juridique entre vifs, peu importe que la désignation soit révocable ou irrévocable (ATF 112 II 157).
Considérant que le cas d’espèce est similaire à celui de l’assurance vie (le défunt a, de son vivant, créé une entreprise fiduciaire, l’a financée avec ses propres fonds et a désigné des bénéficiaires secondaires en cas de décès), le Tribunal fédéral estime qu’il est cohérent de qualifier la clause de désignation des bénéficiaires établie par le défunt comme un acte juridique entre vifs. Partant, la clause de nomination des bénéficiaires n’avait pas à respecter les exigences de forme relatives aux dispositions pour cause de mort. Il en va de même pour la qualification de la clause par la juridiction précédente en tant que directive de partage.
F) Les distributions sont-elles rapportables pour le Tribunal fédéral ?
Enfin, dans une argumentation subsidiaire, l’Obergericht du canton de Soleure a estimé que la libéralité effectuée du vivant du de cujus était en tout cas soumise à l’obligation de rapport, même si B et C n’étaient pas n’étaient pas propriétaires des actifs du trust à ce moment-là. Là encore, le Tribunal fédéral casse l’opinion des juges inférieurs.
D’après l’article 626 CC, les héritiers légaux sont tenus les uns envers les autres au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie. Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants.
Dans la mesure où la désignation de B et C comme bénéficiaires du trust constitue un acte entre vifs (voir ci-dessus), il convient de déterminer si cette libéralité est soumise ou non à l’obligation de rapport. Selon le Tribunal fédéral, il sied d’examiner la doctrine relative à l’obligation de rapport concernant les bénéficiaires d’assurances et les avantages issus de trusts.
L’obligation de rapport des bénéficiaires en matière d’assurance est controversée.
Selon Staehelin/Ammann, la désignation d’un bénéficiaire, en vertu de l’art. 76 LCA, constitue une libéralité entre vifs, et devrait donc être, en principe, soumise à l’obligation de rapport (Staehelin/Ammann, in : Commentaire bâlois, Code civil suisse, vol. II, 7e éd., 2023, ad. art. 476 CC n° 15).
Cependant, la désignation d’un bénéficiaire d’une assurance confère à ce dernier un droit direct contre la compagnie d’assurance (ATF 112 II 157).
La doctrine majoritaire considère que les libéralités faites à des trusts inter vivos sont soumis à l’obligation de rapport, lorsque les bénéficiaires sont des héritiers légaux (HERZOG, Trusts und schweizerisches Erbrecht, 2016, n°274, p. 145ss).
Cependant, les modalités restent controversées :
Weingart distingue entre les fixed interest trusts et les discretionary trusts. Pour les premiers, tant les libéralités déjà effectuées que les actifs du trust, à hauteur des droits des bénéficiaires, doivent être rapportés conformément à l’art. 626 CC.
Pour les discretionary trusts, seules les libéralités déjà effectuées sont soumises à l’obligation de rapport (WEINGART, Anerkennung von Trusts und trustrechtlichen Entscheidungen im internationalen Verhältnis – unter besonderer Berücksichtigung schweizerischen Erb- und Familienrechts, 2010, Rz. 51 S. 27 auch für einen revocable trust, n° 352, p. 180).
Eitel/Brauchli différencient selon que les biens sont encore propriété du trustee ou déjà propriété des bénéficiaires (EITEL/BRAUCHLI, Trusts im Anwendungsbereich des schweizerischen Erbrechts, successio 2012, n° 74, p. 138).
Dardel affirme que, si aucune distribution n’a été effectuée de son vivant, cela entraînerait le rapport de « libéralités » que le bénéficiaire n’a même pas encore reçues. Dans ce contexte, un descendant ne peut être débiteur du rapport que s’il a déjà reçu des distributions ou si son droit était irrévocablement établi de son vivant (irrevocable fixed interest trust ; DARDEL, Die Teilungsmasse und die Vermögensübertragungen an Trusts, successio 2024, p. 139).
Selon le Tribunal fédéral, les distributions issues d’un trust ou d’une entreprise fiduciaire, reçues par des descendants du vivant du de cujus, sont soumis à l’obligation de rapport conformément à l’article 626 CC.
Il en va de même si les bénéficiaires disposent d’un droit ferme à des distributions de revenus ou de capital, comme c’est le cas pour un fixed interest trust.
En revanche, dans le cadre d’un discretionary trust, le trustee dispose d’une totale liberté de décider non seulement si des distributions auront lieu, mais aussi de déterminer leur montant. Les bénéficiaires n’ont aucun droit ferme à une distribution et il n’est pas certain qu’ils en recevront un jour.
Dans ce contexte, conformément à la doctrine, la simple désignation en tant que bénéficiaire d’un trust ne peut être considérée comme une libéralité soumise au rapport. Cela reste vrai même si, d’après l’expérience générale de la vie, on peut supposer que le trustee utilisera les fonds disponibles conformément à la volonté initiale du settlor ou aux statuts de l’entreprise fiduciaire.
G) Quid de l’action en réduction ?
Dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral relève que la question de savoir si les avoirs transférés à une entreprise fiduciaire, à un trust ou à un trustee peuvent être sujets à réduction conformément aux articles 522ss CC suisse doit être distinguée du rapport. Les règles sur la réserve héréditaire sont expressément réservées par la CLaHT. Selon la jurisprudence, il est clairement établi que de tels transferts de patrimoine sont, en principe, soumis à la réduction (arrêt 5A 620/2007 du 7 janvier 2010). Ainsi, l’argumentation de la juridiction précédente, selon laquelle la reconnaissance des trusts ou la reconnaissance de l’autonomie juridique des actifs transférés à un trust ou à une entreprise fiduciaire permettrait à un testateur de transférer l’intégralité de son patrimoine dans un trust de son vivant pour ainsi contourner les règles du droit successoral, est erronée.
Comme pour l’obligation de rapport, les modalités de réduction des transferts d’actifs à des trusts font l’objet de divergences doctrinales. Dans la mesure où les D, E et F n’ont formulé aucune demande de réduction, le Tribunal fédéral a malheureusement renoncé à développer davantage cette question.
III) Que faut-il retenir de la jurisprudence du Tribunal fédéral ?
Le jugement du Tribunal fédéral apporte des clarifications bienvenues sur le traitement des actifs d’un trust dans le cadre de successions suisses, mettant ainsi fin à de nombreuses incertitudes juridiques. En particulier, on retiendra ce qui suit :
- – Une entreprise fiduciaire de droit liechtensteinois doit être assimilée à un trust ;
- – Sous réserve d’un sham trust, le patrimoine d’un inter vivos trust n’appartient pas au défunt et n’entre pas dans sa succession ;
- – Le traitement fiscal des trusts en droit suisse diffère du droit successoral ;
- – Le fait de désigner des bénéficiaires d’un trust est un acte entre vif et non pas une disposition pour cause de mort soumise à des exigences de forme particulières ;
- – Toutes les distributions existantes au décès sont rapportables ;
- – Les distributions futures d’un fixed interest trust sont rapportables ;
- – Les distributions futures d’un discretionnary trust ne sont pas rapportables ;
- – L’action en réduction des héritiers est toujours réservée (le Tribunal fédéral n’a toutefois pas approfondi cette question).