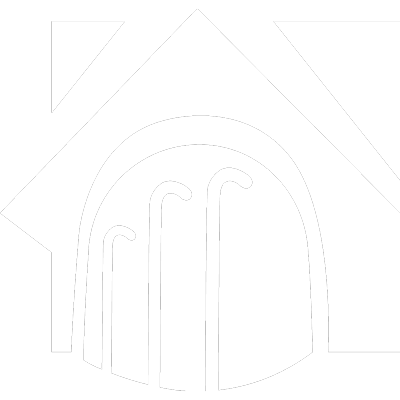Table des matières
- Assurance-vie et 3ème pilier : quelles options en matière de prévoyance individuelle ?
- Qu’est-ce qu’une assurance vie ?
- Quels sont les différents types d’assurances-vie ?
- Quels sont les avantages d’une assurance-vie et à qui s’adresse-t-elle ?
- Combien coûte une assurance-vie en Suisse ?q
- Quelle est la différence entre le pilier 3A et le pilier 3B ?
- A qui s’adresse le 3ème pilier B et quelles sont ses avantages ?
- Banque ou assurance, mon cœur balance : quelle est la meilleure solution pour mon 3ème pilier ?
- Comment est imposé le 3ème pilier A et B dans le cadre de l’assurance-vie ?
- Que se passe-t-il avec mon assurance-vie en cas de divorce ?
- Qu’en est-il des règles sur la réserve héréditaire ?
- Quid de la rente viagère ?
Assurance-vie et 3ème pilier : quelles options en matière de prévoyance individuelle ?
Êtes-vous plutôt cigale ou fourmi ? Si La Fontaine se refuse, de condamner explicitement la Cigale, imprévoyante et vivant au jour le jour, par rapport à la Fourmi, avare et travailleuse, laissant à chacun le choix de décider de sa vie mais également d’en assumer les conséquences, la célèbre fable demeure un éloge à l’anticipation.
En tous les cas, les Suisses, à l’instar de leurs voisins français, sont des épargnants par nature, notamment pour se protéger des aléas de la vie et préparer leur retraite. Avec près de 22.5 milliards de francs de primes encaissées par les assureurs en 2024, l’assurance-vie est leur solution préférée.
Être prudent plutôt deux fois qu’une c’est bien, mais encore faut-il ne pas gaspiller ses ressources dans des produits inadaptés à votre situation financière et familiale ainsi qu’à vos objectifs à long terme.
Le grand avantage d’une assurance-vie consiste dans les nombreuses options qu’elle offre ; le grand inconvénient d’une assurance-vie réside dans les nombreux choix qu’elle permet. Il y a réellement de quoi se perdre dans la jungle des contrats disponibles et les conséquences auront un impact majeur sur vous et votre famille. Il est n’est donc pas question de se tromper !
Quel âge avez-vous ? Avez-vous des enfants à charge ? Comment est composé votre patrimoine ? Êtes-vous locataire ou propriétaire ? Êtes-vous en bonne santé ? Vivez-vous en concubinage ? Êtes-vous indépendant ou salarié ? Ces détails peuvent jouer un grand rôle dans le choix du produit adapté.
Beaucoup considèrent, à tort, que recourir aux services d’un courtier en assurance est une solution économique et efficace. Indéniablement, un courtier spécialisé dans l’assurance-vie sera compétent et connaîtra bien les offres disponibles sur le marché. Toutefois, curieusement, peu de personnes se posent la question de savoir comment un courtier est rémunéré ; or, contrairement à d’autres professions comme les gestionnaires de fortune qui ont un devoir de transparence envers leurs clients, les courtiers perçoivent des rétrocessions des assureurs dont les montants sont pharaoniques et jusqu’à très récemment gardés totalement secrets.
Certes, depuis le 1er janvier 2024, les intermédiaires d’assurance non liés, soit ceux qui ne sont pas liés à une compagnie d’assurance, ni économiquement ni d’une autre manière et qui entretiennent un rapport de loyauté avec le preneur d’assurance agissant dans son intérêt, doivent informer ce dernier de tous les types de rémunération qu’ils reçoivent d’entreprises d’assurance ou de tiers en relation avec la fourniture d’un service. Toutefois, nonobstant cette adaptation législative bienvenue, vous ne pouvez en aucun cas être certain que le courtier mandaté vous proposera la meilleure assurance-vie, adaptée à vos besoins. Il pourra très bien vous offrir le produit d’assurance dont il perçoit la plus haute rétrocommission de l’assureur. En outre, les impératifs de rentabilité poussent parfois les intermédiaires à proposer des solutions standardisées à tous.
En Suisse l’assurance-vie fait partie du 3ème pilier, à savoir de la prévoyance individuelle. Après avoir présenté brièvement ci-dessous le fonctionnement de l’assurance-vie, nous vous expliquerons comment elle s’imbrique dans le système suisse des 3 piliers.
Qu’est-ce qu’une assurance vie ?
L’assurance-vie (individuelle) peut se définir comme un contrat d’assurance par lequel une entreprise d’assurance promet à un preneur d’assurance, en retour d’une ou de plusieurs primes, de lui procurer ou de procurer à un tiers (le « bénéficiaire »), une ou plusieurs prestations financières, sous une condition ou un terme dépendant de la durée de la vie ou de la capacité de gain d’une personne assurée.
Plus simplement, l’assurance-vie s’entend comme une couverture contre le risque de décès et d’invalidité. Elle constitue également un excellent outil afin de préparer sa retraite.
De manière générale, on distingue l’assurance-vie risque pur et celle constitutive d’un capital. La première protège les proches de l’assuré en cas de décès, mais ne donne droit à aucune prestation à ce dernier tant qu’il est vivant. Il est possible d’intégrer à une assurance risque pur l’éventualité de l’incapacité de gain, garantissant une rente à l’assuré en cas d’atteinte à sa santé le rendant incapable de travailler.
L’assurance constitutive d’un capital permet quant à elle à l’assuré de se constituer une épargne. Au terme du contrat (décès ou échéance), les bénéficiaires désignés dans le contrat d’assurance-vie toucheront ainsi le capital versé.
Bien entendu, il est possible de combiner les deux types d’assurances susmentionnées et de nombreuses variantes existent selon la prestation et l’événement assurés, le mode de versement des primes, les investissements du capital, etc.
Souscrire une assurance vie offre une sécurité financière à vos proches en cas de décès, assurant ainsi tranquillité d’esprit et soutien financier, permettant également de planifier efficacement la transmission de votre patrimoine.
Quels sont les différents types d’assurances-vie ?
Il existe une constellation très variée d’assurances-vie couvrant de multiples événements et prestations, sujette d’ailleurs à confusion. On peut néanmoins classifier les assurances-vie de la manière suivante :
- L’assurance-décès : de durée déterminée, généralement exprimée en années, la prestation n’est déclenchée que par le décès de la personne assurée (suite à un accident ou une maladie) avant une date convenue. Il n’y a donc pas nécessairement déclenchement de la prestation de l’assureur et le contrat se termine, soit par le décès de l’assuré, soit par le fait que ce dernier est encore en vie à la date convenue. Les prestations varient d’une assurance à une autre (capital constant/décroissant ou rente) de même que la couverture (exclusions en cas de suicide, pour les fumeurs, les activités à risque, les séjours à l’étranger, la participation à des troubles ou des guerres, etc.). Les primes également peuvent différer (par exemple « nivelées », à savoir constante pendant la durée contractuelle, ou « évolutives », soit révisées annuellement avec l’accroissement du risque lié à l’âge).
L’assurance-décès est donc une assurance-vie risque pur dépourvue d’un processus d’épargne. Elle peut être souscrite dans le cadre du pilier 3A (prévoyance liée) ou 3B (prévoyance libre).
Ce type d’assurance fonctionne ainsi comme un véritable bouclier pour vos proches à l’égard des dettes financières que vous pourriez leur laisser s’il vous arrive quelque chose. Ainsi, par exemple, le paiement des intérêts et l’amortissement des prêts hypothécaires pourraient contraindre ceux-ci à devoir se séparer du logement familial sans la mise en place d’une assurance-vie (à capital décroissant). Idem, ce type de contrat peut s’avérer judicieux dans le cadre de partenariats commerciaux, afin de se prémunir contre les conséquences financières de votre disparition. Cette assurance-vie est ainsi très utilisée dans le cadre d’opérations de nantissement auprès des établissements bancaires.
De manière générale, on estime que lorsqu’il s’agit d’assurer une famille, la couverture d’assurance devrait être fixée entre 3 et 5 fois le revenu annuel de la personne principale.
Parce que les circonstances de la vie évoluent, les assureurs permettent généralement de passer d’une assurance-vie risque pur à une assurance-vie mixte, comprenant ainsi une composante d’épargne. Les conditions générales et les termes du contrat doivent toutefois être soigneusement étudiés.
- L’assurance en cas d’invalidité (également appelée assurance incapacité de gain/de travail ou assurance perte de gain) : comme son nom l’indique, ce type d’assurance-vie couvre une incapacité de travail suite à une maladie et/ou un accident (selon les polices). L’incapacité doit être de 25% au minimum et une rente complète ne sera accordée qu’à partir de 70%. Les prestations sont versées sous forme d’une rente régulière (4 fois par an) et permettent à l’assuré de conserver son niveau de vie sans recourir à l’endettement, jusqu’à l’âge de la retraite au besoin. En clair, cette assurance-vie compense la perte de salaire jusqu’à ce que la rente vieillesse puisse être touchée.
L’éventualité invalidité est souvent intégrée à la couverture de la vie et du décès, car les caractéristiques de ce type d’assurance-vie sont les mêmes (risque pur, utilisation dans le cadre du 3ème pilier, etc.). Il est toutefois possible de couvrir celle-ci de manière autonome dans un contrat d’assurance-vie séparé.
Ce mode de couverture permet de compléter les prestations de l’assurance invalidité (AI) et de la prévoyance professionnelle (LPP) qui ne suffisent généralement pas à maintenir le niveau de vie antérieur (l’ancien revenu n’est souvent couvert qu’à 60% pour la maladie et 90% en cas d’accident). Elle est utile pour les familles, non seulement lorsque l’un des partenaires travaille mais également s’il s’occupe des enfants et du foyer (nécessité de recourir à une crèche, une aide de ménage, etc.), ainsi que pour les indépendants qui ne sont pas affiliés à une caisse de pension.
- L’assurance-décès vie entière : contrairement à l’assurance décès, la durée contractuelle s’étend ici obligatoirement jusqu’au décès de la personne assurée. La prestation est ainsi déclenchée par la mort qui provoque la fin ordinaire du contrat. En d’autres termes, il y a obligatoirement prestation de l’assureur. L’assurance-vie entière est ainsi forcément dotée d’un processus d’épargne et l’assureur devra, sur demande du preneur d’assureur, la racheter. La totalité du capital épargné pourra éventuellement être placé dans un fonds d’investissement, offrant une meilleure perspective de rendement, mais aussi s’accompagnant de risques plus élevés. On parle alors d’assurance-vie liée à des fonds de placement.
- L’assurance-vie mixte : Celle-ci combine épargne et couverture des risques. Ainsi, la prestation de l’assureur est ici déclenchée soit par le décès de la personne assurée avant la date convenue (et/ou l’incapacité de gain) (on parle de « cas de prestation »), soit par le fait qu’elle est en vie à cette même date (« cas de vie »). Il est donc certain que l’évènement se réalisera. L’assurance-vie mixte est impérativement dotée d’un processus d’épargne et de rachat. Elle constitue ainsi une solution de prévoyance vieillesse et représente l’assurance la plus répandue en Suisse.
La prestation sera un capital décès constant ou une rente fixée selon le degré d’incapacité. En cas de vie, l’assurance versera le capital épargné.
Les primes peuvent être payées de manière périodique (mensuellement, annuellement, etc.) ou en une seule fois (un droit de timbre à hauteur de 2.5% est alors dû). Elles comprennent trois composantes, à savoir la couverture du risque en cas de décès ou d’incapacité de gain, la constitution du capital épargne et les taxes/frais administratifs. Du fait de ce qui précède, les assurances-vie mixtes ont un fonctionnement opaque, car il est souvent difficile de déterminer quel montant est effectivement attribué à l’épargne, combien coûte la couverture des risques et quelle est la commission prélevée. Il est ainsi souvent plus judicieux de conclure des assurances-vie séparées.
L’assurance-vie mixte peut bien entendu être contractée dans le cadre du 3ème pilier libre ou lié.
Enfin, l’assurance-vie mixte est susceptible de rachat impliquant généralement des pertes financières pour l’assuré. En effet, les premiers versements ne servent qu’à couvrir les frais administratif et la couverture du risque. Ce n’est qu’une fois ces éléments couverts que l’assuré peut se constituer un capital d’épargne et partant une valeur de rachat.
- L’assurance en cas de vie : celle-ci correspond au contraire de l’assurance-décès. En d’autres termes, la prestation n’est déclenchée que par la vie de la personne assurée à l’échéance de la durée convenue. Pour le reste, elle présente les mêmes caractéristiques que l’assurance-décès (risque pur, pas de processus d’épargne, etc.).
- L’assurance à terme fixe : Avec ce type d’assurance, la prestation en capital de l’assureur est versée à la date convenue (par exemple la majorité de l’enfant bénéficiaire), peu importe le décès ou non de la personne assurée à l’échéance. Les primes sont payées jusqu’à cette date, mais s’arrêtent à la mort de ce dernier.
Quels sont les avantages d’une assurance-vie et à qui s’adresse-t-elle ?
L’assurance-vie permet de couvrir des besoins variés mais elle est principalement indiquée lorsque les prestations du 1er et du 2ème piliers ne permettent pas de maintenir le niveau de vie à la retraite ou en cas d’incapacité de gain ou encore que la fortune et les rentes des survivants sont insuffisantes pour couvrir financièrement la famille. Dans une certaine mesure, elle permet également d’économiser des impôts.
Ainsi, un(e) jeune adulte actif(ve) envisagera de conclure une assurance-vie risque pur afin de s’assurer contre une perte de gain résultant d’une incapacité de travail. Cela sera d’autant plus relevant s’il/si elle exerce une activité lucrative indépendante, car la plupart des indépendant(e)s n’ont pas de 2ème pilier. La constitution d’un capital via une assurance-vie permet également de venir compléter une prévoyance souvent largement insuffisante.
Dans le cas d’une famille, celle-ci souhaitera se prémunir contre les pertes financières résultant du décès ou de l’incapacité de gain du chef/de la cheffe de ménage. La constitution d’un capital permettra en outre de venir compléter la couverture relevant de l’AVS et de la caisse de pension, souvent insuffisante, ou de combler des lacunes. En souscrivant à une assurance-vie, la famille s’assure ainsi que les frais fixes comme le loyer, ceux de logement, ceux d’éducation des enfants ou l’entretien de la famille seront couverts en cas d’événement malheureux.
La situation des concubins, surtout si l’un d’eux ne travaille pas, peut s’avérer problématique dans la mesure où les prestations des assurances sociales (notamment le 1er pilier) ne sont généralement versées qu’aux couples mariés (rente de veuf/veuve, etc.). S’agissant du 2ème pilier, la situation dépendra du règlement de la caisse de pension. La souscription d’une assurance-vie dans le cadre du 3ème pilier B permettra au concubin et aux enfants non communs de bénéficier d’une couverture adéquate, contrairement au pilier 3A où l’ordre des bénéficiaires est fixé par la loi (les enfants biologiques arrivent au premier rang, et ensuite seulement le partenaire (sauf exception notamment en cas de concubinage qualifié)).
Enfin, l’assurance-vie prend tout son sens dans le cadre de la propriété d’un logement hypothéqué. D’ailleurs, les banques exigent souvent de l’emprunteur qu’il contracte une assurance-décès ou incapacité de gain afin de garantir le paiement des intérêts et l’amortissement de la dette.
A noter qu’il est en principe parfaitement autorisé de conclure plusieurs polices d’assurance-vie couvrant le même risque, à condition généralement d’indiquer à l’assureur toutes les polices déjà existantes au moment de la demande.
Combien coûte une assurance-vie en Suisse ?
Le montant des primes dépend de nombreux facteurs parmi lesquels :
- l’âge au moment de la conclusion du contrat (primes nivelées) ;
- l’âge atteint au début de chaque année contractuelle (primes évolutives) ;
- l’état de santé de l’assuré, notamment s’il est fumeur ou non-fumeur ;
- le montant du capital assuré ;
- la couverture des prestations (décès et/ou incapacité, etc.) ;
- le sexe (les femmes bénéficient généralement de primes moins élevées que les hommes) ;
- l’option d’exonération du versement des primes ;
- la somme d’assurance constante ou décroissante ;
- la profession et les loisirs de la personne assurée.
Il est très important de comparer les offres des différents assureurs dans la mesure où pour un même profil, les primes peuvent varier du simple au double.
Pour choisir son assurance-vie, il est essentiel de définir clairement ses objectifs financiers, d’évaluer ses besoins en matière de couverture et de comparer attentivement les différentes options proposées par les assureurs en termes de coûts, de garanties et de flexibilité.
Quelle est la différence entre le pilier 3A et le pilier 3B ?
Pour rappel, la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité en Suisse repose sur le système dit des « trois piliers ». Le 1er pilier correspond à la prévoyance étatique et comprend notamment l’assurance fédérale vieillesse et survivants (AVS), l’assurance-invalidité (AI), l’allocation pour perte de gain (APG) et l’assurance chômage (AC). Le 2ème pilier concerne la prévoyance professionnelle (fonds de pension, etc.), et sert à garantir le maintien du niveau de vie habituel des personnes assurées et de leurs proches lors de la retraite, en cas d’invalidité ou de décès. Le 3ème pilier enfin est lié à la prévoyance privée facultative, en partie assortie d’avantages fiscaux. Il permet de combler de manière ciblée les éventuelles lacunes de revenu à la retraite, en cas d’incapacité de gain ou de décès et se décline en prévoyance privée liée (appelée 3A) et prévoyance privée libre (appelée 3B). Il est possible de cotiser à la fois au 3ème pilier A et au 3ème pilier B. Enfin, on relèvera que l’assurance-vie peut relever soit de la prévoyance libre (pilier 3B) soit de la prévoyance liée (pilier 3A).
Dans le détail :
Le 3ème pilier A
Toute personne exerçant une activité lucrative en Suisse (et donc y compris les travailleurs frontaliers) peut cotiser au pilier 3A jusqu’à un montant maximal et déduire celui-ci des impôts. Les personnes qui sont affiliées à une caisse de pension par l’intermédiaire de leur employeur ont droit à un versement maximal de CHF 7’258 pour l’année 2025. Les indépendants ou ceux qui ont un revenu LPP annuel inférieur à CHF 22’680 peuvent bénéficier d’un versement de 20% après déduction des prestations sociales pendant l’année 2025, jusqu’à un maximum de CHF 36’288. Les personnes qui ont cessé temporairement de travailler peuvent continuer à cotiser au pilier 3A (chômage, service militaire, maladie, etc.).
A noter que depuis le 1er janvier 2025, les résidents suisses ont la possibilité de rattraper les cotisations non versées au pilier 3A si leurs plafonds de versement annuels n’ont pas été intégralement utilisés par le passé. Les cotisations manquantes peuvent être rattrapées rétroactivement sur une période allant jusqu’à 10 ans. Cette nouvelle réglementation vise ainsi à renforcer la prévoyance privée et à offrir davantage de flexibilité pour la planification de la retraite.
Il convient toutefois de relever que les versements rétroactifs pour les années antérieures à l’entrée en vigueur de la réglementation ne sont pas autorisés. Ainsi, le premier rachat rétroactif peut être effectué en 2026 pour l’année 2025.
Par ailleurs, le montant annuel maximal doit être intégralement versé pour chaque année concernée par un rachat (il faut ainsi cotiser jusqu’au plafond de l’année en cours).
De plus, un revenu soumis à l’AVS est requis pour l’année du rachat ainsi que pour l’année rétroactive ; en d’autres termes, la personne doit avoir eu le droit de verser des cotisations au pilier 3A pendant l’année pour laquelle elle entend verser rétroactivement des cotisations ainsi que pendant l’année au cours de laquelle elle effectue le rachat.
Enfin, les rachats sont limités à la cotisation maximale. Ainsi, dans le cas où vous avez déjà cotisé le maximum chaque année, et que le plafond pour l’année d’après augmente, comme c’est le cas entre 2024 et 2025 par exemple, cela ne libérera pas de droit de rachat supplémentaire, la cotisation maximale du 3ème pilier A est limité au plafond fixé pour l’année en question.
Bien entendu, aucun rachat ne sera possible si vous avez déjà touché une prestation de retraite, par exemple si vous avez retiré en partie votre 3ème pilier.
Les rachats effectués rétroactivement bénéficient des mêmes déductions fiscales que les cotisations annuelles ordinaires, offrant ainsi une opportunité d’optimisation fiscale (voir ci-dessous).
Les caractéristiques principales du pilier 3A sont les suivantes :
- comme indiqué ci-dessus, le montant maximal que vous pouvez verser chaque année est limité (sous réserve de rachats ultérieurs) ;
- les cotisations que vous versez peuvent, en revanche, être pleinement déduites de vos impôts. Le pilier 3A a fait l’objet d’une ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) ainsi que d’une circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » ;
- en général, le capital est versé au moment de la retraite, mais au plus tôt 5 ans avant l’âge ordinaire de celle-ci (65 ans pour les hommes et les femmes) et au plus tard 5 ans après (il est donc possible de cotiser après l’âge de la retraite). La totalité du capital doit être retirée au moment du versement et sera soumise à imposition donnant lieu à un impôt unique prélevé à un taux réduit, séparément des autres revenus. Le taux d’imposition varie selon les cantons ;
- le retrait anticipé du capital est soumis à des conditions strictes, à savoir :
- vous voulez acheter ou construire un logement pour vos propres besoins ou rembourser des prêts hypothécaires ;
- vous quittez définitivement la Suisse ;
- vous entendez vous mettre à votre propre compte ou changer d’activité lucrative indépendante ;
- vous souhaitez racheter des années de cotisations au 2ème pilier ;
- vous recevez une rente complète d’invalidité AI et ce risque n’est pas assuré.
- les personnes suivantes peuvent être bénéficiaires du 3ème pilier A :
- en cas de survie, le preneur de prévoyance ;
- en cas de décès de ce dernier, dans l’ordre :
- ◊ le conjoint ou le partenaire enregistré survivant ;
- ◊les descendants directs ainsi que les personnes auxquelles le défunt subvenait à l’entretien de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs ;
- ◊ les parents ;
- ◊ les frères et sœurs ;
- ◊ les autres héritiers.
- enfin, sont admises uniquement deux formes de prévoyance pour le 3ème pilier A, à savoir :
- auprès d’un établissement bancaire ;
- auprès d’une assurance.
Il est toutefois possible, et même souhaitable, de combiner plusieurs solutions ou comptes de prévoyance au 3ème pilier A, notamment afin de réduire la fiscalité, en évitant un versement intégral au même moment (échelonnement afin d’éviter le barème progressif). Ainsi, il est recommandé d’ouvrir un second compte 3ème pilier A au-delà de CHF 50’000 d’épargne.
Le 3ème pilier B
Le pilier 3B fait partie de la prévoyance libre non liée à la retraite, et constitue un excellent complément au pilier 3A. Ainsi, tout le monde peut y cotiser, indépendamment de son activité professionnelle et de son lieu de résidence, et la souscription n’est soumise à aucune condition particulière. En d’autres termes, vous épargnez à votre rythme, selon les modalités de votre choix.
Les caractéristiques du pilier 3B sont ainsi les suivantes :
- le montant qu’il est possible de cotiser est illimité ;
- vous pouvez alimenter votre épargne même après votre départ à la retraite ;
- les avantages fiscaux sont, en revanche, limités (en principe le capital est imposé annuellement mais il n’y a pas d’impôt supplémentaire au moment du retrait). Il existe des exceptions dans certains cantons comme Genève et Fribourg ;
- il est possible de retirer son 3ème pilier B à tout moment (mais parfois avec des pertes comme par exemple dans le cadre du rachat d’une assurance-vie).
- l’ordre des bénéficiaires est totalement libre, ce qui présente un avantage pour les concubins, sous réserve d’une éventuelle violation des règles sur la réserve héréditaire (amis, proches, famille, etc.).
Contrairement au 3ème pilier A, il est possible choisir parmi un large éventail de solutions de prévoyance. En d’autres termes, le pilier 3B englobe tous les avoirs épargnés de manière facultative (liquidités, assurances-vie, livrets d’épargne ou placements comme des actions, des obligations, des biens immobiliers, des produits structurés, etc.).
A qui s’adresse le 3ème pilier B et quelles sont ses avantages ?
Le pilier 3B est un outil très flexible qui s’adresse à un large éventail d’individus. Ainsi, il est indiqué pour :
- les indépendants qui n’ont pas accès au 2ème pilier et aux caisses de pension. Ils peuvent ainsi prévoir leur retraite et épargner librement, compte tenu de leurs revenus et de leurs objectifs.
- les personnes disposant de revenus importants ; dans la mesure où le 3ème pilier B ne fixe aucun montant maximal de contribution, il est possible d’épargner davantage pour la retraite que dans le cadre du pilier 3A.
- les individus en quête d’optimisation fiscale ; bien que le 3ème pilier B n’offre pas les mêmes avantages que la prévoyance liée, une optimisation fiscale reste néanmoins possible dans certains cantons et selon les produits souscrits (assurance-vie, etc.). Des économies peuvent notamment être réalisées sur l’impôt sur la fortune (voir ci-dessous).
- les personnes qui devront faire face à des dépenses importantes dans l’avenir ; grâce à son importante flexibilité en termes de retraits, vous avez rapidement accès à vos économies pour une dépense imprévue ou un investissement important (maladie, scolarité des enfants, achat d’un bien immobilier, etc.).
En termes d’avantages, le 3ème pilier B permet :
- de rester flexible au niveau des contributions (pas de plafond), des retraits (en tout moment), des bénéficiaires, de la durée et des prestations (libre choix dans pour ces trois dernières composantes) ;
- de diversifier ses investissements par exemple en souscrivant une assurance-vie ;
- de protéger vos proches via une composante assurance ;
- d’optimiser la fiscalité dans certains cas.
Banque ou assurance, mon cœur balance : quelle est la meilleure solution pour mon 3ème pilier ?
Il n’existe pas de réponse tranchée à cette question, les deux institutions présentent des avantages et des inconvénients, et comme souvent, une combinaison est sans doute la meilleure solution. D’une manière générale, la constitution d’un 3ème pilier A dans une banque offrira plus de flexibilité alors que l’assurance garantira plus de sécurité.
En effet, s’agissant de la première option le montant que vous versez auprès de la banque est libre et n’est limité que par le plafond annuel fixé par la loi. En outre, il est possible d’interrompre les versements pendant une période indéterminée, par exemple si vous n’avez plus de revenus ou une diminution de ceux-ci ; le compte 3A restera alors investi dans l’attente de nouveaux paiements. En d’autres termes, vous épargnez à votre rythme. Cette solution est donc idéale en début de carrière lorsque vos revenus sont fluctuants, mais implique également une certaine forme d’autodiscipline (d’après les statistiques, l’épargne est plus importante sur le long terme avec l’assurance que la solution bancaire du fait de la contrainte d’épargne). En résumé, la couverture bancaire s’adresse plus au « célibataire économe ».
Dans le cadre d’une assurance, la flexibilité des versements est nettement moindre. En effet, vous souscrivez une police de prévoyance avec une durée contractuelle fixe, généralement jusqu’à l’âge de la retraite. Vous définissez la somme que vous allez cotiser de manière régulière et vous ne pourrez modifier ce montant qu’après 3 ans de cotisations. Une suspension est généralement possible, mais selon les termes du contrat. En outre, un retrait anticipé selon les conditions légales (départ de Suisse, etc.) entraîne un rachat d’assurance qui n’est généralement pas favorable en début de contrat (durant les 10 premières années).
Comme son nom l’indique, si vous contractez une assurance 3A, celle-ci comprendra une couverture invalidité (en option) et décès. Ainsi, en cas de soucis de santé, l’assurance paiera vos primes à votre place (après un délai d’attente de 3 mois généralement) jusqu’à votre guérison ou la fin du contrat si vous devenez durablement invalide (alternativement l’assurance vous versera une rente), ce qui bien entendu n’est pas possible avec la solution bancaire. Ainsi, avec l’assurance, vous atteignez votre objectif d’épargne préalablement défini à 100%. Si vous décédez, vos héritiers toucheront un capital contractuellement fixé correspondant à la totalité du 3ème pilier, même si toutes les primes n’ont pas été versées. Par ailleurs, ce montant ne rentrera pas dans la masse successorale soumise à imposition. Dans le cas d’un 3ème plier A souscrit auprès d’une banque en revanche, il n’y a aucune garantie du paiement des primes. Par ailleurs, les héritiers ne toucheront que le capital accumulé qui rentrera dans la masse successorale imposable. Enfin, la solution assurance 3A peut être intéressante dans le cadre d’un crédit hypothécaire, celle-ci prenant le relais du paiement des intérêts/amortissements si un malheur vous arrive, permettant à la famille de rester dans le logement, évitant ainsi une vente forcée.
Bien entendu, en contrepartie, les frais liés à l’assurance sont déduits du capital que vous épargnez. En clair, contrairement au 3ème pilier A bancaire, le montant que vous versez chaque année n’est pas attribué dans son intégralité à la prévoyance vieillesse. En termes de coûts, le compte 3A bancaire est plus adapté à l’épargne à court terme alors que l’assurance convient uniquement sur la durée car, comme relevé ci-dessus, une grande partie des frais sont généralement déduits au début. Par ailleurs, il est possible de transférer un pilier 3A d’une banque à l’autre, à moindre frais. Tel n’est pas le cas dans le cadre de la résiliation d’une police d’assurance.
S’agissant des placements, les banques proposent généralement deux alternatives : soit le compte épargne rémunéré, soit le compte de placement (prévoyance-titres). Dans le premier cas, vous bénéficiez d’un intérêt qui varie en fonction de la situation économique ; vous ne risquez pas de perdre d’argent mais le rendement n’est guère plus élevé que le taux d’intérêt ordinaire et il n’est ainsi généralement pas possible de compenser l’inflation. Cette solution est acceptable sur le court terme (moins de 5 ans).
Avec la prévoyance-titres, votre argent est investi dans des instruments financiers selon une politique d’investissement convenue avec la banque (par exemple 30% d’actions, 60% d’obligations, 10% de produits alternatifs, etc.). Sur le long terme, le rendement est nettement supérieur par rapport au compte épargne, mais présente également plus de risques et implique une connaissance des marchés financiers.
Dans le cadre de l’assurance, il est possible d’opter pour une police de prévoyance à capital garanti, pour une prévoyance liée à des fonds ou encore mixte (mélange des deux options précédentes). La première assure un capital vieillesse garanti avec une participation aux éventuels excédents. En clair, si les revenus du capital sont supérieurs à ce qui est prévu ou si l’assurance dégage des bénéfices en raison de sa bonne gestion des risques et des dépenses (diminution du nombre de sinistres, évolution des taux, réduction des coûts, etc.), le bonus est attribué à l’assuré et ajouté au capital vieillesse ou implique une réduction des primes. En clair, le taux d’intérêt global à long terme est un peu meilleur. A noter toutefois, qu’aussi attrayante qu’elle puisse paraître, une participation aux excédents n’est pas le seul critère qui doit être pris en considération dans le choix de votre assurance-vie et il n’y a aucune garantie d’un excédent au cours d’un exercice.
Comme son nom l’indique, en cas de prévoyance liée à des fonds, la prime d’épargne est investie dans des fonds de placement. Cette solution est nettement plus risquée (sans une garantie plancher, il existe un risque de perte totale du capital) car elle dépend de l’évolution des marchés financiers (risques de cours, de change, de taux d’intérêts, etc.), mais offre des perspectives de rendement nettement supérieures sur le long terme. En outre, il convient d’être attentif aux frais de souscription et de gestion du fonds. A l’échéance ou en cas de rachat, l’assureur versera à l’assuré la valeur boursière à cet instant des parts du fonds (soit sous forme d’un versement unique ou échelonné, voire même un transfert des parts du fonds de placement sur un compte titres).
On relèvera qu’en cas de faillite de la banque, seul un montant de CHF 100’000 est garanti alors que dans le cadre d’un 3ème pilier A assurance, les avoirs sont garantis à 100%.
A noter qu’il n’y a aucune différence entre banque et assurance du point de vue fiscal (déductions, etc.), ni au niveau des dispositions légales. Les restrictions en matière de retraits sont également identiques. En revanche, la mise en gage du 3ème pilier A bancaire n’est possible que dans le cadre de l’acquisition d’un logement à titre de résidence principale alors qu’elle est libre avec l’assurance.
Comment est imposé le 3ème pilier A et B dans le cadre de l’assurance-vie ?
La fiscalité de l’assurance-vie est complexe et dépend, outre des caractéristiques contractuelles convenues, des règles fixées par le droit fédéral et cantonal. Une grande distinction doit être opérée selon que l’assurance-vie a été conclue dans le cadre de la prévoyance liée ou libre.
3ème pilier A
Comme déjà relevé, en matière de prévoyance liée (3ème pilier A), les primes d’assurance-vie sont déductibles du revenu imposable à concurrence de CHF 7’258 pour les personnes affiliées à une caisse de pension et 20% du revenu net imposable, jusqu’à un maximum de CHF 36’288, pour les autres travailleurs (indépendants, etc.) (taux 2025). Il en va de même des rachats ultérieurs.
Par ailleurs, les assurances-vie du 3ème pilier A ne sont pas considérées comme des actifs du point de vue de la fortune. Elles ne sont pas soumises à l’impôt sur la fortune. Il n’y a donc pas besoin d’indiquer dans sa déclaration fiscale, la valeur de rachat de l’assurance-vie.
En revanche, les prestations en capital versées par l’assureur sont considérées comme du revenu imposable, taxées selon un barème progressif spécial. En clair, l’impôt est calculé et prélevé séparément des autres revenus du contribuable. Aucune déduction sociale n’est possible et plusieurs prestations en capital (par exemple du 2ème et du 3ème piliers) viennent s’additionner au cours d’une même période fiscale, y compris ceux du conjoint. L’imposition de l’assurance-vie est calculée de manière différente selon les cantons ; ainsi elle peut être sous la forme d’une fraction du taux d’imposition ordinaire (par exemple à Genève, Vaud, Neuchâtel et au niveau fédéral), par le calcul intermédiaire du taux de rente (Tessin, Valais, Zurich), par un taux distinct (Jura, Berne et Zoug par exemple), ou encore exprimé d’après un pourcentage fixe (à St-Gall, Thurgovie et Uri).
Les versements de l’assurance-vie sont soumis tant à l’impôt fédéral direct qu’à l’impôt cantonal et communal selon le barème fixé par la loi (soit 1/5 du taux ordinaire au niveau fédéral, articles 36 et 38 al. 2 LIFD, idem à Genève, articles 41 et 45 al. 2 LIPP).
Pour un retrait en capital de CHF 500’000 les cantons les plus favorables sont Appenzell Rhodes-Intérieures (5.2%, y compris l’IFD), Nidwald (5.6% à Stans, y compris l’IFD), Uri (5.8% à Altdorf, y compris l’IFD) et Schaffhouse (5.8%, y compris l’IFD). Les cantons les moins favorables sont le Jura (9.7% à Delémont, y compris l’IFD), Argovie (10% à Herisau, y compris l’IFD) et Fribourg (11.3%, y compris l’IFD).
Cette imposition peut paraître de prime abord élevée mais elle demeure minimum par rapport aux montants d’impôts économisés au fil des années par la déduction des primes. Par ailleurs, afin d’éviter la progressivité de l’impôt, il est intéressant de souscrire à plusieurs 3ème piliers A et de retirer ceux-ci de manière échelonnée.
A noter que les rentes sont, en revanche, pleinement imposables, sans bénéficier d’une fiscalité allégée. Par ailleurs, les prestations de la prévoyance individuelle liée sont toujours exonérées de l’impôt sur les successions.
3ème pilier B
L’imposition de la prévoyance libre est plus complexe et dépend notamment du type d’assurance-vie, notamment si elle a été financée par une prime unique ou des versements périodiques ou si elle est susceptible de rachat ou non.
Toute d’abord, il n’y a pas de déductions fiscales spéciales s’agissant des primes de la prévoyance libre (les déductions admises rentrent dans le cadre des déductions à forfait pour les primes d’assurances générales, notamment maladie, et donc n’offrent aucun avantage fiscal au final), sauf dans certains cantons (par exemple Genève et Fribourg), et en tout état de cause pas au niveau fédéral (IFD).
Dans le canton de Genève (2025), il est ainsi possible de déduire jusqu’à CHF 2’232 par année si vous êtes salarié et célibataire, veuf ou divorcé. Un couple marié (ou partenariat enregistré), dont les deux sont salariés, va déduire jusqu’à CHF 3’348, en ajoutant CHF 913 par enfant.
Si vous êtes indépendant, les montants sont plus élevés. Un célibataire pourra déduire jusqu’à CHF 4’464 par an tandis qu’un couple d’indépendants déduira CHF 6’696 maximum, en ajoutant CHF 1’826 par enfant.
Il est possible de cumuler les déductions fiscales en additionnant les montants du 3ème pilier A et du 3ème pilier B.
- Assurance-vie risque pur :
S’agissant des autres impôts, dans l’hypothèse d’une assurance-vie risque pur, il n’y a pas d’imposition sur la fortune. En cas de décès, les prestations en capital seront imposées à un taux réduit, à l’instar du pilier 3A. Les rentes, en revanche, seront pleinement imposées. Par ailleurs, il n’y a aucune imposition en matière successorale, l’impôt sur le revenu excluant celui sur les successions, ce qui peut être intéressant pour les concubins.
- Assurance-vie mixte :
Dans le cadre d’une assurance-vie mixte, l’impôt sur la fortune est dû annuellement ; ainsi, il est obligatoire d’indiquer chaque année la valeur de rachat de son assurance dans sa déclaration fiscale, afin que l’administration fiscale puisse en tenir compte pour l’imposition cantonale de la fortune.
En revanche, les prestations en capital sont exonérées dans l’hypothèse de versements de primes périodiques, que cela soit en cas de rachat, de vie ou de décès. L’impôt sur les successions est par contre dû, en fonction du degré de parenté, en cas de décès de l’assuré.
Tel est également le cas pour les versements en cas de vie et de rachat lors de financement par prime unique mais seulement si l’assurance a le caractère de prévoyance vieillesse (tel est le cas lorsque la prestation a lieu après le 60ème anniversaire de la personne assurée au titre d’une relation contractuelle d’une durée d’au moins 5 ans (10 ans dans le cas d’une assurance-vie liée à des fonds) établie avant l’âge de 66 ans et que le preneur d’assurance soit la personne assurée). En contrepartie, un droit de timbre pour l’assurance-vie à prime unique rachetable à hauteur de 2.5% doit être acquitté au moment de verser la prime. Là encore, en cas de décès, l’impôt sur les successions peut être dû selon les cantons en fonction du degré de parenté. Bien entendu, l’impôt sur le revenu est exonéré en toute hypothèse, en cas de décès et d’assurance-vie à prime unique.
S’agissant du capital invalidité, il sera imposé au taux réduit comme pour le 3ème pilier A. Les rentes invalidité constitueront du revenu imposable en plein. Enfin, les rentes en cas de vie seront imposables à hauteur de 40%. Les rentes décès seront elles imposables à 100%.
En tenant compte uniquement des prestations de prévoyance des 1er et 2ème piliers, vous ne percevrez à la retraite qu’environ 60% de votre dernier revenu. Les piliers 3A et 3B contribuent à maintenir votre niveau de vie habituel une fois à la retraite et à combler d’éventuelles lacunes de prévoyance.
Que se passe-t-il avec mon assurance-vie en cas de divorce ?
L’article 122 du Code civil suisse prévoit que les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. Cette règle ne concerne toutefois que le 2ème pilier. En effet, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 137 III 337 et ATF 129 III 257) que le 3ème pilier se liquide, dans le cadre d’un divorce, selon les règles du régime matrimonial uniquement. Ainsi, ce dernier est déterminant pour définir si le patrimoine de la prévoyance privée (3A et 3B) sera partagé ou non. Le fait que celui-ci soit détenu auprès d’un établissement bancaire ou dans le cadre d’une assurance-vie est sans importance. En revanche, à moins que les prestations ne soient déjà échues, seules peuvent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial, les assurances-vie susceptibles de rachat à l’exclusion des assurances-vie risque pur.
Ainsi, dans le cadre du régime ordinaire de la participation aux acquêts, si l’assurance-vie a été financée au moyen des acquêts de l’un des époux, il conviendra de partager par moitié l’épargne accumulée. Il n’y aura en revanche aucune répartition en cas de versement des primes via les fonds propres de l’un des deux conjoints. En cas de régime de séparation de biens, le 3ème pilier ne sera bien entendu pas soumis au partage. Enfin, dans le régime de la communauté de biens, il y aura, sauf convention contraire, partage des avoirs de prévoyance.
On mentionnera que des règles spéciales s’appliquent s’agissant des indemnités en capital échues, versées en cas d’invalidité du preneur d’assurance (articles 197 al. 2 ch. 3 CC et 207 al. 2 CC).
Par ailleurs, si des prestations découlant d’un contrat d’assurance-vie ont été versées à des tiers durant le régime matrimonial et que celles-ci sont rattachées aux acquêts, lesdites prestations peuvent être sujettes à réunion en vertu de l’article 208 al. 1 CC, notamment s’il s’agit d’une libéralité à laquelle l’époux n’a pas consenti, intervenue dans les 5 années avant la dissolution du régime.
S’agissant du partage proprement dit dans le jugement sur les effets accessoires du divorce, la voie la plus simple (tant pour la prévoyance liée que libre) est le maintien à l’identique du contrat d’assurance-vie avec une prise en compte purement comptable de sa valeur de rachat dans le calcul de la liquidation du régime matrimonial. Les autres solutions engendreront une perte de la couverture d’assurance par l’assuré avec une possible reconstitution mais à un coût supérieur.
On relèvera que dans le cadre du 3ème pilier B, le juge ne peut pas condamner le preneur d’assurance à prendre une clause bénéficiaire en faveur de son ex-conjoint, en raison du caractère strictement personnel du droit de désignation. Le juge peut, en revanche, ordonner dans ce cadre le rachat, le nantissement ou encore la cession des droits découlant du contrat.
De même, nonobstant la formulation malheureuse de l’article 4 al. 3 OPP 3, le juge ne peut pas céder des droits dans le cadre du 3ème pilier A sans en changer la personne assurée (ce qui est difficilement envisageable), mais uniquement ordonner le transfert d’une somme d’argent. Ainsi, le tribunal ne peut, en matière de prévoyance liée, qu’exiger le rachat de l’assurance-vie en tout ou en partie et demander le versement du montant à l’ex-conjoint du preneur d’assurance.
A noter que si une partie des avoirs du pilier 3A de l’un des ex-conjoints est transférée à l’autre, cet avoir restera lié. En d’autres termes, la banque ou l’assurance doit transférer les fonds concernés à une institution du 3ème pilier, une caisse de pension ou une fondation de libre passage (2ème pilier). Un retrait des avoirs du 3ème pilier A n’est possible que dans les cas prévus par la loi (départ à l’étranger, etc.).
Qu’en est-il des règles sur la réserve héréditaire ?
Le 3ème pilier A est expressément exclu de la masse successorale. Cela signifie que les assureurs peuvent verser directement les avoirs de la prévoyance liée aux bénéficiaires déterminés, sans consulter les héritiers légaux. En revanche, les prétentions résultant de l’assurance-vie peuvent être sujettes à réduction en cas de violation de la réserve héréditaire, mais uniquement pour leur valeur de rachat et non pour le capital assuré (articles 476 et 529 CC). A noter que ces dispositions s’appliquent par analogie aux produits d’assurances-vie du 3ème pilier B susceptibles de rachat.
S’agissant en revanche de l’assurance-vie risque pur, les prestations ne rentrent jamais dans le calcul des réserves héréditaires, puisqu’il s’agit d’une assurance sans valeur de rachat.
Quid de la rente viagère ?
La rente viagère est une assurance-vie garantissant en échange d’un capital (via des versements périodiques ou une prime unique), un revenu régulier jusqu’à votre décès. La prestation de l’assureur est versée à vie, même lorsque le capital est épuisé. Vous décidez du montant de la prime ou de la rente que vous souhaitez obtenir, le début et la périodicité du versement de celle-ci. La rente viagère peut être constituée dans le cadre de la prévoyance libre ou liée. Le montant de la rente dépendra de plusieurs facteurs comme le montant du capital versé à l’assureur, le sexe et l’âge de l’assuré (plus l’âge est avancé, plus la rente sera élevée), le taux de conversion (généralement plus bas qu’une caisse de pension) et les options choisies.
Parmi ces dernières, on distingue principalement :
- la rente viagère immédiate qui intervient dès le versement du capital de celle différée, qui débute à une date future définie contractuellement, généralement l’âge de la retraite, le capital étant alors constitué dans le cadre d’un 3ème pilier ;
- avec ou sans restitution ; dans la première hypothèse, en cas de décès, la personne désignée ou la famille se voit restituer le capital versé, sans intérêt et avec déduction des rentes déjà perçues (un droit de timbre de 2.5% est alors prélevé sur le versement de la prime unique). Dans l’autre cas, rien n’est rendu aux proches mais en contrepartie, le montant de la rente est plus élevé ;
- rachetable ou non (impliquant une potentielle imposition sur la fortune dans le premier cas selon les cantons) ;
- sur une ou deux têtes ; si la rente viagère est conclue sur deux têtes, elle permet à votre conjoint de continuer à recevoir la rente après votre décès.
Au niveau fiscal, jusqu’au 31 décembre 2024, une fraction fixe de 40% du versement était considérée comme revenu imposable (soit les intérêts, le reste constituant un remboursement de capital non imposable). Depuis le 1er janvier 2025, au lieu des 40%, la part de revenu imposable de la prestation de rente garantie (déterminée lors de la conclusion du contrat) est calculée selon la loi sur le contrat d’assurance en fonction du taux d’intérêt maximal de la FINMA. Pour les contrats conclus en 2024, cela se traduit par une imposition de seulement 1 % de la rente garantie. Les éventuelles prestations excédentaires sont toujours imposables à hauteur de 70%.
Ainsi, par exemple avant 2025 : Pour une rente annuelle de CHF 100’000, CHF 40’000 étaient soumis à l’impôt sur le revenu.
Depuis 2025 : Pour une rente annuelle de CHF 100’000 conclue en 2024, seulement CHF 1’000 sont imposables.
S’agissant des contrats conclus en 2025, le taux technique de la FINMA augmente à 0,35 %, entraînant un taux d’imposition de 4%.
Les nouvelles règles s’appliquent également de manière rétroactive pour les contrats conclu avant 2024. Le taux d’imposition de la rente viagère dépend de l’année de conclusion du contrat et du taux technique en vigueur à cette époque selon une formule mathématique détaillée dans la Loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (par exemple 1% entre 2017 et 2023 mais 19% pour celle conclue en 2010 ou 2011).
Pour les rentes viagères et les nantissements selon le Code des obligations ainsi que pour les assurances étrangères de rentes viagères, la part de rendement imposable est désormais déterminée en fonction du rendement moyen des obligations de la Confédération à dix ans. Le contribuable doit déterminer lui-même la part de rendement.
Les autres scénarios sont réglés en détail dans une recommandation édictée par la Conférence suisse des impôts (rachat du contrat pendant le différé lorsque la rente viagère a un caractère de prévoyance vieillesse ou non, en cas de décès, etc.).
Après calculs, on constate rapidement que la rente viagère n’est généralement favorable que pour les rentiers qui deviennent très âgés et qui ont une espérance de vie supérieure à la moyenne. En effet, les assureurs font des calculs extrêmement précis qui ne profitent jamais aux assurés. Le versement d’un capital est ainsi souvent plus avantageux et constitue une garantie de flexibilité. En clair, la rente viagère constitue une sécurité chèrement payée. A tout le moins, il est recommandé de combiner les deux approches (capital et rente).