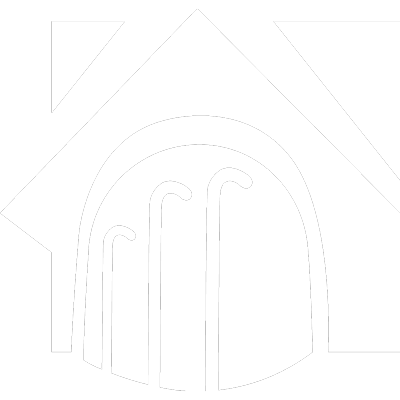Table des matières
- Philanthropie : l’art de faire le bien
- Mais qu’est-ce que la philanthropie au fait ?
- Que sont les objectifs de développement durable ?
- Philanthropie, impact investing et investissement socialement responsable (ISR) : quelles différences ?
- Pourquoi s’engager dans la philanthropie ?
- Quelles sont les grandes causes de la philanthropie ?
- Comment atteindre mes objectifs en matière de philanthropie ?
- Le secteur de la philanthropie en Suisse
- Comment créer une fondation caritative en Suisse ?
- La philanthropie et ses détracteurs
Philanthropie : l’art de faire le bien
Bon nombre d’entrepreneurs fortunés passent leur vie entière à constituer un patrimoine pour le transmettre aux générations suivantes. À l’heure du bilan, ils développent souvent un sens aigu de la conscience sociale et environnementale et cherchent à laisser un héritage positif derrière eux, en redonnant à la communauté ce qu’elle leur a offert. La philanthropie est un moyen de marquer son empreinte sur le monde et de faire le bien autour de soi.
Lorsque l’on plonge dans ce monde fascinant, on pense souvent que le plus difficile est de prendre la décision de donner. Or, la véritable question est celle de savoir « comment bien donner », soit de déterminer par quels outils obtenir l’effet le plus positif possible pour ceux qui bénéficient de la générosité des autres. La philanthropie ne se résume ainsi pas uniquement à « faire le bien », mais de « bien le faire » !
Le service de conseil en philanthropie d’Onyx Trust vous accompagne à tous les étapes du processus philanthropique. Ensemble, nous donnons vie à vos idées par la mise en œuvre d’une stratégie de mécénat concrète et efficace.
Notre assistance couvre notamment les aspects suivants :
- le choix et l’implémentation des instruments juridiques adéquates à votre projet ;
- la mise en place de leviers afin d’obtenir un impact supérieur sur votre engagement ;
- la gestion du patrimoine caritatif ;
- l’organisation d’événements destinés à la collecte de fonds.
En outre, grâce à notre réseau, nous mettons en contact les familles fortunées désireuses de rendre la planète un endroit meilleur pour tous, afin qu’elles puissent échanger leurs expériences et apprendre de celles des autres.
Concrètement, chez Onyx Trust, nous accompagnons nos clients en trois étapes : tout d’abord, nous consultons les membres de la famille afin de dégager un thème philanthropique commun (il s’agit de répondre à la question suivante : « quelles valeurs je souhaite mettre en avant pour la société et pour moi ? »).
En tant que seconde étape, nous identifions les acteurs et partenaires les mieux à même à concrétiser le projet et définissons avec vous le niveau d’engagement et de visibilité que vous entendez donner, sans oublier votre horizon temporel (quand donner et à quel rythme ?). Tout comme les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprise qui s’appuient sur une stratégie pour atteindre leurs buts, les philanthropes doivent eux aussi développer une réflexion stratégique approfondie, le but étant de maximiser les effets positifs de leur don pour les bénéficiaires, la cause qu’ils soutiennent et la société au sens large. En particulier, il sied de bien comprendre la cause que l’on entend soutenir afin d’ajuster son intervention et d’éviter de tomber dans le piège de l’assistanat, respectivement de la dépendance ou de continuer à soutenir des projets qui ne sont pas viables.
En troisième lieu, avec le concours de nos experts (avocats, experts-comptables, fiscalistes, etc.), nous sélectionnons le véhicule le plus adapté à vos objectifs (fondation ou trust caritatif, fonds de dotation, association, etc.).
Selon vos désidératas, nous intervenons ensuite au niveau de la gestion administrative de la structure ou du projet (enregistrement de l’entité, rédaction des statuts, du règlement d’organisation et de la politique d’investissement, ouverture des comptes bancaires, suivi fiscal, tenue des séances du conseil de fondation, recherche de partenaires, etc.). Enfin, nous aidons à la gestion et à la supervision du patrimoine financier et non financier, en implémentant ou en surveillant l’allocation d’actifs définie, y compris par des visites annuelles sur place, au besoin par des humanitaires de terrain.
Mais qu’est-ce que la philanthropie au fait ?
La Journée internationale de la charité a lieu chaque année le 5 septembre et a pour but de sensibiliser et de mobiliser les individus, les ONG et l’ensemble des acteurs impliqués dans le monde pour aider les autres à travers des activités bénévoles et philanthropiques. Dans certains pays comme en Suisse, l’élan philanthropique dispose même d’une journée nationale, le Giving Tuesday (le 2 décembre 2025), mis en place pour compenser la folie consumériste du Black Friday.
Définir la philanthropie de manière simple est toutefois malaisé. Le mot philanthropie provient du grec ancien « phílos » (aimer) et « ánthrôpos » (humain) qui signifie littéralement « amour pour l’humanité ». Ce terme peut donc renvoyer à d’innombrables choses et ne définit en rien des pratiques ou des configurations dans lesquelles elle s’inscrit. On s’accorde toutefois à définir la philanthropie comme l’accomplissement d’actes désintéressés pour le bien d’autrui. Il s’agit ainsi de donner sans rien attendre en retour et la démarche ne saurait s’apparenter uniquement à combien d’argent une personne peut donner, il s’agit davantage d’un geste de compassion et de communauté qui place l’humain et ses actions au centre. La philanthropie s’affranchit de toute conviction religieuse, dogmatique ou politique mais présente toujours une dimension éthique (la tendance à vouloir le bien des hommes) et se retrouve néanmoins dans toutes les religions du monde.
Redonner à la société ce qu’elle nous a offert définit à notre sens bien la philanthropie : assurer la création de sa propre richesse et dans un second temps reverser une partie de ses gains.
A noter qu’un grand nombre d’activités philanthropiques ne se déroule pas dans un cadre organisé, comme par exemple apporter de l’aide à ses voisins.
Peu importe la définition qu’on lui donne, la philanthropie connaît depuis une vingtaine d’années un dynamisme sans précédent, encouragée non seulement par le concept du Giving Pledge, soit le serment lancé par les ex-époux Gates et Warren Buffet de donner au moins la moitié de leur fortune de leur vivant, mais également par la puissance publique estimant que certains sujets doivent être développés et financés par des acteurs privés, à coups de dispositifs légaux et fiscaux ultra-favorables.
Enfin, si la philanthropie c’est chic, un must-have, une carte de visite dans les dîners mondains, le secteur tend à se moderniser notamment avec les fortunes des baby-boomers qui se transmettent aujourd’hui aux prochaines générations (notamment « Y »), plus orientées vers l’entrepreneuriat social, l’impact investing et le co-financement, marquées par une volonté ferme de changer le monde dès aujourd’hui, fortes d’une approche plus internationale s’agissant des causes et des régions visées et utilisant les nouveaux outils digitaux (comme les réseaux sociaux) ainsi que des stratégies innovantes à large échelle.
Que sont les objectifs de développement durable ?
Adoptés par 193 états membres des Nations unies en 2015, les objectifs de développement durable (ODD) (Sustainable Development Goals, SDG en anglais) visent 17 grands buts à mettre en œuvre d’ici 2030. Ils tiennent compte équitablement de la dimension économique, sociale et environnementale du développement durable et intègrent l’éradication de la pauvreté dans un dispositif commun.
Parmi les objectifs, on citera par exemple :
- Éliminer de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ;
- Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ;
- Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ;
- Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ;
- Parvenir à l’égalité des sexes ;
- Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ;
- Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable ;
- Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ;
- Établir des modes de consommation et de production durables ;
- Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions ;
- Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ;
- Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ;
- Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.
Les ODD ont été précédés par les objectifs du millénaire pour le développement, ou OMD, adoptés en l’an 2000 et concernaient principalement des aspects sociaux (la lutte contre la faim, la maladie, etc.). Même si de grands progrès ont été constatés au cours des 15 années qui ont suivies, visant notamment à réduire de moitié la pauvreté dans le monde, tous les projets n’ont pas pu aboutir. Tirant les enseignements des OMD, les ODD poursuivent beaucoup plus d’objectifs et sont conçus pour couvrir un spectre beaucoup plus large. Ont notamment été associés dans les décisions des organisations sociales, des scientifiques et des universitaires, ainsi que le secteur privé.
Ces ODD constituent une véritable feuille de route pour la philanthropie dans la mesure où ils offrent à tous une vision globale et systémique des priorités d’engagement et d’investissement pour le bien commun dans le futur.
En outre, pour atteindre les objectifs de développement durable, l’engagement de tous les secteurs est nécessaire, à savoir le secteur public, privé et associatif (ONG, NPO, etc.), l’économie, la société, la science et chaque individu. En clair, le développement durable est une tâche qui incombe à tous.
Faire le bien, mais surtout bien le faire.
Philanthropie, impact investing et investissement socialement responsable (ISR) : quelles différences ?
Ces trois notions ont tendance aujourd’hui à être mélangées, notamment par les médias. Or, si elles constituent trois approches complémentaires afin de donner du sens à ses investissements, elles reposent sur des concepts et des caractéristiques distincts.
La philanthropie met l’humain au premier plan et se focalise uniquement sur l’objectif social et environnemental à atteindre, sans espérer un retour financier en échange. Un philanthrope agit de manière totalement désintéressée et cherche à améliorer le monde et le sort de ses semblables par des moyens divers (dons financiers, mécénat de compétences, bénévolat, etc.).
L’impact investing (investissement à impact), né en 2007 à la suite de l’éclatement de la crise financière, vise quant à lui non seulement à obtenir des retombées sociales et environnementales positives mais en plus un rendement financier. La réalisation de ce double objectif sera ensuite mesurée et rendue compte à l’investisseur. L’investissement à impact se situe donc entre la philanthropie classique et la pure recherche de rendement. Ce type de stratégie ne cesse de devenir de plus en plus populaire auprès notamment de la jeune génération, remettant en cause le modèle traditionnel de la philanthropie, dans un désire de concilier mission gratifiante et obtention d’un rendement financier. L’univers de placement est très large et regroupe à la fois les instruments financiers classiques comme les actions, les obligations, les fonds de placement, mais également des instruments innovants comme les social impact bonds ou le private equity. L’impact investing prend souvent le relais des financements philanthropiques un fois qu’un projet a achevé sa phase de démarrage. Toutefois, ce modèle ne pourra jamais remplacer la philanthropie et doit être considéré comme un complément à cette dernière. Il existe en effet des problèmes sociaux qui ne pourront jamais devenir rentable, tels que la violence des femmes, les abus des droits de l’homme, etc.
Enfin, l’investissement socialement responsable (ISR) consiste à intégrer les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans sa stratégie d’investissement. Les méthodes utilisées comprennent entre autres l’approche d’exclusion (ne pas investir dans l’industrie du tabac ou des entreprises qui ne respectent pas les droits de l’homme par exemple), la best in class (placements dans des sociétés qui surperforment sous l’angle des critère ESG) ou thématique (investissement dans certains secteurs durables comme l’eau, les énergies renouvelables, etc.). Contrairement à l’impact investing, l’ISR n’inclut pas nécessairement des sociétés qui s’engagent dans des pratiques durables ou produisent des biens ou des services. Il s’agit plutôt d’éviter d’avoir un impact négatif sur la société et de favoriser les meilleures pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Par exemple, Total dispose d’un bon score ESG alors qu’elle déploie une activité commerciale classique.
Pourquoi s’engager dans la philanthropie ?
Pour être heureux/se : participer à des actions solidaires demeure un choix très personnel, et la nature de ses motivations est variée, parfois presque mystérieuse. À défaut de pouvoir soutenir toutes les causes, on jette généralement son dévolu sur celles qui correspondent le plus à nos valeurs et nos convictions. Quoi qu’il en soit, être altruiste fait du bien. Cela permet également de donner du sens à sa vie. Des études scientifiques ont même montré qu’une bonne action stimule certaines zones du cerveau responsables du bonheur. La science prouve ainsi que votre joie sera plus grande si vous consacrez votre existence à faire plaisir aux autres. En plus de changer des vies, les mécènes voient dès lors leur indice de satisfaction augmenter en même temps que leur estime de soi. Cette simple raison devrait déjà vous pousser à devenir philanthrope !
Pour faire le bien : poursuivre l’accomplissement inutile et infini de l’univers, rendre à la société une partie de ce qu’elle nous a donné, palier aux carences de l’état, ou plus cyniquement faire preuve d’égoïsme altruiste pour se donner bonne conscience, peu importe les raisons intérieures qui poussent le mécène à donner, tout acte philanthropique permet de faire du bien autour de soi. En outre, quand on est résolu à rendre le monde meilleur, on augmente ses chances de se créer un karma positif. On attire la chance, le bonheur et la générosité d’autres personnes.
Pour laisser son empreinte : comme déjà relevé, d’une action philanthropique nait souvent une grande satisfaction et un sentiment de bien-être. Certains souhaitent toutefois aller plus loin et laisser leur nom à la postérité, en léguant à leurs descendants un héritage dont ils seront fiers. Ce but sera atteint par la création d’une fondation ou d’un trust caritatif qui perdurera après le décès du constituant. Il est également possible d’effectuer des donations en argent ou en nature à des organisations caritatives ou culturelles déjà établies, qui en retour marqueront leur gratitude par exemple en donnant le nom du contributeur à une salle d’un musée ou un bâtiment.
Pour former les générations suivantes : la philanthropie permet d’inculquer aux générations futures la responsabilité et l’impact que la richesse peut avoir sur la société, renforçant au passage les valeurs de la famille autour des causes qu’elle supporte. Lorsque plusieurs générations œuvrent ensemble pour le bien commun, elles partagent une vision et des objectifs convergents permettant de cimenter la famille. En outre, certains bienfaiteurs décident d’allouer la majeure partie de leur fortune à des œuvres philanthropiques afin d’éviter qu’un héritage important entraîne leurs enfants dans l’oisiveté et l’inoccupation. La philanthropie offre enfin aux plus jeunes la possibilité d’acquérir une expérience en matière de gestion patrimoniale et de gouvernance, ainsi que d’éveiller leur conscience sociale.
Pour bénéficier d’avantages fiscaux : afin d’encourager la population à soutenir la philanthropie, les autorités fiscales accordent généralement de généreux allègements d’impôts, tant aux donateurs qu’aux institutions caritatives. Ainsi par exemple, en Suisse, les associations, les fondations et les autres personnes morales peuvent être exonérées de l’impôt sur le bénéfice, le capital, les successions et les donations ainsi que les droits de mutation sur les immeubles (à certaines conditions) lorsqu’elles poursuivent des buts d’utilité publique ou de service public ou des buts cultuels (articles 56 let. g et h LIFD et 23 al. 1 let f et g LHID au niveau fédéral ; dans le canton de Vaud, article 90 al. 1 let g et h LI, articles 3 let. c et 20 al. 1 let. d LMSD). Les personnes physiques peuvent quant à elles déduire de leur revenu imposable les versements bénévoles faits en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt en raison de leur but d’utilité publique, jusqu’à concurrence de 20 % du revenu net (articles 33a LIFD et 37 al. 1, lettre i LI pour le canton de Vaud). Il en va de même s’agissant des personnes morales (articles 59, let. c LIFD et 95 al. 1 let. c LI).
Transformez votre vision en réalité grâce à une philanthropie réfléchie, en maximisant l’impact de vos actions pour le bien de la société et des générations futures.
Quelles sont les grandes causes de la philanthropie ?
Il existe une large variété de thèmes philanthropiques susceptibles d’intéresser le plus grand nombre de bienfaiteurs, parmi lesquels on peut citer :
- la protection des animaux et de l’environnement ;
- la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion ;
- l’art, les loisirs et la culture ;
- l’éducation ;
- la santé et la recherche ;
- les droits humains.
Même si les ODD constituent une excellente source d’inspiration, il y a autant de possibilités d’intervenir en tant que mécène que de définitions du mot philanthropie. On peut vouloir soutenir financièrement un projet (la construction d’un bâtiment, etc.), promouvoir une cause (le sport, la jeunesse, la recherche), œuvrer à la restauration d’un monument, lutter contre un fléau, conserver des œuvres ou perpétuer la mémoire d’une personne.
Un bon philanthrope est toutefois une personne qui dispose à la fois d’une excellente connaissance de la cause qu’il souhaite soutenir mais également d’une vision claire de ce qu’il entend entreprendre et comment atteindre ses objectifs, afin que ses bonnes intentions aient le plus d’impact possible.
Ainsi par exemple, l’accès à l’éducation pour les plus défavorisés est un thème vaste offrant au bienfaiteur une multitude de possibilités pour soutenir cette cause. Toutefois, l’impact réel et le timing peut varier considérablement selon les moyens utilisés : en effet, un financement pour la construction d’une école n’aura pas le même résultat que le soutien direct à la formation d’enseignants ou encore l’octroi de bourses à des étudiants. Il est ainsi important que le philanthrope définisse non seulement ce qui lui tient à cœur, mais également qu’il comprenne et sache comment atteindre efficacement ses objectifs. Dans le cas contraire, le risque que ses actions se révèlent vaines voire mêmes contreproductives est grand.
Comment atteindre mes objectifs en matière de philanthropie ?
La palette d’outils du philanthrope est large, mais à chaque projet collera un moyen, d’où la nécessité de prendre le temps, avant de se lancer, de s’interroger sur ce que l’on souhaite accomplir, dans quels délais, avec quels moyens et entouré de quelles personnes.
Avant de présenter succinctement les moyens à disposition du philanthrope pour atteindre ses objectifs caritatifs, il est important de « torde le cou » à certaines idées reçues.
Tout d’abord, la philanthropie n’est pas réservée qu’aux personnes très fortunées. Hélas lorsque les médias en parlent, il s’agit généralement de mettre en avant les très gros donateurs comme Bill et Mélinda Gates ou encore Mark Zuckerberg, laissant penser que la philanthropie n’est faite que de grands fleuves et non de petites rivières. Cette idée est bien entendue totalement fausse ; à titre d’exemple, 72% des ménages suisses effectuent des dons chaque année et un ménage sur deux donne plus de 400 francs suisses, ce qui représente au total, tous contributeurs confondus, plus de 2.24 milliards francs suisses octroyés à des œuvres de bienfaisance (chiffres 2023). La philanthropie est donc bien l’affaire de tous.
Ensuite, la philanthropie ne se limite pas à faire des dons en argent. Ainsi, 7,7% de la population suisse fait du bénévolat dans des organisations d’utilité publique, sociales et caritatives pour un engagement d’environ 3.2 heures par semaine. Critiquant une mauvaise utilisation des ressources financières, la génération des milléniaux se montre d’ailleurs de plus en plus hostile à la philosophie du « spray and pray » ; elle préfère une approche plus directe de la philanthropie, dirigée par des actions concrètes sur le terrain, sans recourir aux grandes ONG ou aux agences gouvernementales, comprenant un nombre important d’intermédiaires et diluant drastiquement les ressources qui sont finalement affectées au bien commun. Cette jeune génération est nourrie par cette volonté de véritablement vouloir changer le monde de manière profonde et non pas de simplement mettre un pansement sur la pauvreté, les maladies ou les dégradations environnementales. D’ailleurs, dans la nouvelle conception de la philanthropie, le démuni ne peut plus se satisfaire d’une position d’assisté. Il est destiné à s’émanciper et l’aide qu’il reçoit doit constituer une opportunité afin qu’il devienne autonome, sans argent extérieur.
Enfin, le mot philanthropie ne rime pas forcément avec fondation caritative. Si en 2023, 308 nouvelles fondations d’utilité publique ont vu le jour en Suisse, 220 ont été liquidées. Certes, dans l’idéal, une fondation devrait être pérenne ; toutefois les choses se présentent souvent différemment dans la réalité et nombre de fondations de petite taille doivent faire face à des coûts d’administration élevés, laissant au final des montants bien en deçà des attentes pour réaliser leur but social. C’est pourquoi, avant de foncer « tête baissée » dans la constitution d’une fondation philanthropique, le bienfaiteur devrait examiner les alternatives qui existent pour accomplir ses volontés. Ainsi, de nouvelles possibilités ont vu le jour ces dernières années comme par exemple le regroupement au sein d’une fondation « abritante », la coopération avec d’autres entités, ou le transfert de l’exécution à des sociétés de services.
Gardant à l’esprit ce qui précède, il est possible de classifier les outils à disposition du philanthrope de la manière suivante :
Le bénévolat : donner de son temps ! voilà l’une des méthodes les plus simples et efficaces pour faire de la philanthropie, mais non des moindres. La mise à disposition de ses compétences dans certains domaines permet d’apporter une contribution précieuse à des organisations caritatives sur le terrain. Il peut s’agir par exemple de visiter des enfants hospitalisés, de vacciner des populations, d’organiser des collectes de fonds ou de siéger activement au conseil d’administration d’entités caritatives.
Les dons en argent ou en nature : les versements en espèces à des organisations d’utilité public constituent l’outil le plus répandu en matière de philanthropie, surtout auprès des personnes peu initiées ou qui n’ont pas le temps de s’y consacrer pleinement. Par ailleurs, les dons caritatifs, notamment dans le cadre de projets ciblés, peuvent parfois aboutir à un meilleur impact lorsqu’ils sont effectués directement auprès d’institutions déjà bien établies, évitant les coûts et les lourdeurs administratives induites par la création de sa propre organisation philanthropique. La jeune génération tend toutefois à marquer un certain désintérêt pour ce type de philanthropie préférant être directement impliquée dans les projets. Bien entendu, le don ne se limite pas à de l’argent mais peu également porter sur des biens mobiliers ou immobiliers comme des immeubles, des œuvres d’art, etc. ou encore des parties de soi (sang, organes, etc.). Il est même envisageable d’offrir de manière temporaire comme par exemple un immeuble résidentiel, permettant au récipiendaire de percevoir les loyers durant un certain temps. Enfin, il est généralement possible de donner à titre posthume par voie testamentaire, à condition de respecter les règles sur la réserve héréditaire.
Les fondations ou les trusts caritatifs : pour les philanthropes qui ont une vision à long terme, la constitution d’une entité caritative créée sur-mesure et à leur image, représente la solution la plus adéquate, surtout dans une optique de laisser une trace de son passage sur terre et d’impliquer les générations futures. La fondation permet également au donateur de devenir un acteur à part entière de son projet philanthropique. En outre, dans la mesure où ce type de structure fait l’objet d’une surveillance étatique, elle permet d’assurer au constituant ainsi qu’aux donateurs la garantie de la transparence et de l’utilisation des fonds. En revanche, l’administration d’une telle structure entraîne des coûts non négligeables et implique un engagement continu et régulier de ses animateurs.
Une fondation ou un trust philanthropique se définit comme l’affection de biens en faveur d’un but spécial que le fondateur/settlor détermine librement. Une fondation caritative est dotée d’une organisation propre et acquiert en Suisse la personnalité juridique au moment de son inscription au registre du commerce. La fondation n’a pas de membres ni d’actionnaires, mais des bénéficiaires. On distingue les fondations donatrices dont l’activité principale consiste à soutenir financièrement des projets, des individus ou d’autres entités, au moyen de leur fortune initiale, de celles collectrices qui disposent d’un capital faible mais qui font appel à des collectes de fonds pour atteindre leur but. On classifie également les fondations à capital non-consommable qui prévoient que seuls les revenus de l’entité seront affectés au but social, la fortune de la fondation étant inaliénable, de celles à capital consommable de durée limitée et qui effectueront des distributions régulières jusqu’à épuisement total de leurs ressources.
S’agissant des trusts caritatifs, nous renvoyons à notre page internet consacrée à ce type de structure.
Les fonds philanthropiques abrités : véritable alternative moderne à une fondation caritative et très populaire aux États-Unis, le fond philanthropique abrité ne cesse de croître depuis une décennie. Partis du constat que créer sa fondation implique un coût, à la fois financier et en temps, certains organismes (par exemple la Swiss Philanthropy Foundation) proposent une solution à mi-chemin entre donner directement à une association et constituer sa propre entité. Ainsi, dans cette hypothèse, le bienfaiteur décide de déléguer certaines tâches administratives, par l’ouverture d’un fonds nominatif caritatif qui sera hébergé auprès d’une fondation dite « abritante », permettant ainsi de mutualiser les frais avec d’autres mécènes.
Fort de cette configuration, le fonds philanthropique n’a lui-même pas la personnalité juridique. La fondation abritante, véritable personne morale, engagera quant à elle les fonds versés selon les recommandations du donateur, qui pourra piloter où va l’argent via un comité où il siègera, non sans avoir préalablement décidé du thème philanthropique qu’il voudra soutenir. La structure abritante s’occupera en outre de l’ensemble du suivi administratif, comptable et juridique, permettant au mécène de réaliser des économies d’échelle. Les bienfaiteurs les plus aisés pourront créer eux-mêmes leur propre fonds nominatif alors que les donateurs moins fortunés associeront leurs ressources à des fonds thématiques déjà existants, moyennant un engagement minimum sur une certaine durée (par exemple le philanthrope donnera 100’000 francs suisses par an sur un minimum de trois ans). On estime généralement qu’entre 95% et 97 % des avoirs versés au fonds sont affectés au projet philanthropique, les 3% à 5% restant correspondent aux frais d’administration de la structure, offrant ainsi un ratio d’impact philanthropique élevé.
Les personnes qui se tourneront plutôt vers une fondation abritante sont celles qui connaissent mal la cause qui leur tient à cœur et qui ont conscience qu’identifier les meilleurs projets est une tâche difficile, ou celles qui souhaitent se consacrer exclusivement à la mission de la fondation et non à sa gestion.
Les partenariats public-privé : certains s’inquiètent du fait que les Etats – très endettés – semblent de plus en plus ouverts au développement de la philanthropie afin de se défaire de certaines tâches qui leur incombent en abandonnant le monopole étatique de l’intérêt général.
S’il est vrai que les pouvoirs publics sont naturellement mieux armés pour définir et mettre en œuvre des politiques de droit commun, s’adressant uniformément à tous, la philanthropie n’est quant à elle soumise ni à un impératif de rentabilité ni aux échéances électorales et peut ainsi jouer un rôle moteur déterminant en matière de coopération au développement.
L’ONU a estimé à 2’500 milliards de dollars les besoins mondiaux en matière d’ODD d’ici à 2030, somme qui ne pourra jamais être inscrite dans les budgets des états qui sont déjà aujourd’hui très largement déficitaires. Par ailleurs, il est indéniable que la part des subsides publics alloués au secteur associatif diminue chaque année. Seule la philanthropie privée nourrit l’espoir d’atteindre ces objectifs, même si les flux financiers restent encore en-dessous des attentes et des promesses. Le partenariat public-privé est un moyen d’atteindre ces objectifs.
Dans le cadre d’un tel accord, un organisme gouvernemental et une entité sans but lucratif se partagent la responsabilité du financement d’un projet. Les deux organismes recourent parfois à un partenaire du secteur privé, qui sera chargé de la concrétisation du projet (par exemple, la construction de routes, de stations d’épuration, d’usine électriques ou de traitement de l’eau), voire de son exploitation.
En s’unissant pour concrétiser leur vision commune, les gouvernements et les organismes de la philanthropie ont ainsi la possibilité de mettre à l’essai des idées audacieuses et novatrices, sans exposer les fonds publics à un risque excessif.
Cette approche a en sus deux avantages : elle procure une autre source de financement pour des projets publics, et elle offre une démonstration de faisabilité qui aidera le partenariat à trouver d’autres sources de financement.
Ce mélange de fonds publics, de capital philanthropique ainsi que de compétences et d’efficiences du secteur privé constitue une manière novatrice de s’adapter à l’évolution.
Les organisations caritatives et entreprises sociales : il s’agit de la forme la plus aboutie de la philanthropie. Au lieu de financer des projets caritatifs, le bienfaiteur constitue ici une véritable organisation pleinement opérationnelle, ayant pour but de réaliser elle-même les projets philanthropiques qu’elle entend mettre en avant. Alternativement, il est également possible d’incorporer ou de transformer une société commerciale en modifiant son but afin qu’elle remplisse des objectifs sociaux définis. Cette nouvelle évolution de la philanthropie séduit de plus en plus d’entrepreneurs désireux non seulement d’intégrer les critères ESG dans l’ADN de leur entreprise, mais également de donner une orientation non plus uniquement économique à leur société mais aussi caritative, prouvant que les deux concepts ne sont pas antinomiques.
Le secteur de la philanthropie en Suisse
Avec plus de 13’700 fondations d’utilité publique, abritant quelques 140 milliards de francs suisses (source : SwissFoundations), la Suisse constitue un terreau fertile en matière de philanthropie. Le pays figure d’ailleurs sur le podium du Global Philanthropy Environment Index (GPEI), le classement qui regroupe les pays les plus favorables à la philanthropie dans le monde. Si Bâle demeure le bastion historique des fondations caritatives, les cantons de Zurich, Berne, Genève et Vaud sont les mieux représentés et la tendance globale est à la hausse, malgré le contexte économique et social actuel. Les domaines philanthropiques les plus prisés sont la culture et les loisirs, la recherche et la formation ainsi que le secteur social. La protection de l’environnement a toutefois le vent en poupe depuis une décennie. Il en va de même des cryptofondations.
S’il existe en Suisse quelques mastodontes, comme la fondation Hans Wilsdorf, Sandoz ou Bertarelli, la plupart des fondations philanthropiques sont de petites ou moyennes tailles avec une fortune moyenne oscillant entre 2 et 19 millions de francs suisses selon les cantons (les fondations soumises à la surveillance de l’autorité fédérale ont une fortune moyenne de l’ordre de 16 millions, s’expliquant par leur secteur d’activité plus large).
Statistique intéressante, en Suisse plus de 90% des membres de conseils de fondation n’assument qu’un seul mandat à la fois, ce qui démontre la charge de travail induite. Il est en effet important de ne pas sous-estimer le temps que prend la gestion sérieuse d’une fondation caritative. Au-delà des aspects purement administratifs (comptabilité, traitement de la correspondance, etc.), la gestion du patrimoine de l’entité ainsi que le choix des bénéficiaires, y compris le processus de distribution peut s’avérer complexe et chronophage, surtout en l’absence d’une direction (qui constitue une infime minorité). Dès lors beaucoup d’acteurs de plus petite taille se tournent vers des fondations dites « abritantes ».
Le secteur de la philanthropie tend en revanche ces dernières années à se professionnaliser, notamment en raison du rajeunissement des philanthropes, qui se profilent de plus en plus comme de jeunes entrepreneurs (souvent la quarantaine) désireux de participer activement aux projets choisis, afin de peser sur le court des choses.
Avec Onyx Trust, donnez vie à vos valeurs et éclairez le monde d’une générosité qui laisse une empreinte durable.
Comment créer une fondation caritative en Suisse ?
Une fondation philanthropique peut être créée en Suisse de deux manières :
Entre vifs : la fondation est incorporée du vivant du fondateur. Il s’agit du cas le plus fréquent.
Pour cause de mort : la fondation est constituée par le biais d’un testament (la forme authentique n’est pas exigée) ou d’un pacte successoral. Les dispositions sont communiquées à l’autorité de surveillance compétente, cantonale ou fédérale, afin qu’elle puisse veiller à l’inscription de la fondation au registre du commerce et à sa mise sous surveillance.
La création d’une fondation à but d’utilité publique en Suisse requiert les étapes suivantes, étant précisé que le processus est relativement simple :
- La rédaction de l’acte de fondation (qui peut avoir été préalablement soumis à l’autorité de surveillance pour validation), des statuts et éventuellement des règlements d’organisation spécifiques ;
- Le choix du siège de la fondation ;
- La désignation des membres du conseil de fondation et de l’organe de révision ;
- L’authentification notariée de l’acte de fondation ;
- L’inscription au registre du commerce (permettant l’acquisition de la personnalité juridique) ;
- La mise sous surveillance ;
- La demande d’exonération fiscale.
Comme indiqué ci-dessus, la fondation doit être constituée par devant notaire, sauf en cas de disposition pour cause de mort.
La plupart des autorités de surveillance exige un capital minimum de départ de CHF 10’000 ou CHF 50’000 pour constituer une fondation caritative, somme qui peut être apportée en numéraire ou par d’autres biens. Bien entendu, réalistiquement ces montants ne permettent pas à la fondation d’assurer sa pérennité en termes de coûts de fonctionnement, il est ainsi essentiel soit d’assurer un mécanisme de financement récurrent de l’entité, soit de doter celle-ci de fonds initiaux importants (de l’ordre de plusieurs millions de francs suisses).
Le but de la fondation doit être rédigé avec soin et après mûre réflexion puisqu’il appartiendra ensuite au conseil de fondation de concrétiser celui-ci dans les limites fixées par le fondateur et selon ses instructions. Une fois l’entité créée, le but ne peut être modifié ou élargi qu’à des conditions très strictes imposées par la loi (de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à cet égard au 1er janvier 2024, y compris s’agissant de la modification de l’acte de fondation). La formulation de la clause du but de la fondation déterminera quelle autorité de surveillance est compétente. Outre les statuts, un ou plusieurs règlements d’organisation (par exemple en matière d’investissement) serviront ensuite à orienter les membres du conseil dans la gestion de la fondation.
Le conseil de fondation, choisi pour la première fois par le fondateur, constitue l’organe suprême de l’entité. Sa mission consiste à diriger la fondation du point de vue stratégique et organisationnel, en respectant le but de la fondation, son acte constitutif ainsi que les divers règlements. Il est recommandé de nommer au minimum trois membres, dont l’un d’eux doit obligatoirement être domicilié en Suisse. Des comités (par exemple d’investissement ou de projets) peuvent être désignés. Sauf exceptions strictes (gratification minimale pour les professionnels), les membres du conseil de fondation déploient leurs activités à titre bénévole.
Il convient de relever que les membres du conseil de fondation ne peuvent restreindre leur responsabilité en invoquant qu’ils travaillent de manière totalement gratuite (l’article 99 al. 2 du Code des obligations atténue quelque peu ce principe, même si aucun arrêt du Tribunal fédéral n’a encore été rendu à ce jour pour les fondations philanthropiques). En outre, il n’est pas possible de donner décharge aux membres du conseil de fondation comme cela se pratique pour les conseils d’administration de sociétés commerciales. Enfin, la responsabilité d’un membre du conseil peut être fondée à la fois sur un acte mais également en cas d’omission d’agir. Au vu de ce qui précède, il peut parfois être opportun de conclure une assurance responsabilité civile pour les organes de la fondation, qui ne couvrira toutefois ni les actes intentionnels ni la négligence grave.
Enfin, il faut compter environ CHF 10’000 pour constituer une fondation charitable non complexe (frais de notaire et d’avocat, émoluments du registre du commerce et de l’organe de surveillance compris).
Une fois la fondation créée, ses comptes feront chaque année l’objet d’un audit (contrôle restreint ou ordinaire selon les cas) par l’organe de révision externe (il est possible d’obtenir une exonération à certaines conditions). Les comptes, le rapport de l’organe de révision et du conseil de fondation seront transmis à l’autorité de surveillance dans les 6 mois dès la clôture de l’exercice. Enfin, une déclaration fiscale doit en principe être remplie chaque année nonobstant l’exonération d’impôt, sans oublier de demander le remboursement de l’éventuel impôt anticipé.
Les fondations caritatives sont ainsi soumises à un double contrôle : d’une part l’autorité de surveillance (qui peut être fédérale, cantonale ou communale en fonction du but de la fondation ; ainsi une fondation active sur le plan national ou à l’international sera soumise à l’ASF alors qu’une telle entité limitant ses activités au territoire genevois sera assujettie à l’ASFIP) chargée de veiller que la fondation utilise son patrimoine conformément au(x) but(s) défini(s) dans ses statuts. D’autre part, les autorités fiscales qui s’assurent que la fondation en cause a bel et bien un but caritatif justifiant son exonération fiscale.
En outre, les fondations qui perçoivent des dons sont assujetties aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La philanthropie et ses détracteurs
La philanthropie n’a pas que des admirateurs, elle fait également l’objet de critiques. Le secteur est tout d’abord bien entendu exposé aux risques de blanchiment de capitaux, des personnes malintentionnées pouvant essayer d’utiliser des structures juridiques poursuivant à priori des buts désintéressés à des fins philanthropiques pour réaliser des opérations sales. Sous l’impulsion du GAFI et des ONG, d’importants progrès ont été faits en ce domaine au cours de la dernière décennie même si la vigilance reste de mise.
Sous un angle plus philosophique, on reproche parfois à la philanthropie l’appropriation, par des individus sans mandat démocratique, de décisions susceptibles d’impacter la vie des concitoyens. En d’autres termes, la philanthropie serait pour ses détracteurs un danger envers la démocratie et l’égalité. Les plus extrémistes vont jusqu’à dire qu’elle serait un instrument au service des riches et du pouvoir, prenant comme exemple les relations incestueuses entretenues entre les mécènes fortunés et les politiques, à l’instar de Bill Gates ou d’Elon Musk.
Sur le fond, les opposants critiquent le mécanisme des déductions fiscales accordées aux bienfaiteurs et aux organisations caritatives qui prive les états de ressources nécessaires pour la société, en permettant à une poignée d’individus d’imposer leurs préférences (par exemple en soutenant l’art plutôt que la précarité des plus démunis ou l’aide à l’éducation de communautés minoritaires). En clair, il convient de se poser la question si la philanthropie redistribue l’argent plus démocratiquement que le gouvernement s’il avait disposé de cette somme sous forme d’impôt ?
Il est vrai que le philanthrope a, inévitablement, tendance à favoriser certaines causes qui lui paraissent davantage légitimes. Ce choix individuel rencontre rarement la majorité. Mais au-delà du fait qu’il vaut selon nous mieux inciter les personnes fortunées à donner leur argent plutôt qu’à le conserver ou l’utiliser autrement, les opposants à la philanthropie font fausse route. Si effectivement les pouvoirs publics sont naturellement mieux armés pour définir et mettre en œuvre des politiques de droit commun, la philanthropie joue très souvent un rôle déterminant pour soutenir des causes émergentes, peu populaire voire même ignorées du grand public. Peu de secteurs n’ont connu autant de nouvelles idées et de nouveaux outils que la philanthropie ces dernières années.
N’étant contrainte par aucun accord intergouvernemental, la philanthropie constitue ainsi un « learning laboratory » permettant de proposer des projets à la fois innovants et sur le long-terme, souples et sans embarras bureaucratique.
En clair, la philanthropie ne se substitue pas à l’action publique, elle la complète. Elle permet enfin de combler les failles du financement étatique et de l’aide publique au développement.
La créativité, la générosité et la puissance financière des philanthropes sont aujourd’hui plus nécessaires que jamais pour rééquilibrer une planète en plein désarroi. Son essence même est d’améliorer la vie des autres, et peu importe les mécanismes utilisés. Enfin, la philanthropie constitue l’un des derniers refuges de l’utopie humaine, et tant que sa raison d’être n’aura pas été supprimée, elle mérite que l’on s’y attarde.