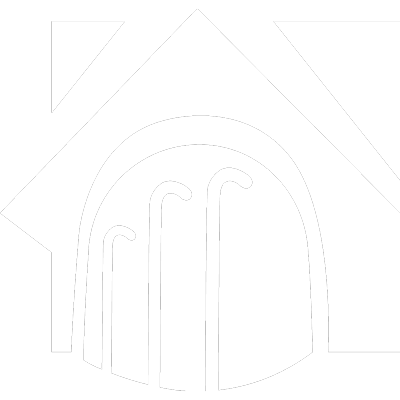Table des matières
- Le trust, instrument de planification patrimoniale ultime
- Qu’est-ce qu’un trust et quelles sont ses caractéristiques ?
- A quoi peut servir un trust ?
- Quels types actifs puis-je mettre en trust et à quelles fins ?
- Quelles sont les démarches à entreprendre en vue de constituer un trust ?
- Quels sont les types de trust ?
- Quel est le droit applicable au trust ?
- Comment les trusts sont-ils régulés ?
- Qui peut être trustee et quels sont ses devoirs et prérogatives ?
- Comment les fonds du trust sont-ils investis ?
- Quels sont les droits des bénéficiaires à l’égard du trustee ?
- Quels sont les attributions du protector ?
- Comment puis-je garder le contrôle sur mon trust ?
- Qu’est-ce qu’une « private trust company » ?
- Au final, quels sont les avantages de constituer un trust ?
Le trust, instrument de planification patrimoniale ultime
Sans aucun doute, vous n’êtes pas arrivé sur cette page internet par hasard. Vous êtes à la recherche de solutions concernant l’avenir de votre patrimoine ? Vous êtes au bon endroit.
La gestion de vos actifs ne se limite pas à la construction et à l’administration d’un portefeuille, mais s’inscrit dans une démarche globale, incluant la protection de vos avoirs contre le risque « entrepreneur » et leur transmission aux générations futures. Après tout, vous avez bâti un empire familial pour l’inscrire dans la durée et la continuité, non ?
Chez Onyx Trust, nous vous aidons à naviguer au travers des environnements complexes et dynamiques actuels ainsi que des changements de circonstances de la vie. Nous créons pour vous et votre famille des solutions sur mesure en matière de planification patrimoniale.
Or, la constitution d’un trust fait partie des puissants outils d’organisation financière.
Historiquement, le trust était utilisé au Moyen Âge déjà par les chevaliers anglais qui, partant pour les croisades, transféraient leurs biens, notamment leurs terres, à un tiers digne de confiance à charge pour celui-ci de les gérer au profit de leur épouse et leurs enfants mineurs jusqu’à leur retour éventuel. Aujourd’hui et contrairement à l’imaginaire collectif qui l’associe à un instrument d’évasion fiscale pour personnes aisées, le trust est un outil extrêmement versatile pouvant être utilisé par de nombreux acteurs et selon des objectifs très différents.
Bien connu des fortunes anglo-saxonnes, le trust permet tout d’abord de transmettre votre patrimoine de manière organisée mais flexible à votre décès, en apportant tout le soutien nécessaire à vos proches. Le trust constitue en outre un bouclier efficace lors d’activités entrepreneuriales risquées, notamment contre les conséquences d’une faillite. Il permet également d’empêcher la mainmise de ses biens par des tiers malintentionnés, à l’instar du conjoint dans une procédure de divorce ou contre des régimes politiques autoritaires. Il offre aussi de conserver une certaine confidentialité sur l’ampleur de son patrimoine (par exemple la possession de yachts, d’aéronefs, de propriétés immobilières, etc.) et d’en déléguer l’administration journalière à des spécialistes. Enfin, il permet dans une certaine mesure de limiter sa charge fiscale.
Si beaucoup se targuent d’être en mesure de constituer un trust pour votre famille, peu sont réellement capables de mettre en place le véhicule le plus adapté à vos besoins, se limitant dans la grande majorité des cas à vous proposer des solutions « clés en main », vendues de manière quasi-industrielle, mais qui ne résisteront pas au moindre assaut de tiers le moment venu.
En réalité, l’environnement des trusts est complexe et nécessite d’être entouré par des experts en la matière, surtout si l’on provient d’un pays de tradition civiliste. Notre équipe dédiée, composée d’avocats membres de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), dispose d’une expertise de plus de 15 ans en matière de trusts et officie régulièrement en tant qu’expert auprès des tribunaux.
Vous trouverez ci-après des informations didactiques, exposées volontairement de manière simple mais complète, qui nous l’espérons pourront vous permettre d’appréhender cet instrument atypique, mais ô combien efficace.
Qu’est-ce qu’un trust et quelles sont ses caractéristiques ?
Comme relevé précédemment, le trust est une institution juridique qui trouve ses origines dans la common law anglaise. Instrument doté d’une flexibilité considérable, il est malaisé d’en formuler une définition précise. Par ailleurs, toute tentative d’assimilation du trust à une institution juridique du droit civil continental ne peut déboucher que sur un bricolage juridique peu satisfaisant. Par conséquent, il convient de reconnaitre que le trust est une institution sui generis, qui ne peut être appréhendée que de cas en cas en fonction de ses spécificités.
Nonobstant ce qui précède, on peut de manière générale définir le trust comme un acte juridique unilatéral par lequel le constituant (appelé le « settlor ») transfère la propriété de valeurs patrimoniales déterminées à une ou plusieurs personnes (dénommées les « trustees »), lesquelles ont l’obligation de les détenir, de les gérer et d’en disposer en faveur d’un ou plusieurs bénéficiaires (les « beneficiaries »).
Les caractéristiques principales du trust sont les suivantes :
- Véritable particularité anglo-saxonne, le transfert de patrimoine du settlor dans le trust génère une division, ou plus particulièrement un dédoublement, des attributs de la propriété entre le trustee et les bénéficiaires.
En effet, le trustee devient alors le propriétaire juridique des avoirs trustaux (on parle de « legal ownership »), disposant du même contrôle et exerçant les mêmes pouvoirs que n’importe quel propriétaire de biens. En particulier, il est tenu d’en défendre la propriété et la possession à l’égard des tiers. Il n’est toutefois pas en droit de les utiliser ou d’en disposer dans son propre intérêt.
De l’autre côté, les bénéficiaires sont eux les propriétaires économiques des biens mis en trust (on parle alors d’« equitable ownership »), mais n’en jouissent que si le trustee distribue les actifs en trust ou les met à leur disposition.
Souvent mal comprise, cette relation juridique particulière est au cœur de l’institution du trust : le trustee détient la propriété des biens du trust pour le compte du bénéficiaire. Le premier a des obligations à l’égard du second, qui a lui-même des droits qu’il peut exercer contre le premier (par exemple exiger des distributions en fonction du type de trust établi, demander la reddition de compte, exercer un droit de suite en cas d’aliénation d’actifs sans droit par le trustee, etc.). Ainsi, si besoin est, les bénéficiaires peuvent faire valoir en justice (Court of equity) leurs éventuelles prétentions découlant du trust. A son tour, le trustee peut également saisir le juge afin d’obtenir des instructions ou faire ratifier des actes dans le cadre de la juridiction gracieuse et non pas uniquement contentieuse, par exemple si le trust instrument est silencieux sur certaines questions, si des bénéficiaires ne peuvent donner leur consentement parce qu’ils sont mineurs, ou encore en cas de blocage entre le trustee et le protector.
- Le trust est un acte unilatéral du settlor et ne constitue ainsi pas un contrat. Sous cet angle, il se rapproche de l’acte constitutif d’une fondation ou d’une société.
- Le trust ne dispose toutefois pas de la personnalité juridique et ne constitue dès lors pas une personne morale ; de ce point de vue, il se distingue de la fondation de famille. Ainsi, les avoirs en trust (les « trust funds ») appartiennent au trustee et non pas au trust lui-même ;
- Corolaire de ce qui précède, les biens en trust constituent une masse distincte du patrimoine personnel du trustee ; les actifs trustaux sont donc à l’abri des créanciers personnels de celui-ci et ne rentrent ni dans sa succession ni dans son régime matrimonial en cas de décès ou de divorce ;
- Nonobstant ce qui précède, le trust possède une certaine existence juridique autonome. Ainsi, si la constitution du trust a pour effet de transférer la propriété formelle des biens concernés au trustee, ce dernier doit néanmoins gérer le patrimoine trustal dans l’intérêt des bénéficiaires ou dans un but d’intérêt général (dit « purpose trust ») et non dans le sien propre ou dans celui du settlor. Le trustee a notamment un devoir d’honnêteté, de fidélité et de loyauté envers les bénéficiaires ainsi qu’une obligation de diligence et de prudence dans la gestion des avoirs en trust.
- Bien que le trust soit créé à l’origine par le settlor, il constitue après sa création essentiellement un rapport juridique entre le trustee et les bénéficiaires qui est réglé en premier lieu par l’acte constitutif (le « trust instrument » ou le « trust deed ») et en second lieu par les dispositions juridiques applicables au trust (la « proper law » du trust). Ainsi, le settlor perd en principe tout pouvoir sur le trust et les actifs le composant, à moins que le contraire ne soit prévu dans le trust instrument. Dans cette dernière hypothèse, on parle de « reserved powers du settlor » (voir ci-dessous).
- Le settlor possède néanmoins une liberté quasi-totale au moment de la constitution de son trust, décidant sans restriction quant à la nature et l’étendue de l’intérêt qu’il confère au(x) bénéficiaire(s).
Il peut ainsi par exemple choisir si ce(s) dernier(s) disposera/ont d’une prétention ferme à des distributions provenant des revenus du trust (on parle alors de « fixed interest trust ») ou de son capital (« bare trust »), ou, il peut, au contraire, préférer octroyer un pouvoir discrétionnaire au trustee à cet égard (« discretionnary trust »). Il lui est également loisible prévoir des charges, des conditions, des échelonnements de distribution dans le temps ou encore des règles quant à l’utilisation de certains actifs (par exemple une maison familiale).
Il est possible par la suite au settlor de communiquer au trustee ses volontés et ses décisions par le biais d’une « letter of wishes ». Ce document n’a toutefois généralement aucune force contraignante et le trustee est libre de le suivre ou de l’ignorer. La letter of wishes demeure toutefois une source complémentaire très utile pour le trustee afin d’interpréter le trust instrument et les volontés du settlor, notamment après son décès.
- Le settlor peut enfin, s’il le souhaite, désigner une personne de confiance (appelée communément le « protector ») chargée de surveiller que le trustee agisse conformément à ses obligations et dans l’intérêt des bénéficiaires. Ses pouvoirs peuvent être plus ou moins étendus et sont définis dans le trust instrument (pouvoir de veto, pouvoir de donner des instructions au trustee, pouvoir de le remplacer (« trustee appointor »), pouvoir de mettre fin au trust, etc.). A noter que le settlor peut se désigner lui-même bénéficiaire, trustee ou protector. Cette situation n’est toutefois pas sans risque sous l’angle de la validité même du trust mais également du point de vue fiscal.
- Le trust est généralement constitué pour une durée limitée. Celle-ci est définie soit dans le trust instrument, soit par la proper law du trust ou la jurisprudence, parfois de manière impérative notamment dans le cadre des « Rules against perpetuities » (par exemple 100 ans). Le trust peut en outre prendre fin avant l’échéance prévue par exemple si le trustee décide de distribuer l’ensemble des avoirs (dans le cas d’un trust discrétionnaire) aux bénéficiaires, s’il n’y a plus de bénéficiaires ou si le but du trust est atteint (dans l’hypothèse d’un purpose trust).
Enfin, certaines juridictions permettent, si tous les bénéficiaires, majeurs et capables de discernement, le demandent, de mettre fin au trust (règle dite de Saunders v. Vautier).
A quoi peut servir un trust ?
Le trust sert avant tout d’instrument successoral dans l’optique de transmettre son patrimoine aux générations suivantes. Grâce à son extrême souplesse, il offre des possibilités de planification bien plus larges que la seule rédaction d’un testament ou la conclusion d’un pacte successoral. Il permet par exemple de différer le versement des actifs de la succession à une date ultérieure en présence d’enfants mineurs notamment, ce qui n’est pas possible selon les règles ordinaires successorales du droit suisse. En outre, le trust peut continuellement être adapté aux circonstances imprévisibles de la vie (faillite, maladie, prodigalité de l’un des bénéficiaires, etc.), y compris après le décès du settlor. Enfin, il permet d’éviter une dilution des actifs entre les héritiers, notamment dans le cadre d’une entreprise familiale.
Le trust est également un instrument du droit des affaires. Il offre par exemple la possibilité d’abriter une partie de son patrimoine à l’égard de futurs créanciers, notamment dans le cadre d’activités à risque (startup, etc.). Plus encore, il autorise la jouissance de ses biens (par exemple l’utilisation d’une maison) sans en être formellement le propriétaire avec les inconvénients que cela implique (confidentialité, saisie, etc.). Le trust sert également à des fins de garantie ou de sûretés pour des projets financiers et est régulièrement utilisé dans la conclusion de contrats de prêts. Grâce à sa simplicité et sa grande confidentialité, il constitue une alternative intéressante à certaines sociétés commerciales, même si son but premier vise la détention passive d’un patrimoine.
Le trust est enfin un véhicule utilisé à des fins caritatives, de protection contre son conjoint dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou du divorce, de gestion de fonds de pension ou de placements collectifs de capitaux et de constitution de plans d’intéressement de collaborateurs.
Dans une moindre mesure, le trust peut viser des objectifs d’optimisation fiscale.
Quels types actifs puis-je mettre en trust et à quelles fins ?
La fortune du trust peut être constituée de tout type de biens que ce soit des immeubles (résidentiels, commerciaux ou à des fins agricoles), des instruments financiers (actions, obligations, fonds de placement, produits structurés, instruments dérivés, private equity, etc.), des créances actuelles ou futures, conditionnelles ou contestées, des expectatives (par exemple successorales), des droits de propriété intellectuelle, des espèces ou d’autres valeurs mobilières (objets d’art, antiquités, yachts, avions, etc.).
Il importe en revanche que les biens soient décrits de manière suffisamment précise pour qu’ils soient identifiables ou déterminables de manière certaine. A défaut, le trust est nul et si le settlor est d’ores et déjà décédé, les biens en question tomberont dans la masse successorale de ce dernier.
Par ailleurs, pour qu’il y ait dessaisissement, un transfert de propriété doit être valablement effectué au trustee. Ceci suppose notamment que le settlor soit capable, à la fois sous l’angle civil (capacité de discernement, majeur, etc.) et du droit de la propriété, de valablement transférer les biens en trust et que les formalités de transfert soient respectées (forme authentique si nécessaire, transfert de la possession, etc.). A cet égard, il est important de garder à l’esprit que le droit applicable à la cession des biens en trust pourra être différent de la proper law du trust et dépendra des règles de droit international privé du tribunal saisi en cas de litige.
En règle générale, pour des raisons de confidentialité, le settlor n’apportera initialement qu’un montant symbolique dans le trust au moment de sa constitution (par exemple USD 100), puis effectuera des apports successifs par le biais de « deeds of addition ». Il est même possible de prévoir dans un testament que le solde de la fortune viendra compléter les avois mis en trust au moment du décès du settlor.
Dans la pratique, il est fréquent que le trustee ne détienne pas directement les avoirs du trust mais agisse par l’intermédiaire d’une société spécialement créée dans le but d’abriter le patrimoine trustal (on parle alors d’une « underlying company »). Cette solution permet de simplifier le transfert de la propriété des actifs mis en trust dans l’hypothèse d’un changement de trustee, impliquant uniquement une cession des actions de la société en lieu et place de chaque actif pris individuellement.
Quelles sont les démarches à entreprendre en vue de constituer un trust ?
Il convient tout d’abord de rappeler que le trust est un acte juridique unilatéral du settlor. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord préalable du trustee pour créer un trust et pour que celui-ci existe. Bien entendu, le trustee est libre de refuser l’exercice de ses fonctions et une autre personne devra alors être désignée. Dans la très grande majorité des cas toutefois, la création et les termes du trust feront l’objet d’un accord entre le trustee et le settlor.
De même, il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement des bénéficiaires. Il est d’ailleurs fréquent que ces derniers ne soient pas au courant qu’un trust a été institué en leur faveur. Ils découvriront l’existence de celui-ci des années plus tard, par exemple au décès du settlor.
La constitution d’un trust n’est généralement soumise à aucune forme : ainsi, il est techniquement possible de créer un trust oralement par déclaration du settlor au trustee pour autant que l’intention du premier puisse être établie. Dans certains cas, un trust peut aussi être créé par décision judiciaire, lorsque l’on peut ou doit déduire du comportement du settlor ou d’un individu – notamment une personne qui gère des biens pour le compte du constituant – qu’une relation de trust a été créée dans les faits (on parle alors de « resulting trust » ou de « constructive trust »).
En pratique, les trusts revêtent toutefois la forme écrite. On distingue deux manières de constituer un trust du vivant du settlor : d’une part par la signature conjointe du trustee et du settlor de l’acte constitutif (« deed of settlement » ou « trust deed »), ou d’autre part par la signature unique du trustee (« declaration of trust »). Dans cette dernière hypothèse, le settlor ne participe pas formellement à la procédure ce qui lui permet de conserver son anonymat.
La création du trust requiert que le settlor dispose de l’exercice des droits civils et qu’il manifeste sa volonté de le constituer (« express trust »). Cette manifestation de volonté requiert trois conditions essentielles appelées « three certainties » : l’intention expresse du settlor d’établir un trust (« certainty of intention »), sur des éléments de propriétés identifiables (« certainty of subject matter »), en faveur de personnes certaines ou d’un but certain (« certainty of objects »). En l’absence de réelle intention de constituer un trust de la part du settlor et/ou de transférer ses biens au trustee, celui-ci risque d’être qualifié de « sham trust » par les tribunaux (Rahman v. Chase Bank case) et partant déclaré comme nul dès l’origine. Cette situation se produit notamment lorsque le constituant entend conserver trop de pouvoirs dans le trust (« reserved powers »). On distingue deux types de sham : le « formal sham » et l’« administrative sham » : dans le premier scénario, le settlor transfère le legal ownership au trustee mais se réserve dans le trust instrument de nombreux pouvoirs en sa faveur, à un tel point que le trustee ne peut qu’administrer les actifs du trust et procéder à des distributions que selon la seule volonté du settlor. Dans le second cas de figure, les documents trustaux ne prévoient aucun pouvoir en faveur du settlor mais dans les faits, celui-ci prend toutes les décisions à la place du trustee et exerce une ainsi une domination sur le trust. Ces deux états de fait peuvent avoir de graves conséquences, notamment fiscales, sur le settlor. Il convient donc de porter une attention particulière à cette problématique.
Outre la volonté de constituer un trust, le settlor doit encore formellement transférer la propriété des biens mis en trust au trustee. Cette démarche, qui n’est pas soumise à la proper law du trust ni aux règles de l’equity, mais aux dispositions usuelles en matière de droits réels et des contrats, peut impliquer certaines formalités spécifiques. Ainsi, par exemple, le transfert d’une propriété immobilière située en Suisse dans un trust requiert un acte authentique, passé par devant notaire et une inscription au registre foncier du lieu de situation de l’immeuble.
Il est loisible pour le settlor de se désigner lui-même trustee (ce qui implique une séparation des biens détenus en trust et ceux personnels).
Les juridictions offshores disposant d’un droit moderne permettent la constitution de trusts sans bénéficiaires indentifiables mais dont le patrimoine est affecté à la réalisation unique d’un but. On parle dans cette hypothèse de « purpose trust ».
Le trust n’est autre qu’une construction juridique permettant de mettre une distance entre le détenteur d’un patrimoine et ce patrimoine, afin de le protéger. Il instaure également une distinction entre le propriétaire juridique d’un bien (le trustee) et le bénéficiaire d’un intérêt économique sur ce même bien (les beneficiaries).
Quels sont les types de trust ?
Il est difficile d’établir un catalogue exhaustif des formes que peuvent prendre les trusts. On peut toutefois les classifier en recourant aux distinctions suivantes : 1) la cause juridique du trust, 2) les pouvoirs conservés par le settlor, 3) la nature de l’intérêt conféré aux bénéficiaires et 4) le but du trust.
Ainsi, on distingue :
- Le private express trust, qui résulte d’une manifestation expresse de volonté du settlor, peut être constitué du vivant de ce dernier (« inter vivos trust ») ou pour cause de mort (« testamentary trust »). Dans cette dernière hypothèse, la déclaration unilatérale du settlor sera généralement insérée dans un testament. Le trust ne sera ainsi créé qu’au moment du décès du settlor.
Il est également possible de constituer un inter vivos trust mais d’affecter des biens à la mort du de cujus dans le cadre du testament. Il ne s’agit alors pas d’un testamentary trust.
A noter que le droit successoral suisse ne permet pas la constitution d’un testamentary trust, car ce dernier ne fait pas partie des formes de disposition pour cause de mort autorisées en droit suisse, ni des modes de disposer prévus par la loi. En effet, une personne ne peut organiser sa succession qu’au moyen d’un testament ou d’un pacte successoral. En outre, la loi énumère un numerus clausus des modes de disposer. Il s’agit de l’institution d’héritier, du legs, des charges, des conditions, des substitutions et de la fondation. Le trust n’y figure pas. Ainsi, afin de palier à cette difficulté, il convient de constituer un inter vivos trust et de nommer le settlor comme premier bénéficiaire. Au décès de celui-ci, il n’y aura aucun transfert de propriété, les biens appartenant déjà au trustee, mais uniquement un changement de bénéficiaire, ce qui est évidemment parfaitement admissible.
Par opposition au private express trust, il existe des trusts créés par la loi (« statutory trust ») ou par la jurisprudence (« contructive ou resulting trusts »), par exemple dans le cadre de l’administration d’une faillite ou d’une succession selon le droit anglais, dans l’hypothèse d’un trust créé fictivement (les sham trusts notamment où le settlor conserve un pouvoir de contrôle absolu sur le trust ou si le bénéficiaire ultime de celui-ci n’est pas précisé) ou si le trustee utilise à son propre profit des biens en trust. - Le trust révocable (« revocable trust ») qui permet au settlor de mettre immédiatement fin au trust et de récupérer la propriété des biens transférés. Le trust irrévocable quant à lui (« irrevocable trust ») institue un transfert définitif des avoirs en mains du trustee.
Il est important de relever d’une part, que le trustee reste le propriétaire des avoirs même dans le cadre d’un trust révocable et d’autre part, que la révocation ne remet pas en cause les distributions antérieures. Par ailleurs, il ne faut pas confondre le trust révocable avec la situation fréquente en pratique où le settlor se désigne lui-même premier bénéficiaire du trust. En effet, la révocation est un acte unilatéral du settlor alors que la distribution est une décision unilatérale du trustee. A noter enfin qu’un trust devient automatiquement irrévocable au décès du settlor. Idem, un testamentary trust est irrévocable par nature. A noter que la distinction entre trust révocable et irrévocable est importante notamment sous l’angle fiscal. - Le trust fixe (« fixed interest trust ») a pour effet d’accorder aux bénéficiaires, à certaines échéances ou conditions, une prétention ferme à l’encontre du trustee. Par opposition, dans le cadre d’un trust discrétionnaire (« discretionary trust »), les bénéficiaires ne disposent que d’une simple expectative sur les avoirs du trust. A cet égard, on notera que ce dernier type trust est de loin celui le plus utilisé en pratique dans la mesure où il offre une flexibilité maximum. C’est en effet alors au seul trustee (éventuellement avec le concours du protector) qu’il appartient de déterminer, parmi une classe de personnes, le ou les bénéficiaires pouvant prétendre à une distribution ainsi que le moment et l’étendue de celle-ci, selon les intentions originelles du settlor, exprimées généralement dans la letter of wishes ou dans le trust deed (par exemple pourvoir à l’éducation des enfants).
On relèvera toutefois que nonobstant le caractère discrétionnaire d’un trust, le trustee ne saurait faire preuve d’arbitraire et doit toujours agir dans l’intérêt unique des bénéficiaires. Ainsi par exemple, il doit régulièrement considérer si une distribution est opportune et ne peut pas simplement décider, sans justification, de conserver les avoirs trustaux pendant des années.
A noter qu’il est possible de combiner les deux types de trusts, par exemple en instituant un trust fixe pour le premier bénéficiaire puis discrétionnaire pour les bénéficiaires suivants.
Grâce à la flexibilité quasiment sans limite du settlor dans la constitution de son trust, il existe également une multitude de variantes possibles comme le « contingent interest trust » (assorti de la réalisation d’une condition par exemple les 25 ans du bénéficiaire), le « protective trust » (un trust fixe qui devient discrétionnaire en cas de faillite du bénéficiaire), l’« interest in possession trust » (le bénéficiaire reçoit automatiquement chaque année l’intégralité des revenus du trust, puis à son décès le capital de celui-ci est versé aux bénéficiaires subséquents), ou encore l’« accumulation trust » (le trustee peut décider d’accumuler tout ou partie des revenus du trust pendant un certain nombre d’années). A relever ici également que la différence entre trust fixe et discrétionnaire est déterminante sous l’angle du droit fiscal. - En règle générale, le trust est créé en faveur de bénéficiaires particuliers déterminables (« private express trust »), pour les raisons les plus variées (entretien de la famille, protection du patrimoine, fonction de garanties et de sûretés, etc.). Il s’agit de loin de l’utilisation la plus courante de ce type de véhicule.
Le trust peut néanmoins également avoir non pas pour objectif de servir des intérêts privés mais un but d’utilité publique (« charitable trust »). Dans cette hypothèse, faute de bénéficiaires identifiés ou identifiables et bien qu’au final il bénéficiera à des individus (personnes démunies, en formation, etc.), une autorité publique s’assurera que le trustee exerce correctement ses fonctions.
Les juridictions offshores modernes prévoient enfin que le trust peut aussi avoir pour but la réalisation d’un objet (par exemple, la détention des actions d’une « private trust company », l’entretien d’une tombe ou d’un animal de compagnie, etc.). Admis de manière très restrictive en droit anglais, faute de bénéficiaire déterminé, ce type de trust (« private purpose trust ») fait l’objet de règles particulières : ainsi par exemple, il sera généralement exigé qu’un enforcer soit nommé afin d’exiger et de s’assurer que le trustee respecte les obligations imposées par le trust deed.
Quel est le droit applicable au trust ?
A l’instar des contrats, les trusts sont principalement régis par le principe de l’autonomie des parties. En d’autres termes, le trust est tout d’abord gouverné par les documents constitutifs (trust deed, declaration of trust, etc.), convenus entre le settlor et le trustee. L’autonomie des parties est néanmoins limitée par les principes établis par la jurisprudence parfois centenaire (par exemple les « three certainties »), dont certains arrêts font toujours autorité aujourd’hui et qui constituent le noyau dur du droit des trusts. En effet, des tribunaux spécialisés (dans l’Empire britannique la Court of Chancery), statuant en équité, ont été créés par le passé afin de trancher les litiges en la matière.
Ces dernières décennies, les juridictions modernes offshores ont, dans l’optique de développer leur industrie financière, modernisé, assoupli et simplifié le droit des trusts par la codification de lois (par exemple le « Trusts Act » des îles Caïmans ou « The Trusts (Guernsey) Law »). Dans cette optique, elles ont notamment renforcé la protection accordée par les trusts contre les velléités des héritiers réservataires, des conjoints ou encore des créanciers. De même, les pouvoirs réservés des settlors ont été élargis. La notion de protector a elle été expressément inscrite dans les textes. De nouveaux instruments juridiques ont également fait leur apparition comme les purpose trusts.
Pour toutes ces raisons, Onyx Trust soumet généralement les trusts qu’elle administre, non pas au droit anglais, caractérisé par sa grande rigidité, mais à un droit moderne (proper law du trust) comme par exemple celui des îles Caïmans, des îles Cook, de Guernesey ou de Jersey, ou encore de la Nouvelle-Zélande, en tenant compte des besoins de ses clients et des objectifs visés.
A noter qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas de droit civil des trusts dans l’ordre juridique interne suisse. Par conséquent, il n’est pas possible de créer un trust soumis au droit suisse. Un projet législatif dans ce sens était toutefois à l’étude mais a été abandonné en septembre 2023, faute notamment de consensus au niveau fiscal. Cela ne signifie néanmoins pas que les trusts de droit étranger ne sont pas reconnus en Suisse, au contraire. La Suisse est en effet partie à la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance depuis 2007 ce qui signifie que les tribunaux et autorités suisses doivent reconnaître les effets juridiques de trusts étrangers. Le droit international privé suisse (Loi fédérale sur le droit international privé) règle quant à lui non seulement la compétence des tribunaux, le droit applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution de décisions étrangères en matière de droit des trusts mais également d’autres domaines qui sont directement liés à ces derniers (droit des successions, droits réels, régimes matrimoniaux, protection de l’enfant et de l’adulte, etc.). En outre, le droit interne suisse contient des dispositions expresses sur les trusts dans diverses lois et règlements comme par exemple en matière de fiscalité (circulaire no 20), de successions (Code civil) ou de droit des poursuites (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Enfin, comme il le sera détaillé ci-dessous, l’activité de trustee en Suisse est dûment règlementée.
Comment les trusts sont-ils régulés ?
En règle générale, l’activité de trustee est strictement encadrée et régulée par les autorités du lieu de l’enregistrement (cas échéant) ou de l’administration effective du trust, qui exigent la détention d’une licence professionnelle.
Il est important de ne pas confondre le droit applicable au trust (proper law du trust, voir ci-dessus) avec la règlementation de l’activité de trustee. En effet, alors que la Suisse ne connaît pas de droit suisse des trusts, l’activité de trustee est, elle, dûment règlementée. Sauf rares exceptions (notamment les single family office ou les private trust companies), toute personne souhaitant déployer une activité de trustee à titre professionnel sur le territoire suisse doit obtenir une licence de la part de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), à l’instar d’une banque ou d’un autre établissement financier.
Le trustee, soumis à la Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin) doit notamment disposer d’une organisation appropriée pour son activité (forme juridique, qualifications des dirigeants, obligations en matière de délégation des tâches, garantie d’une activité irréprochable, formation continue, etc.), d’une gestion des risques organisée de manière adéquate, d’un contrôle interne et disposer de fonds propres et de garanties appropriés. Un audit par un organisme indépendant est généralement conduit chaque année et toute violation est passible non seulement d’un retrait de licence mais également de poursuites pénales.
En outre, si le trustee entend gérer lui-même des actifs financiers mis en trust sans procéder à une délégation des tâches auprès d’un établissement financier (banque, gestionnaire de fortune externe, etc.), il doit respecter la Loi fédérale sur les services financiers (LSFin). Celle-ci impose, à l’instar de la règlementation européenne (MiFID II), des obligations strictes en matière de classification de la clientèle, de vérification du caractère approprié et adéquat des investissements, de reddition de compte, d’information, de conflits d’intérêts, de transparence et de diligence s’agissant de la transmission d’ordres. Là encore, le trustee doit se soumettre à un audit indépendant conduit généralement annuellement.
A noter qu’Onyx & Cie SA compte parmi les seuls prestataires de services financiers en Suisse à disposer à la fois d’une licence de trustee et de gestionnaire de fortune indépendant délivrées par la FINMA. En d’autres termes, la société peut également gérer en toute indépendance et de manière intégrée les actifs financiers des trusts qui lui sont confiés, sans devoir recourir à un prestataire externe.
Le trustee est enfin soumis à des obligations de diligence en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d’argent) ainsi que de reporting, notamment en matière fiscale (FATCA, échange automatique de renseignements).
Qui peut être trustee et quels sont ses devoirs et prérogatives ?
Le trustee peut généralement être une personne physique ou morale. Dans la première hypothèse, certaines juridictions exigent alors plusieurs co-trustees. Parfois, un nombre maximum de trustees est imposé. Une combinaison de trustees « personnes morales » et « personnes physiques » est bien entendu envisageable.
Il est également même possible de dissocier les fonctions des trustees : ainsi par exemple, selon le droit néo-zélandais, il est loisible de désigner un « managing trustee » basé en Suisse, responsable de la gestion courante du trust mais prenant des conseils auprès d’un « advisory trustee » pour les investissements, domicilié en Italie, pays de résidence du settlor. Le managing trustee, donnera des instructions contraignantes au « custodian trustee », résident en Nouvelle-Zélande. Du point de vue externe, ce dernier sera considéré comme l’unique propriétaire des avoirs mis en trust ; partant le trust sera dans son intégralité soumis à la législation locale.
A noter que le managing trustee ne pourra être tenu responsable d’avoir suivi les conseils de l’advisory trustee. Il en va de même s’agissant du custodian trustee pour les instructions reçues du managing trustee.
Cette solution, intitulée « remote control provisions », permet au client non seulement d’éviter les désagréments liés au décalage horaire mais vise également à rassurer le settlor qui serait inquiet à l’idée de transférer tous les pouvoirs en mains d’un seul et unique trustee. Cette solution paraît d’ailleurs préférable à l’utilisation des reserved powers du settlor et permet d’éviter la qualification de sham trust.
Comme expliqué dans le détail ci-après, les trustees professionnels sont généralement régulés dans leur pays de résidence.
En tant que principe cardinal, le trustee a l’obligation d’administrer et de gérer le trust conformément au trust instrument et subsidiairement à la loi et la jurisprudence de la proper law du trust. Dans l’exercice de ses fonctions, il doit toujours agir de bonne foi, de manière honnête et impartiale (à savoir sans avantager indument un bénéficiaire par rapport à un autre), dans l’intérêt unique des bénéficiaires, en faisant preuve de soin, de compétence et de diligence, évitant tout conflit d’intérêts (absence de self-dealing, interdiction de percevoir des rétrocessions, etc.). On parle alors de « fiduciary duties » du trustee. A moins que le trust deed ou la proper law du trust ne prévoit le contraire, le trustee doit en principe agir personnellement sans droit de délégation de ses tâches. Le trustee a également une obligation de rendre compte aux bénéficiaires dont l’étendue dépend de la proper law du trust et de la jurisprudence. Bien entendu, le trustee a l’obligation de séparer les actifs trustaux de ses propres biens et de ceux détenus dans d’autres trusts. Enfin, le trustee doit saisir le juge en tant que cela est nécessaire et lui demander des instructions.
Les pouvoirs du trustee se déclinent en deux grandes catégories, à savoir ceux résultant de l’administration du trust (investissement des avoirs, délégation des tâches à des tiers, transiger en justice, assurer les biens, etc.) et ceux ayant trait aux distributions en faveur des bénéficiaires.
Sur ce dernier point, les pouvoirs du trustee doivent être différenciés selon le type de trust considéré : en présence d’un trust fixe, il suffira de vérifier que les bénéficiaires aient effectivement cette qualité et que les montants des distributions soient correctement versés, conformément au trust instrument.
Dans l’hypothèse d’un trust discrétionnaire, il appartiendra au trustee de décider à qui, combien et quand il distribue des avoirs aux bénéficiaires (« who, when, what »). Il peut aussi décider de ne rien verser et d’accumuler du capital mais devra régulièrement considérer si une distribution doit être effectuée ou non, en disposant de suffisamment d’informations sur la situation personnelle, financière et fiscale des bénéficiaires.
En contrepartie de ses services, le trustee est en droit d’être rémunéré. La rémunération est généralement prévue dans les documents du trust et est calculée soit de manière forfaitaire, soit d’après le temps consacré à l’affaire ou encore en proportion de la valeur des actifs trustaux (voire une combinaison des trois modes). En outre, le trustee a le droit au remboursement de ses impenses et des frais du trust au moyen du patrimoine de celui-ci et jouit d’un droit de rétention à cet égard.
S’agissant enfin de la responsabilité du trustee, elle est généralement décrite dans le trust instrument ou dans la loi et comprend une indemnisation à l’égard des bénéficiaires de tout dommage résultant d’une violation intentionnelle ou grossièrement négligente de ses devoirs de trustee (« breach of trust »). A l’égard des tiers, le trustee répond généralement personnellement et sur tous ses biens des dettes du trust. En contrepartie, il peut puiser dans les actifs du trust pour se faire rembourser des dépenses acquittées au moyen de ses propres fonds (« right of indemnity »), sous réserve bien évidemment d’un breach of trust. Certaines juridictions (par exemple, les BVI ou Guernesey) permettent toutefois de restreindre les dettes du trust au montant du trust fund, à condition que le contrat mentionne expressément la qualité du trustee.
Les juridictions offshores disposant d’un droit moderne en matière de trusts offrent une flexibilité quasiment sans limite du settlor dans la constitution et l’administration de sa structure (constitution d’un purpose trust, nomination d’un protector, reserved powers du settlor, etc.).
Comment les fonds du trust sont-ils investis ?
La réponse à cette question dépend du type d’actifs composant le trust. Ainsi, le trustee ne gérera pas de la même manière un portefeuille de titres et un patrimoine immobilier.
En tout état de cause, dans ses décisions d’investissement, le trustee devra toujours agir de manière honnête dans l’intérêt des bénéficiaires uniquement, à l’exclusion de ses propres intérêts ou de ceux de tout autre tiers. Il doit faire preuve de soin dans ses choix, c’est-à-dire utiliser le même standard de diligence, de connaissances et de compétences qu’un homme d’affaires prudent et vigilant aurait dans la gestion des affaires d’autrui. Le standard requis pour un trustee professionnel comme Onyx Trust est plus élevé est correspond à celui d’un expert dans son domaine de compétence, notamment dans le domaine de la gestion de fortune.
A noter que dans la conception historique du trust, le trustee avait pour rôle avant tout la préservation du capital et si possible la production d’un revenu. Dans la vision plus moderne actuelle, le trustee doit rechercher par les investissements opérés, d’atteindre un équilibre entre risques et revenus/gains en capitaux en optant pour une stratégie diversifiée et adaptée au trust en question. Sauf instruction contraire du settlor dans le trust deed, un risque modéré est acceptable à condition que les principes de diversification soient respectés. Il conviendra toutefois d’analyser dans le détail la proper law du trust et idéalement d’insérer dans le trust deed une clause expresse sur les investissements autorisés ou non par le trustee et les objectifs de rendements, en particulier si le settlor souhaite maintenir en trust des actifs ne produisant pas de revenu du tout afin d’éviter que le trustee ne soit obligé de s’en séparer (par exemple une maison familiale). A titre d’exemple, les îles Caïmans n’ont pas de législation spécifique en matière de placements pour les avoirs détenus en trust, si bien qu’il convient d’appliquer les règles de la common law uniquement, à défaut de clause spécifique dans le trust instrument.
Le trustee doit en outre tenir compte des divers bénéficiaires et de leur situation (on n’investira pas de la même façon pour un bénéficiaire de 30 ans célibataire qu’un retraité de 65 ans), du type de trust (discrétionnaire ou fixe), des besoins en liquidités, de la fortune du trust et globale de la famille, de la letter of wishes ainsi que du pouvoir de veto du settlor ou du protector. Onyx Trust établira en tout état de cause toujours une stratégie d’investissement sur la base d’un profil de risque convenu avec le client lors de la constitution du trust, voire ultérieurement en cas de changement de circonstances (changement de bénéficiaire, etc.).
La présence d’un patrimoine immobilier dans le trust nécessite une gestion active de la part du trustee ou la délégation de celle-ci à une régie/un agent que le trustee devra surveiller de manière appropriée. Il convient de garder à l’esprit qu’une propriété immobilière doit être entretenue, éventuellement développée/améliorée afin d’en augmenter sa valeur. Ainsi, le settlor devra s’assurer qu’il transfère également des liquidités nécessaires dans le trust à cet effet. Les investissements immobiliers sont en revanche particulièrement illiquides et devront être considérés sur le long terme par le trustee et les bénéficiaires. Ils devront être assurés de manière appropriée.
La détention de participations dans des sociétés privées (« private equity ») appartenant au settlor ou à sa famille représente les actifs les plus difficiles à gérer pour le trustee. Cette situation présente des risques notamment en termes de :
- diversification et de rendement : en effet, le trustee doit en principe non seulement préserver la fortune du trust mais également en accroitre sa valeur, afin au minimum de combattre l’inflation en procédant à des investissements diversifiés. Or, le settlor qui a bâti son empire « pièce par pièce » souhaite souvent garder son entreprise familiale, peu importe si celle-ci sera pérenne et rentable dans le futur. Interdiction est ainsi souvent faite au trustee de vendre lesdites participations même si des pertes sont enregistrées. Il s’en suit une position inconfortable du trustee ; afin de palier à cette difficulté, il conviendra d’insérer une clause appropriée (dite « anti-Bartlett») dans le trust instrument mentionnant que le trustee ne sera pas soumis à une obligation de diversification s’agissant de ces participations, qu’il sera exonéré de responsabilité quant à la décision de conserver l’entreprise familiale et que le settlor/protector disposera d’un pouvoir de véto ou de donner des instructions au trustee à cet égard.
- de gestion : dans une large majorité des cas, le settlor ne veut pas que le trustee intervienne dans la gestion de l’entreprise familiale de son vivant. Aussi, le trustee ne dispose souvent pas des compétences et de l’expérience nécessaires pour gérer la société au jour le jour. Cela pose des problèmes dans la mesure où le trustee doit sauvegarder les intérêts des bénéficiaires. Ainsi, outre une clause spécifique d’exonération de responsabilité introduite dans les documents du trust, le trustee devra disposer de toutes les informations nécessaires eu égard à l’affaire sous peine de commettre un breach of trust. L’idéal sera de nommer un représentant du trustee au conseil d’administration de la société.
Quels sont les droits des bénéficiaires à l’égard du trustee ?
La condition de la certainty of object exige, sous peine de nullité du trust, que les bénéficiaires de celui-ci soient définis de manière suffisamment précise. Ils doivent être soit nommés/identifiés, soit déterminables de manière certaine.
L’étendue des droits dont jouissent les bénéficiaires dépend avant tout du type de trust considéré (discrétionnaire, fixe, conditionnel, etc.), notamment s’agissant du droit ferme et inconditionnel ou non à des distributions. Pour le reste, l’une des prérogatives essentielles des bénéficiaires est le droit aux renseignements. Si ce droit est irréductible (arrêt Schmidt v. Rosewood), son étendue varie en fonction du type de trust et de la proper law de celui-ci. Généralement, une approche au cas par cas sera effectuée, y compris par les tribunaux qui peuvent interdire la divulgation de certains documents dans des circonstances exceptionnelles. On retiendra néanmoins que si les bénéficiaires doivent pouvoir accéder à la comptabilité du trust, il n’en va pas de même de la letter of wishes ou des procès-verbaux des délibérations des trustees. En outre, même si trustee n’a pas l’obligation d’informer tous les bénéficiaires de leur intérêt bénéficiaire dans le cadre d’un trust discrétionnaire, il faut au moins que l’un d’entre eux puisse avoir la possibilité de vérifier et d’exiger du trustee qu’il respecte ses obligations.
En outre, en droit anglais, les bénéficiaires peuvent par un accord unanime, décider collectivement de mettre fin au trust, à condition qu’ils soient connus, majeurs et capable de discernement, ce qui ne va pas sans poser des problèmes si les bénéficiaires potentiels du trust sont les descendants du settlor, puisque des enfants non encore conçus peuvent faire partie du cercle des bénéficiaires. Certaines juridictions offshores modernes excluent d’ailleurs expressément cette règle.
Les bénéficiaires peuvent enfin faire valoir à l’égard du trustee tout breach of trust (par exemple la violation du « duty of care and skill », une erreur en matière de choix et de surveillance des délégataires, la non considération des pouvoirs discrétionnaires octroyés, etc.), y compris par devant les tribunaux. Ils disposent à cet égard à la fois de prétentions personnelles mais également réelles à l’égard du trustee, voire même parfois à l’égard des tiers (droit de « tracing » à savoir de revendiquer la propriété de biens dont le trustee aurait indument disposés).
Quels sont les attributions du protector ?
Le settlor peut vouloir (ce n’est pas obligatoire) nommer un protector, soit une personne proche de confiance (avocat, notaire, conseiller financier, membre de la famille, etc.), chargée de superviser l’activité du trustee. La présence d’un protector doit être perçue comme une bonne chose dans la mesure où cette personne sert généralement de canal de contact entre le trustee, le settlor et les bénéficiaires. Par ailleurs, le protector connait souvent très bien la situation familiale du client, permettant de prévenir les litiges potentiels et d’assister le trustee dans l’administration du trust.
En règle générale, la proper law du trust ne contient pas (ou uniquement de manière sommaire) de dispositions spécifiques sur le protector.
Les pouvoirs de ce dernier peuvent être étroits (uniquement la révision des comptes et le déclenchement d’un audit par exemple) ou très larges selon les choix du settlor. Ils peuvent être positifs (droit de donner des instructions au trustee) ou négatifs (droit de véto ou pouvoir de ratification) et porter sur des actes d’administration (remplacement du trustee, approbation des investissements, de la rémunération du trustee, changement de la proper law du trust, approbation des comptes, etc.) ou de disposition (approbation des distributions du trustee, ajout ou suppression de bénéficiaires, etc.). Le protector n’est toutefois généralement pas impliqué dans la gestion quotidienne du trust.
Bien que cela soit débattu, on considère généralement aujourd’hui que le protector possède des fiduciary duties, au même titre que le trustee (voir ci-dessus), à l’égard des bénéficiaires.
A noter que des pouvoirs trop étendus au protector peuvent non seulement engendrer des problèmes au niveau fiscal (gestion effective du trust au lieu de résidence/domicile du protector) mais également mettre en péril l’existence même du trust (sham). En outre, des situations de blocage peuvent apparaître lors de conflits avec le trustee (en cas de véto du protector s’agissant des décisions de ce dernier par exemple).
Comment puis-je garder le contrôle sur mon trust ?
Comme indiqué ci-dessus, suite à la constitution du trust et au transfert des biens dans celui-ci, le settlor ne peut en principe plus jouir des biens du trust fund, n’a pas la faculté de donner des instructions contraignantes au trustee et ne possède pas la qualité pour agir en justice contre ce dernier, cette compétence appartenant aux bénéficiaires. En réalité, rien n’empêche le settlor et le trustee de se concerter mais le trustee doit être en mesure d’agir en toute indépendance (« duty to consider »). Si ce dernier ne fait que suivre aveuglément les instructions du settlor, il existe un risque non négligeable que le trust soit considéré comme nul (sham trust), faute de certainty of intention, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses.
Afin néanmoins de conserver le contrôle sur le trust, plusieurs solutions, développées notamment par les juridictions offshores modernes, sont disponibles. Ainsi, le settlor peut :
- Constituer un trust révocable qui deviendra un véhicule irrévocable uniquement à son décès ;
- Désigner un protector afin de surveiller ou de donner des instructions au trustee ;
- Se nommer lui-même trustee, bénéficiaire ou protector (bien entendu il n’est pas possible d’exercer toutes ces fonctions à la fois) ;
- Imposer ses volontés dans le trust deed et exprimer ses vœux dans la letter of wishes ;
- Se réserver, selon les possibilités offertent par la proper law du trust, un certain nombre de pouvoirs sur le trust comme par exemple le :
- pouvoir de révoquer, modifier ou amender le trust instrument ;
- pouvoir d’attribuer du revenu ou du capital du patrimoine du trust, ou les deux ;
- pouvoir d’agir en tant qu’administrateur ou agent de toute société détenue intégralement ou en partie par le trust ;
- pouvoir de donner des directives contraignantes au trustee concernant l’achat, la détention ou la vente des biens du trust ;
- pouvoir de désigner, d’ajouter ou de révoquer un trustee, un protector, un bénéficiaire ou une personne exclue ;
- pouvoir de modifier le droit applicable et le for aux fins de l’administration du trust ;
- pouvoir de restreindre l’exercice de pouvoirs ou de facultés décisionnelles du trustee en imposant qu’ils ne soient exercés qu’avec le consentement du settlor (droit de veto).
Il est important de garder à l’esprit que chacune de ces mesures comporte également des désavantages qu’il convient de connaitre et s’agissant plus particulière des reserved powers du settlor, une approche très prudente doit être suivie afin d’éviter tout risque que le trust soit déclaré nul.
Les juridictions offshores disposant d’un droit moderne en matière de trusts offrent une flexibilité quasiment sans limite du settlor dans la constitution et l’administration de sa structure (constitution d’un purpose trust, nomination d’un protector, reserved powers du settlor, etc.).
Qu’est-ce qu’une « private trust company » ?
La création d’une private trust company (PTC) peut être une alternative intéressante aux familles fortunées qui souhaitent garder un maximum de contrôle sur la gestion de leur(s) trust(s).
Les private trust companies, constituées généralement sous la forme d’une société, ont pour seule vocation d’administrer un ou plusieurs trusts appartenant à une même famille ou à un même groupe de personnes. Ainsi, contrairement à un véritable trustee professionnel, elles n’offrent pas leurs services à destination du public et agissent comme trustee d’un seul ou plusieurs trusts interconnectés. Il est ainsi possible de nommer au conseil d’administration de la private trust company le settlor ou des personnes qui lui sont proches (conseiller personnel de la famille, avocat, etc.). Cette solution permet ainsi à la famille de conserver un contrôle étendu sur le management de son/ses trust(s). En outre, les exigences règlementaires, en termes de surveillance et d’obtention de licence sont bien évidemment moindres. Ainsi par exemple, la LEFin ne s’applique pas aux personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux. Ce sont principalement les juridictions modernes offshores comme les îles Caïmans, les BVI, la Nouvelle-Zélande ou Singapour qui permettent la création de private trust companies.
La private trust company est surtout utile lorsque la famille entend mettre en trust des biens particuliers comme les actions d’un groupe industriel familial, dans la mesure où un trustee professionnel n’aura pas nécessairement les connaissances et l’expérience requises (par exemple dans le secteur médical, la grande distribution, etc.). En outre, la private trust company permet de garantir la continuité de la gestion du trust au fil du temps sans qu’un changement de trustee n’ait besoin d’être considéré. Les conflits potentiels entre les bénéficiaires et l’administration du trust sont également moindres. Enfin, une private trust company permet une gestion plus flexible du trust dans la confidentialité la plus absolue.
En contrepartie, la création et l’administration d’une private trust company est complexe et onéreuse. A l’instar de la gestion d’un single family office, des professionnels devront en tout état de cause être nommés afin d’assister la famille. Par ailleurs, il est souvent exigé qu’un trustee régulé agisse aux côtés de la private trust company, notamment pour les questions règlementaires liées à la lutte contre le blanchiment d’argent ou à l’échange automatique de renseignements.
Un autre point délicat est celui de la détention des actions de la private trust company qui se fera généralement par le biais d’un purpose trust ou d’une fondation de famille. En effet, pour d’évidentes raisons de contrôle ultime sur le trust (à l’égard des céranciers, des héritiers réservataires, etc.), il est déconseillé de détenir les actions de celle-ci directement par des membres de la famille.
Enfin, les considérations fiscales et celles liées aux sham trusts doivent faire l’objet d’un examen attentif, notamment lorsque le settlor ou sa famille siège au conseil d’administration de la private trust company.
Au final, quels sont les avantages de constituer un trust ?
Une utilisation judicieuse du trust offre principalement quatre avantages au settlor et/ou aux bénéficiaires :
Tout d’abord, le trust, en particulier discrétionnaire, est l’instrument de planification successorale le plus performant qui soit. Sa flexibilité permet non seulement d’adapter la transmission du patrimoine aux besoins et aux particularités de chaque famille, mais également et surtout, en fonction des circonstances futures et imprévisibles de la vie.
Un trust discrétionnaire pourra par exemple protéger des héritiers excessivement dépensiers contre eux-mêmes, notamment s’ils traversent une période difficile (alcoolisme, toxicomanie, etc.), ou les mineurs, en différant leur droit à recevoir une partie du capital jusqu’à ce qu’ils aient atteint un certain âge ou une maturité suffisante.
Idem s’il est découvert par la suite que le conjoint menait une double vie du vivant du settlor, il conviendra alors de l’exclure du cercle des bénéficiaires.
Au contraire, en cas de grave maladie de l’un d’eux ou de nouveaux projets professionnels ou de vie, il sera opportun de les soutenir financièrement.
En clair, aucun autre instrument juridique que le trust, ni le testament ni même le pacte successoral, ne permet de prévoir à ce point les imprévus, obligeant au final le de cujus à deviner ce qui se produira après sa mort.
Aussi, dans la mesure où les trusts relèvent toujours du droit anglo-saxon, ils ne sont généralement pas soumis aux règles sur la réserve héréditaire (« forced heirship laws »), permettant ainsi au settlor de disposer de son patrimoine comme il l’entend sans restriction. A cet égard, les juridictions offshores modernes prévoient dans leur législation des dispositions explicitent excluant toute reconnaissance ou exécution de jugements étrangers qui attaqueraient le trust, respectivement le trustee, sur la base d’une prétendue violation des droits des héritiers réservataires (principalement le conjoint et les descendants du settlor).
Par ailleurs, la constitution d’un inter vivos trust permet d’éviter toutes les difficultés successorales notamment d’ordre procédurale au jour du décès du settlor, comme par exemple les procédures de « grant of probate » dans les pays anglo-saxons (équivalent à l’obtention d’un certificat d’héritiers) qui sont souvent longues, coûteuses, complexes et parfois non confidentielles. Le trustee étant d’ores et déjà le propriétaire des actifs trustaux à la mort du de cujus, aucune démarche particulière ne doit être entreprise.
Enfin, par le biais du trust, le settlor acquiert la certitude que ses dernières volontés seront respectées, notamment dans l’hypothèse où un protector aura été nommé.
Le trust est également un instrument de préservation et de protection du patrimoine. De ce chef, il peut notamment être utilisé afin d’assurer une continuité dans la détention d’actifs particuliers, comme les parts d’une entreprise ou une maison familiale. En transférant la propriété de certains biens dans les mains du trustee, le settlor s’assure ainsi que ceux-ci ne seront pas dilués parmi les héritiers de la deuxième ou troisième génération. Aussi, le risque qu’au décès du settlor, les actifs n’échoient à des personnes étrangères à la famille (par exemple les « pièces rapportées ») est écarté, préservant ainsi le capital pour les générations futures.
Dans la même veine, les trusts se présentent comme des véhicules idéaux pour contrer les droits des époux dans le cadre de procédure de divorce (« spousal claims »). Là encore, certaines juridictions offshores excluent expressément dans la loi, toute prétention des conjoints à l’égard d’un trust soumis à leur droit.
La mise en place d’un trust dit « protective » ou « spendthrift » permet également de protéger le patrimoine familial contre les créanciers des bénéficiaires ou du settlor, notamment dans l’hypothèse d’activités professionnelles financièrement risquées (par exemple la profession de médecin aux états-Unis). Même s’il existe des dispositions anti-fraude (par exemple la création d’un trust la veille de sa mise en faillite personnelle est prohibée), les juridictions offshores modernes, comme les Cook Islands, offrent, via l’asset protection trust, une protection très élevée contre les demandes en paiement des créanciers du settlor ou des bénéficiaires. Bien entendu, le lieu de localisation de biens mis en trust revêt ici un caractère critique. De même, les conséquences pénales ou civiles dans le pays de résidence du settlor ou du bénéficiaire, voire même du trustee, ne peuvent pas être négligées.
Enfin, le trust permet d’abriter des biens en sécurité surtout dans les pays qui connaissent une forte instabilité politique ou économique.
Bien qu’ayant perdu de son importance ces dernières années, notamment dans les juridictions à forte fiscalité, le trust demeure un outil de planification fiscale. Dans le strict respect des lois, la mise en trust d’actifs permet parfois d’éviter ou de différer l’impôt sur le revenu et/ou la fortune. A titre d’exemple, la constitution d’un trust irrévocable et discrétionnaire, reconnu comme tel par l’administration fiscale helvétique, avant la prise de résidence en Suisse par le settlor, permet d’éviter l’imposition sur la fortune du trust, le patrimoine de celui-ci ne pouvant être imputé ni au settlor ni aux bénéficiaires. S’agissant des revenus subséquents du trust, l’imposition sera elle différée jusqu’au moment de la distribution aux bénéficiaires, à condition bien entendu que ces derniers soient résidents en Suisse à ce moment.
De même, il est parfois possible d’optimiser les impôts sur les donations et les successions par la constitution d’un trust. Bien entendu, une analyse minutieuse de la situation fiscale du trust et de son trustee, du settlor et des bénéficiaires dans leurs états de résidence respectifs est nécessaire afin d’éviter toute mauvaise surprise, beaucoup de pays ayant mise en place des dispositions anti-abus. Il est hautement recommandé de demander en amont un ruling fiscal quand cela est possible car la pratique peut varier. Ainsi, à titre d’exemple, certaines administrations fiscales cantonales suisses exonèrent fiscalement les gains en capitaux provenant de distributions d’un trust irrévocable et discrétionnaire, alors que d’autres les imposent.
Enfin, le trust assure confidentialité et protection accrue de la sphère privée, tant du côté du settlor que des bénéficiaires. En effet, comme relevé ci-dessus les bénéficiaires ne doivent pas nécessairement être informés au préalable des intentions du settlor. Parfois, ils ne seront même jamais au courant qu’un trust en leur faveur a été constitué, notamment si le settlor ou le trustee décide de les retirer de la classe des bénéficiaires. De même, deux bénéficiaires pourront ne jamais se connaître et l’anonymat du settlor demeurera préservé vis-à-vis des tiers. Enfin, les documents du trust ne sont jamais connus du public, y compris dans les juridictions où le trust doit être enregistré.