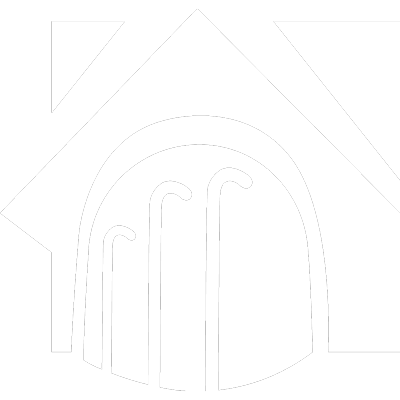Table des matières
- Réserve héréditaire, testament, pacte successoral, donation : comment planifier votre succession ?
- Quel est le droit applicable à ma succession ?
- Quelles sont les conséquences du droit applicable sur ma succession ?
- Quelles sont les règles suisses en matière de succession ?
- Par quels moyens puis-je disposer des biens de ma succession ?
- Pourquoi rédiger un testament ?
- Que puis-je régler dans un testament ?
- Quelles sont les conditions formelles pour établir un testament en droit ?
- Quel est l’intérêt de recourir aux services d’un exécuteur testamentaire ?
- Qu’est-ce qu’un pacte successoral ?
- De quoi faut-il tenir compte lors de la conclusion d’un pacte successoral et quelles sont les différences par rapport à un testament ?
- Comment conclure un pacte successoral ?
Réserve héréditaire, testament, pacte successoral, donation : comment planifier votre succession ?
Quelque 95 milliards de francs sont hérités en Suisse chaque année ; or, seuls 32% des Suisses ont réglé leur succession par un testament. Il est pourtant notoire que les conflits successoraux sont, avec ceux de voisinage et les procédures de divorce, les litiges les plus acerbes.
En outre, le droit applicable « par défaut » n’est souvent pas en ligne avec les volontés du de cujus. Or, le résultat d’une vie de labeur et le patrimoine accumulé au fil de décennies doivent revenir un jour aux personnes qui vous sont les plus chères. Une planification soigneuse de votre succession permet d’assurer la sécurité de vos proches, d’éviter des tensions autour d’un héritage, en communiquant de manière anticipée et transparente avec les membres de votre famille et surtout de transmettre votre patrimoine comme vous le souhaitez et selon vos priorités. Le sujet étant souvent complexe et délicat à aborder, il est important de faire appel à des spécialistes, surtout en présence d’un patrimoine composé d’actifs diversifiés situés dans plusieurs juridictions (propriétés immobilières, œuvres d’art, yachts, aéronefs, comptes bancaires, etc.).
Chez Onyx Trust, nous vous aidons à répartir votre héritage selon vos souhaits, dans le cadre des possibilités légales. Nos avocats, tous admis au Barreau suisse, vous conseillent et vous assistent dans toutes vos démarches en matière de planification successorale et plus particulièrement en matière de :
- vérification de la réglementation, y compris internationale, compte tenu de votre domicile et nationalité, du lieu de situation de vos biens et de votre situation familiale ;
- présentation des possibilités et des limites à la planification successorale (trust, fondation de famille ou d’utilité publique, assurance-vie, réserve héréditaire, etc.) ;
- rédaction de contrat de mariage ou de concubinage, testament, pacte successoral, avance d’hoirie, acte de donation ;
- exécution testamentaire ;
- acte de partage successoral et octroi de legs ;
- assistance en matière de transmission d’entreprise ;
- impôt sur les successions et les donations, y compris à l’international ;
- reddition de comptes et collecte d’informations (banques, assurances, etc.) ;
- conservation des documents ;
- gestion des conflits lors d’héritage et représentation en justice.
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour organiser sa succession, prenez dès aujourd’hui les mesures nécessaires pour avoir l’esprit tranquille demain.
Découvrez ci-après notre dossier successoral détaillant les dispositions légales contraignantes en droit suisse ainsi que les possibilités d’aménagement en matière de successions.
Quel est le droit applicable à ma succession ?
Le droit suisse consacre le principe de l’unité de la succession, y compris dans les relations internationales. Cela signifie qu’une seule autorité est en principe compétente pour s’occuper de l’ensemble de votre succession, laquelle est régie par un seul droit, peu importe le lieu de situation de vos biens. Le décès d’une personne n’ouvre donc en principe qu’une seule succession.
Conformément à la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), la Suisse se réfère au dernier domicile du défunt pour fonder tant la compétence des autorités que s’agissant du droit applicable. En d’autres termes, si vous êtes domicilié à Genève au moment de votre décès, votre succession sera réglée par la Justice de Paix du canton de Genève, laquelle appliquera le droit suisse.
Comme souvent, ce principe souffre d’exceptions, par exemple lorsque le de cujus possède des immeubles à l’étranger et que les autorités étrangères réclament une compétence exclusive à leur sujet, ou si les autorités étrangères ne s’occupent pas de tout ou partie de la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès (compétence subsidiaire), ou encore en cas d’élection de for ou de droit, dans un testament ou un pacte successoral, par un Suisse ayant eu son dernier domicile à l’étranger.
Le droit suisse permet en outre à une personne, de nationalité étrangère ou bi-binationale suisse, domiciliée en Suisse à son décès, de soumettre sa succession à son droit national étranger (la compétence des autorités également), au moyen d’une professio juris figurant dans un testament ou un pacte successoral. Ce choix n’est cependant valable qu’à la condition que le défunt ait eu la nationalité en question au moment de disposer ou au moment de son décès. Par ailleurs, les Suisses ne peuvent pas déroger aux dispositions du droit suisse sur la réserve héréditaire.
A noter encore que la validité d’un testament (et par analogie d’un pacte successoral) est régie quant à la forme par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. La validité au fond (y compris la capacité de disposer), la révocabilité et l’interprétation d’un testament, ainsi que les effets déployés par ses dispositions, sont régis par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment où il dispose. En revanche, la quotité disponible demeure régie par le droit applicable à la succession. Une professio juris en faveur de la loi nationale du disposant est toutefois autorisée. Des règles similaires s’appliquent pour les pactes successoraux.
On relèvera enfin que nos voisins européens se sont dotés en 2015 d’un Règlement 650/2012 sur les successions internationales. Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l’Union européenne, ce texte a des conséquences directes dans notre pays puisqu’il prévoit parfois des règles de conflit fondées sur d’autres critères de rattachement que ceux appliqués en Suisse, comme par exemple la notion de résidence habituelle à la place du domicile. Il en résulte un risque de conflit positif de compétences dans plusieurs situations. A titre d’exemple, le droit européen prévoit des compétences subsidiaires lorsque le défunt, qui vivait dans un état tiers comme la Suisse, a laissé des biens successoraux (mobiliers ou immobiliers) dans un État membre de l’Union Européenne. Dans un tel cas, les autorités de cet État sont compétentes pour régler l’entier de la succession (y compris les biens situés en Suisse) si le défunt avait la nationalité de cet État membre au moment de son décès ou s’il a transféré sa résidence habituelle de cet État membre en Suisse dans les 5 ans précédant le décès. Afin de compliquer encore un peu les choses, dans cette hypothèse, sous réserve d’une professio juris valable du défunt, le droit suisse devrait néanmoins être applicable à la succession. Consciente de cet imbroglio juridique et désireuse d’harmoniser les règles sur les successions internationales avec l’Union européenne, la Suisse a récemment modifié sa Loi fédérale sur le droit international privé. La nouvelle mouture est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Vous trouverez dans notre rubrique « actualité » un article détaillé sur ce sujet.
Les moyens pour éviter l’application des règles sur les réserves héréditaires sont peu nombreux en droit suisse ; outre le choix d’un droit étranger favorable au défunt, la constitution d’un trust ou la conclusion d’un pacte successoral peuvent constituer des mesures efficaces.
Quelles sont les conséquences du droit applicable sur ma succession ?
La liberté de disposer est limitée en droit suisse par le système dit des « réserves héréditaires », ces dernières correspondent à la part de l’héritage qui ne peut pas être attribuée à une tierce personne. Sont des héritiers réservataires, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant ainsi que les descendants. Ainsi, si le droit suisse est applicable à la succession, les réserves héréditaires qui y sont prévues doivent être impérativement respectées. A défaut, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve peuvent intenter une action dite « en réduction » pour la recomposer.
En revanche, si le droit national choisi par le défunt au moyen d’une professio juris ne prévoit pas de réserves héréditaires (dans les pays anglo-saxons par exemple), il est entièrement libre de répartir ses biens à son décès, nonobstant son dernier domicile en Suisse. En effet, les réserves héréditaires du droit suisse ne relèvent pas de l’ordre public international et le choix d’un droit étranger pour régir une succession ne peut en aucun cas constituer un abus de droit, même si ce choix ne correspond pas toujours au droit qui est le plus proche du défunt, mais bien celui qui favorisera le mieux ses desseins. Ainsi, les héritiers d’une personne de nationalité étrangère, domiciliée en Suisse à son décès, ne peuvent par conséquent pas réclamer la réserve héréditaire qu’ils auraient eue si le droit suisse avait été applicable à la succession, lorsque le défunt a valablement soumis sa succession à son droit national. A noter que cette règle n’est toutefois pas applicable pour les binationaux suisses.
Aussi, il est intéressant de constater que le de cujus peut, grâce à une professio juris, organiser sa succession au moyen d’un trust post mortem si son droit national le permet (voir ci-après).
En conclusion, il convient de retenir que la liberté de disposer pour cause de mort augmente sensiblement lorsqu’il est possible de choisir la loi qui sera applicable à sa succession.
Quelles sont les règles suisses en matière de succession ?
Si je ne fais pas de testament
Le Code civil prévoit une solution pour les personnes qui ne règlent pas leur succession de leur vivant : on parle alors de succession légale.
Le droit suisse des successions fonctionne selon le système dit « des parentèles ». Une parentèle correspond à un groupe de personnes qui présente un certain degré de parenté avec le défunt.
Les différentes parentèles forment une hiérarchie des ayants droit à la succession. Ainsi, la parentèle la plus proche exclut celles qui sont plus éloignées. En conséquence, les héritiers légaux sont toujours ceux de la parentèle la plus proche avec le de cujus.
La première parentèle est celle des descendants directs du défunt, soit ses enfants, naturels ou adoptés, ou leurs descendants. Les enfants héritent à parts égales par branche.
La deuxième parentèle est bénéficiaire de la succession lorsqu’il ne reste aucun membre de la première parentèle. Elle comprend les père et mère ou, en cas de prédécès, les frères et sœurs du défunt voire leurs descendants, si l’un d’eux est prédécédé.
Enfin, la dernière parentèle est composée des grands-parents du de cujus et de leurs descendants. Ces derniers comprennent donc les oncles, tantes, cousins et cousines ainsi que leurs descendants.
Le conjoint se situe en dehors du système des parentèles et hérite dans des proportions différentes en fonction des héritiers avec lesquels il doit partager la succession.
Ainsi, par exemple, en présence d’une famille composée de deux enfants (1ère parentèle), le conjoint héritera de la moitié de la succession et chaque enfant d’un quart.
Si le couple n’a pas d’enfant, les parents du défunt (2ème parentèle) hériteront d’un quart de la succession et le conjoint des trois quarts.
Enfin, à défaut de descendants dans la parentèle des parents (3ème parentèle), le conjoint percevra la totalité du montant de la succession.
Est-il possible de déroger à la succession légale ?
Il est tout-à-fait possible de déroger aux règles prévues par le Code civil mais dans certaines limites seulement. En effet, comme déjà relevé précédemment, le droit suisse prévoit que certains héritiers légaux du défunt ont un droit à une part minimum de la succession, appelée « réserve héréditaire ». Depuis le 1er janvier 2023, les héritiers dits réservataires sont les enfants du défunt et le conjoint. La réserve héréditaire pour les parents a été totalement supprimée et celle des descendants ne s’élève plus qu’à la moitié de leur part (la réserve du conjoint demeure établie à la moitié de sa part successorale). La différence entre les réserves héréditaires et les parts successorales légales donne la quotité disponible, que vous pouvez léguer comme bon vous semble dans un testament. Les tableaux ci-dessous déterminent à combien s’élève votre quotité disponible selon les différentes configurations familiales possibles :
Si vous êtes marié-e :
Si vous êtes célibataire ou divorcé-e/veuf/veuve :
Il ressort de ces tableaux qu’en toute hypothèse, il est possible de disposer librement au moins de la moitié de sa succession selon la conception suisse.
Que se passe-t-il si je décide de ne pas respecter les réserves héréditaires dans mon testament, mon pacte successoral ou mon contrat de mariage ?
A moins d’être exclu de la succession par exhérédation (dans des cas exceptionnels), les héritiers réservataires ne peuvent pas être privés du montant de leur réserve. Il n’est donc pas possible de déroger à ces règles dans son testament, sous peine que les héritiers contestent possiblement la succession en justice.
Alternativement, il est loisible de signer un pacte successoral par lequel ces héritiers renoncent à leur réserve. La mise en place d’un trust permet également dans certains cas d’éluder ces règles.
Comme les réserves sont des fractions de la masse successorale, il est envisageable en pratique de diminuer de son vivant la quantité de biens qui se retrouvera dans la succession, en faisant des libéralités entre vifs (donations, etc.). Ainsi, il est techniquement possible de rendre illusoire le mécanisme des réserves, les héritiers recevant bien la fraction de la succession qui leur est due selon la loi mais le montant effectif qu’ils percevraient serait en partie ou totalement diminué par les actes entrepris du vivant du de cujus. Le droit suisse prévoit des mécanismes anti-abus par le biais dit de « la réunion ».
L’opération de réunion, qui est purement comptable, consiste à ajouter à la masse successorale au décès, le montant des libéralités que le de cujus a faites entre vifs, cela afin de calculer les réserves et la quotité disponible.
Si la masse successorale permet de couvrir les réserves, les libéralités ne sont pas remises en cause. Si au contraire, la masse restante ne permet pas de couvrir les réserves, les héritiers réservataires peuvent attaquer la succession et réduire en conséquence les libéralités faites par le défunt, en exigeant des bénéficiaires la restitution dans un certain ordre de ce qui est nécessaire pour reconstituer les réserves, par le biais d’une action appelée « en réduction », introduite dans un certain délai (1 ans dès la connaissance de la lésion de la réserve héréditaire mais dans tous les cas dans les 10 ans après l’ouverture du testament ou de la succession selon les cas) et auprès du tribunal du dernier domicile du défunt.
La réunion est obligatoire notamment dans les hypothèses suivantes :
- Les libéralités que le défunt peut librement révoquer, à l’exclusion des présents d’usage. Il s’agit par exemple de la constitution d’un trust révocable, sans limite de temps ;
- Les libéralités faites à n’importe qui par le de cujus de son vivant dans les 5 années antérieures à son décès et qui ne sont pas des présents d’usage ;
- Les aliénations que le défunt a effectuées dans l’intention manifeste de contourner les règles sur les réserves héréditaires ;
- Les libéralités faites à titre d’avancement d’hoirie quand elles ne sont pas soumises au rapport.
Qu’en est-il si je décide de faire une avance d’hoirie à mes héritiers ?
Une avance d’hoirie consiste en une avance que reçoit un héritier sur sa future part successorale. En d’autres termes, il s’agit d’une donation consentie par le de cujus de son vivant en anticipation de l’héritage qu’il laissera à ses héritiers. Elle peut être en argent ou en nature (immeuble, etc.). L’avance d’hoirie permet de soutenir financièrement des proches de votre vivant, qui pourront en profiter pour concrétiser leurs projets (par exemple financer une formation, acquérir un logement ou démarrer une activité indépendante).
Les avances d’hoirie sont généralement rapportables, ce qui signifie qu’elles sont automatiquement réintégrées à la succession au moment du décès pour le calcul des parts successorales (attention à ne pas confondre ce mécanisme avec la réunion qui a vocation à protéger les réserves héréditaires).
Les héritiers ont le choix au moment du partage (à moins que le défunt n’ait imposé un mode de rapport au moment de l’avancement d’hoirie) 1) de rapporter en nature les biens qu’ils ont reçus ou 2) d’en imputer la valeur sur leur part successorale. Dans la première hypothèse, les héritiers transfèrent à la communauté héréditaire la propriété des biens reçus. Tout se passe ensuite comme si ces biens font partie de la succession et les héritiers détermineront à qui ils reviennent dans le partage. Dans la seconde hypothèse, les héritiers décident de garder les biens qu’ils ont reçus mais pour calculer la masse à partager, on ajoutera comptablement la valeur de ceux-ci à celle des autres biens de la succession. Lors du partage, la valeur des biens rapportés sera imputée sur la part des héritiers, en diminution de ce qu’ils doivent recevoir.
Le mécanisme du rapport à un caractère dispositif. C’est donc le défunt qui décide si les biens remis aux héritiers sont des avances d’hoirie ou de véritables libéralités non rapportables dans la succession (mais potentiellement sujettes à réunion en tous les cas). Pour le cas où le de cujus n’a pas exprimé de volonté, la loi établit des présomptions.
On présume ainsi par exemple qu’il y a rapport si des libéralités sont faites à un descendant afin de s’établir dans l’existence (on parle de « dotation », soit toute libéralité destinée à créer, assurer ou améliorer l’établissement du bénéficiaire dans l’existence que cela soit pour sa vie familiale ou professionnelle, à titre initial ou non (par exemple l’achat d’une maison, de matériel professionnel, etc.), sous forme d’argent ou de tout autre bien comme des titres, etc.) ou pour financer sa formation au-delà de ce qui est usuel (allant au-delà du devoir d’entretien légal des enfants).
Il convient alors de déterminer la valeur du rapport. La loi prévoit des règles qui sont de droit dispositif. Ainsi le défunt peut décider lui-même non seulement du moment et du mode d’estimation de la valeur des biens rapportés mais également le montant du rapport.
A défaut, la loi prévoit que si le bien n’a pas été aliéné avant l’ouverture de la succession, le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour du décès. Le moment décisif n’est donc ni celui auquel l’avancement d’hoirie a été faite, ni en principe celui du partage de la succession. Si le bien a été aliéné avant l’ouverture de la succession, le rapport aura lieu d’après le prix de vente de la chose aliénée.
Il est possible de décider dans son testament de révoquer un rapport. Dans cette hypothèse, les biens donnés ne rentrerons pas dans la succession sous réserve de la réunion (voir ci-dessus).
La dispense de rapport peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la libéralité. Mais attention, lorsqu’elle est communiquée au bénéficiaire ou à des tiers, elle est irrévocable.
Il est important enfin de se rappeler que pour qu’il y ait rapport, il faut être héritier au moment du partage. Ainsi, si par exemple les héritiers légaux ne sont que légataires à hauteur de leur réserve (ce qui possible en droit suisse) ou qu’ils répudient la succession, ils ne seront pas tenus au rapport. Cela n’exclut en revanche pas la réunion.
Que se passe-t-il à mon décès ?
Lorsqu’un décès survient à domicile ou hors d’un établissement hospitalier, il conviendra de faire venir immédiatement un médecin sur place afin qu’il établisse un certificat de décès qui sera destiné à l’officier d’état civil. Ce document est également nécessaire pour le transport du corps.
Il convient ensuite d’informer l’officier d’état civil de l’arrondissement du lieu où l’événement s’est produit (dans les 2 jours par : le conjoint, les enfants et leurs conjoints puis, dans l’ordre, le plus proche parent du défunt dans la localité, le chef du ménage chez qui le décès a eu lieu ou chez qui a été trouvé le corps, enfin toute personne qui a assisté au décès, subsidiairement la police lorsqu’elle apprend la mort ou la découverte du corps). Si le décès a eu lieu dans un établissement hospitalier, un établissement de détention ou un établissement similaire, la déclaration incombera au directeur.
Les documents suivants devront généralement être remis :
- Le certificat médical de décès ;
- Le livret de famille, certificat de famille ou certificat de partenariat du défunt ;
- Le passeport ou carte d’identité ;
- Pour les ressortissants étrangers : le permis de séjour ou d’établissement.
Pour que les obsèques puissent avoir lieu, l’office de l’état civil délivrera la confirmation de l’annonce de décès et, à la suite de l’enregistrement de celui-ci, l’acte de décès (à ne pas confondre avec le certificat de décès).
Outre les indications relatives à la personne décédée, l’acte de décès précise où et quand la mort a eu lieu, mais il n’en indique pas les causes. Ce document est essentiel pour les démarches administratives, par exemple avec les banques, les assurances, etc.
A noter que l’office de l’état civil se charge d’informer les autres autorités, notamment la commune et l’autorité qui s’occupe des successions, à Genève la Justice de Paix.
Lorsque le défunt laisse un testament manuscrit, toute personne qui a connaissance d’un tel document à l’obligation de le remettre à l’autorité cantonale compétente dans l’état où il a été trouvé. Un testament passé en la forme authentique sera transmis par le notaire à ladite autorité.
L’autorité compétente procèdera dans le mois qui suit le décès, à l’ouverture du testament en présentiel des héritiers légaux et institués connus ainsi qu’éventuellement l’exécuteur testamentaire. Les légataires ne sont pas convoqués mais recevront par la suite une copie de la partie du testament qui les concerne. Les héritiers légaux et institués, de même que l’exécuteur, reçoivent une copie écrite du testament aux frais de la succession. La date de la communication fait foi pour faire démarrer les délais légaux notamment en matière de répudiation de la succession pour les héritiers institués et la délivrance des legs.
Un certificat d’héritier sera remis par l’autorité aux héritiers institués et légaux à leur demande (généralement dans un délai d’un mois sauf contestation de la qualité des héritiers institués et à condition que tous les héritiers soient connus et ne peuvent plus répudier). Ce document essentiel, qui mentionne tous les héritiers, leur permet de se légitimer à l’égard des tiers dans le cadre de l’administration des biens successoraux. Attention toutefois, il n’est pas une preuve absolue de la qualité d’héritier car il est délivré sous réserve de toute action en annulation, en pétition d’hérédité, réduction ou en constatation de l’inexistence ou de la nullité du testament. Au besoin, il peut être corrigé en tout temps.
A noter que s’agissant du pacte successoral, la loi n’impose pas la remise de ce document à l’autorité, ni son ouverture. Les cantons le prévoient à titre facultatif. Il en va différemment si le pacte contient des dispositions testamentaires.
Comment ma succession est-elle liquidée ?
Le droit suisse consacre le principe de l’universalité de la succession. Les héritiers acquièrent celle-ci de plein droit au décès du de cujus. En clair, cela signifie que les héritiers sont immédiatement saisis au moment de la mort des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt. Ils sont également personnellement tenus de ses dettes. Les héritiers constituent une communauté héréditaire, communément dénommée « hoirie » qui réunit tous les héritiers, légaux et/ou institués par testament.
Chaque héritier peut :
- accepter purement et simplement la succession : le silence d’un héritier équivaut à une acceptation pure et simple ;
- accepter la succession sous bénéfice d’inventaire : cette procédure permet de restreindre la responsabilité des héritiers aux dettes qui sont portées à l’inventaire. La demande doit être adressée par un héritier ayant la faculté de répudier la succession, dans le mois qui suit le décès ou dès qu’un héritier a eu connaissance de sa qualité, à l’autorité compétente. Celle-ci accomplira toutes les démarches pour établir la totalité des biens et des dettes de la personne décédée. Au besoin, elle recourra aux services d’un expert ou d’un notaire. L’autorité invitera par sommation publique les créanciers et les débiteurs du défunt à se manifester. A la clôture, l’inventaire est porté à la connaissance des héritiers qui, dans le délai d’un mois, doivent déclarer à l’autorité s’ils acceptent ou non la succession. En cas d’acceptation, ils répondent des dettes de la succession portées à l’inventaire ;
- demander la liquidation officielle de la succession : cette démarche permet de supprimer la responsabilité personnelle de vos héritiers en séparant leur patrimoine du vôtre. Vos héritiers n’ont alors plus aucun droit sur vos actifs et ne répondent plus de vos dettes. Leur participation à la succession se limite à l’éventuel solde actif existant au terme de la liquidation officielle ou de la procédure de faillite en cas d’insolvabilité. Un ou plusieurs liquidateurs seront alors nommés et chargés de la liquidation (en cas d’insolvabilité l’office des faillites sera compétente). Cette procédure n’est possible que si elle est réclamée dans un délai de trois mois après le décès ou la connaissance de la qualité d’héritier et pour autant que la succession n’ait pas été acceptée par un héritier ;
- répudier la succession : si vous ne souhaitez pas assumer les dettes du défunt ou ne pas intervenir dans la succession, vous devez répudier celle-ci dans les trois mois qui suivent le décès ou la connaissance de votre qualité d’héritier par une déclaration à l’autorité compétente. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué sur demande que s’il existe des justes motifs. La succession est censée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement reconnue au moment du décès. Une fois la succession répudiée, vous n’avez plus de prétentions sur les actifs successoraux et ne répondez plus des dettes du défunt. Attention, si vous vous immiscez dans les affaires de la succession, vous êtes déchu de votre droit de répudier. Si tous les héritiers répudient la succession, celle-ci est liquidée par l’office des faillites.
A noter encore que l’autorité peut procéder à l’administration d’office de la succession si les héritiers, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas capables d’assurer la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs, par exemple lorsque les héritiers sont inconnus ou non clairement déterminés.
Une fois la liste des héritiers définitivement arrêtée, la deuxième étape consiste dans le partage de la succession. Chaque héritier peut demander celui-ci de manière indépendante, au besoin par une action judiciaire. Au moment du partage, on déterminera la valeur des biens de la succession, on s’acquittera des dettes du défunt et on distribuera l’excédent aux héritiers. Ceux-ci peuvent convenir librement du partage entre eux mais le concours d’un exécuteur testamentaire est généralement souhaitable pour prévenir les litiges. Les héritiers peuvent même, à l’unanimité, déroger aux instructions que le défunt a laissées dans son testament. Dès que toute la succession est liquidée, le partage successoral est clôturé et l’hoirie dissoute.
Qu’en est-il de la liquidation du régime matrimonial ?
Si le défunt laisse un conjoint, le régime matrimonial doit en tout état de cause être liquidé avant le partage de la succession. De cette liquidation, il en résultera les parts du patrimoine qui reviendront au conjoint survivant et celles qui tomberont dans la masse successorale du conjoint décédé.
Ainsi, par exemple, si aucun contrat de mariage n’a été conclu entre les époux, lors de la liquidation du régime matrimonial, le conjoint survivant recevra ses biens propres et la moitié des acquêts. Cette partie de la fortune ne sera pas partagée avec les autres héritiers du défunt. En d’autres termes, elle ne rentre pas dans la masse successorale.
L’autre moitié des acquêts et les biens propres du défunt tomberont eux dans la succession. En l’absence de testament, ces biens seront répartis pour moitié entre le conjoint survivant et les descendants du de cujus selon l’ordre successoral légal.
Par quels moyens puis-je disposer des biens de ma succession ?
La liberté de disposer en droit suisse n’est pas seulement limitée sous l’angle quantitatif par les règles sur la quotité disponible et la réserve héréditaire. Elle l’est également s’agissant des instruments juridiques à votre disposition pour attribuer vos biens, et cela à un double titre : tout d’abord, sous l’angle formel, une personne ne peut organiser sa succession qu’au moyen d’un testament ou d’un pacte successoral (les formes de disposer).
En second lieu, la loi énumère un numerus clausus des modes disposer (articles 482 à 493 CC). Il s’agit pour l’essentiel des manières suivantes :
- L’institution d’héritier, soit la disposition pour cause de mort par laquelle le défunt désigne un successeur universel, qui répondra des dettes de la succession, sera membre de la communauté héréditaire et participera au partage (pour rappel on distingue les héritiers légaux (conjoint, descendants, puis les héritiers classés selon le système des parentèles) de ceux institués par testament ou pacte successoral) ;
- Le leg, par lequel le défunt attribue un avantage patrimonial par une disposition pour cause de mort qui oblige un héritier légal ou institué à faire une prestation à une ou plusieurs personnes. Le légataire, contrairement à l’héritier, est un successeur particulier qui ne répond pas des dettes de la succession et ne fait pas partie de la communauté héréditaire. En d’autres termes, il n’a qu’une créance contre la personne grevée du leg ;
- La substitution vulgaire est une disposition prise par le de cujus, qui déroge au régime légal applicable par défaut, dans l’hypothèse où la personne qui est appelée à succéder (ou le légataire) en premier lieu ne recueille pas la succession, notamment s’il répudie celle-ci ou est prédécédé.
Ainsi, par exemple, le défunt institue héritier son neveu et prévoit dans le cas où il devait prédécéder, que c’est la fondation X qui héritera à la place des enfants du neveu, et ce malgré le fait qu’ils soient les héritiers légaux de ce dernier ;
- La substitution fidéicommissaire est une disposition par laquelle le défunt institue deux successeurs successifs, le premier (le grevé) étant tenu de délivrer la succession au second (l’appelé) à l’arrivée d’un certain terme. Cette institution se distingue de la substitution vulgaire par le fait que cette dernière prévoit la désignation d’un successeur à défaut du premier appelé, et non à la suite de celui-ci ;
Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse d’une substitution fidéicommissaire, le défunt institue héritier son neveu et prévoit qu’à son décès, c’est la fondation X qui héritera des biens restants à la place des enfants du neveu, et ce malgré le fait qu’ils soient les héritiers légaux de ce dernier ;
- Les conditions et les charges : alors que les conditions soumettent les effets d’une disposition pour cause de mort à un événement futur incertain (par exemple, le défunt lègue l’usufruit de tous ses biens à sa nièce jusqu’au mariage de cette dernière), les charges imposent à un héritier ou à un légataire de faire ou de ne pas faire quelque chose, sans toutefois engendrer une créance en faveur d’un bénéficiaire (par exemple, le de cujus lègue son immeuble à la Ville de Genève, à charge pour elle d’en faire des logements pour les plus démunis) ;
- La constitution d’une fondation, par lequel le défunt décide de la création d’une fondation post mortem et de l’affectation de certains biens au jour de son décès.
Il est important de relever qu’à ce jour, le trust ne figure pas parmi les modes de disposer autorisés en droit suisse. Ainsi, il n’est pas possible de créer un trust par testament, seule une fondation peut être constituée par disposition pour cause de mort dans notre ordre juridique (dans le respect de l’article 335 CC, ce qui implique d’exclure la création de fondations de famille dites d’entretien). Il convient donc obligatoirement de mettre en place un trust avant le décès du settlor afin qu’il produise des effets du vivant du constituant (on parle alors d’inter vivos trust). Dans le cas contraire, le trust serait nul et sans effet, à moins de soumettre sa succession à un droit étranger, comme discuté précédemment. Le corollaire de cette règle est que seuls les biens figurant encore dans le patrimoine personnel du settlor feront partie de la succession et seront répartis entre ses héritiers, à l’exclusion de ceux qui auront été transférés dans le trust de son vivant (sous réserve d’une éventuelle violation des règles sur la réserve héréditaire, les biens en trust étant soumis aux dispositions sur les libéralités entre vifs et potentiellement assujettis au rapport ou à la réduction, à moins, encore une fois, d’avoir sa succession régie par un droit étranger).
La désignation d’un exécuteur testamentaire peut s’avérer judicieuse, afin de décharger vos héritiers de tâches administratives souvent lourdes, de prévenir les litiges, de garantir un règlement rapide ainsi qu’un partage juste de votre patrimoine conformément à vos volontés.
Pourquoi rédiger un testament ?
Comme il l’a été relevé ci-dessus, si vous décédez sans laisser de testament, la loi déterminera qui héritera de vos biens. Or, l’ordre successoral prévu pourrait ne pas correspondre à vos souhaits. Tel est souvent le cas en présence de familles recomposées ou de relations de concubinage. Par ailleurs, le conjoint survivant peut se retrouver dans une situation difficile si le couple était propriétaire d’un bien immobilier abritant le domicile conjugal. Il pourrait ainsi être contraint de vendre ledit bien afin de verser les parts revenant aux autres héritiers légaux.
Le testament permet ainsi d’attribuer vos biens aux personnes qui vous sont les plus chères et notamment aux couples de se favoriser mutuellement. Il est également possible de désigner des bénéficiaires qui n’hériteraient de rien d’après la loi, comme le concubin, bien entendu dans les limites de la quotité disponible.
Comme mentionné ci-dessus, avec l’entrée en vigueur du nouveau droit des successions au 1er janvier 2023, les testateurs bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre. Ils peuvent ainsi désormais favoriser davantage leur conjoint ou concubin ainsi que des tiers dans leur testament.
Que puis-je régler dans un testament ?
Un testament vous permet de régler bien plus que les seules parts de votre succession.
Hormis la limitation liée aux réserves héréditaires fixées dans la loi, vous avez toute latitude pour instituer vos héritiers ; il peut s’agir de personnes vivantes, à naître, d’institutions caritatives, de collectivités publiques, etc., à l’exclusion d’animaux pour lesquels d’autres mécanismes doivent être mis en place. Vous pouvez décider de créer votre propre fondation d’utilité publique dans votre testament.
Vous déterminez également qui reçoit quels biens matériels (maison, voiture, argent, etc.), y compris par le biais de legs. Cette démarche est recommandée puisqu’en l’absence de clause de partage, les héritiers devront se mettre eux-mêmes d’accord sur les modalités de répartition, ce qui peut prendre du temps et être source de conflits.
Il est possible dans une certaine mesure de grever vos dispositions testamentaires de charges ou de conditions.
Si vous êtes marié-e, vous pouvez accorder dans votre testament un droit d’usufruit à votre conjoint, afin de lui permettre d’utiliser un bien immobilier, des titres ou tout autre objet jusqu’à son décès par exemple. Il faut toutefois garder à l’esprit qu’un droit d’usufruit s’accompagne d’obligations comme le paiement des impôts sur le revenu et sur la fortune, les frais liés à la gestion du bien ou à l’entretien d’une maison, etc.
Un exécuteur testamentaire peut-être institué dans le testament afin qu’il soit chargé du règlement de la succession.
Vous pouvez aussi définir outre les personnes qui héritent directement de vos biens, ceux qui en hériteront au décès ou en cas de prédécès de ses derniers, par le biais de substitutions vulgaires et fidéicommissaires. Cette dernière solution peut-être très intéressante pour les familles recomposées, par exemple si le conjoint se remarie et a des enfants. La substitution fidéicommissaire permet ainsi d’éviter qu’après le décès de l’époux survivant, la totalité du patrimoine ne soit transmise à la famille de son nouveau conjoint.
Enfin, vous pouvez par testament déshériter une personne (on parle d’exhérédation), c’est-à-dire lui retirer sa réserve héréditaire. Cela n’est toutefois possible que sous certaines conditions prévues par la loi, par exemple, en cas d’infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches ou lorsque l’héritier a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.
Quelles sont les conditions formelles pour établir un testament en droit suisse ?
Les modalités pour conclure un testament sont impérativement et exhaustivement définies dans la loi, sous peine que les dispositions pour cause de mort soient annulables, voire même nulles en certaines circonstances.
Afin d’établir un testament, vous devez avoir au moins 18 ans et être capable de discernement. La capacité de discernement, présumée, est admise lorsque la personne a la faculté d’agir raisonnablement, c’est-à-dire qu’elle a pu se rendre compte de la portée des dispositions précises qu’elle a prises dans son testament et cela au moment où elle les a écrites. Contrairement au pacte successoral, il n’est pas nécessaire d’avoir l’exercice des droits civils pour valablement disposer par testament. Ainsi, une personne capable de discernement sous curatelle de portée générale a la capacité de tester sans le consentement de son représentant légal.
S’agissant de la forme, on distingue le testament olographe du testament public, auxquels s’ajoutent une troisième forme, le testament oral, utilisable dans des cas exceptionnels si le testateur ou la testatrice n’est pas en mesure d’établir un testament, par exemple en cas de danger de mort dû à une maladie, un accident ou une guerre. Pour ce faire, les dernières volontés devront être recueillies par deux témoins indépendants qui soumettront immédiatement le testament au tribunal le plus proche. Le testament oral perd sa validité quatorze jours après que le de cujus a recouvré la possibilité de tester d’une autre manière.
S’agissant du testament olographe, qui représente environ 90% des testaments, il doit entièrement être rédigé, daté et signé de votre main. Le support utilisé importe peu (du papier, du bois, la toile d’un tableau, etc.) mais un testament écrit à l’ordinateur ou à la machine à écrire n’est pas valable, même s’il comporte une signature manuscrite. L’avantage du testament olographe est qu’il peut être modifié en tout temps et sans frais. L’inconvénient est que selon les expressions utilisées par le défunt, des ambiguïtés et des contradictions peuvent surgir, voire même des erreurs en violation du droit successoral suisse, d’où la recommandation de recourir à des spécialistes comme Onyx Trust. En outre, le risque d’une destruction ou d’une perte est plus grand, raison pour laquelle il est souhaitable de déposer son testament auprès d’un avocat, d’une personne de confiance ou du Registre Suisse des Testaments administré par la Fédération Suisse des Notaires (FSN). En tous les cas, la loi n’exige pas que le testament soit déposé auprès d’une autorité publique, bien que cela soit possible (à Genève, le Juge de Paix). Enfin, par un testament olographe, le de cujus est plus susceptible de faire l’objet de pressions de la part de son entourage que pour un testament public.
Le testament public est lui justement passé devant un officier public, généralement un notaire, en présence de deux témoins. La confection d’un testament public s’articule en cinq phases : Tout d’abord, le de cujus indique ses volontés au notaire (la communication de la volonté) ; celui-ci transcrit ou fait retranscrire ces volontés dans un acte (la rédaction de l’acte qui peut être faite à l’ordinateur) ; le testateur s’assure que l’écrit établi par le notaire correspond à sa volonté et le déclare (vérification) soit en lisant lui-même l’acte et en signant le testament (forme principale), soit s’abstenant de ces démarches, l’officier public lui en donnant lecture en présence des deux témoins et le testateur déclarant ensuite que l’acte contient ses dernières volontés (forme secondaire) ; le notaire date et signe l’acte, lui donnant son caractère authentique ; les deux témoins confirment enfin que le testateur a procédé à la vérification du contenu de l’acte et certifient que le testateur est paru capable de disposer (attestation des témoins).
A noter que le notaire et les témoins, de même que leurs proches (descendants, conjoints, etc.), ne peuvent recevoir de libéralités du testament mais le notaire peut être désigné exécuteur testamentaire. Cette procédure, certes très formelle, coûteuse et moins propice aux modifications, permet toutefois de limiter dans une certaine mesure les influences que pourraient avoir les proches du de cujus et surtout de s’assurer que les intentions de ce dernier ont bien été retranscrites, en évitant dans une certaine mesure des problèmes ultérieurs d’interprétation. Elle permet également d’attester de la capacité de discernement du testateur au moment de la rédaction du document. L’original du testament est généralement conservé par le notaire en vertu du droit cantonal. Celui-ci peut également demander le dépôt de l’acte à une autorité. Le fait qu’un testament authentique ait été établi peut être enregistré au Registre Suisse des Testaments administré par la Fédération Suisse des Notaires (FSN), à Berne. Celui-ci ne contient toutefois aucune indication quant au contenu du testament et son accès est restreint.
A noter encore qu’un testament n’est toujours valable que pour une seule personne. Le droit suisse ne prévoit aucun testament commun. Même au sein d’un mariage ou d’un partenariat enregistré, chaque personne doit ainsi rédiger son propre testament.
Enfin, il convient de prêter attention aux conséquences afférentes à la rédaction de plusieurs testaments successifs qui pourraient se contredire dans leurs termes les uns les autres. S’il est souhaitable de revoir régulièrement son testament (généralement tous les 5 ans), il sied de bien révoquer une ancienne version en le mentionnant expressément dans le nouveau testament, ou même mieux en détruisant l’ancien document.
Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit en 2023, nous recommandons de revoir le texte de votre testament et vos volontés par un expert. En effet, de nouvelles possibilités s’offrent à vous comme par exemple, outre une plus grande quotité disponible, la possibilité d’exclure votre conjoint de la succession dès l’introduction d’une demande en divorce et non plus lors de l’entrée en force du jugement.
De nombreux modèles de testament sont disponibles sur Internet. Il est toutefois déconseillé d’avoir recours à de tels documents. Chaque situation personnelle et patrimoniale est unique, seuls les conseils d’un expert garantiront que vos volontés sont correctement respectées.
Quel est l’intérêt de recourir aux services d’un exécuteur testamentaire ?
Le choc du décès étant encore bien présent, voilà que les héritiers sont déjà confrontés à de multiples démarches désagréables. Or, nombreux sont ceux qui sont dépassés par le partage d’un héritage, même si le défunt a réglé sa succession avec un testament. En cas de désaccord ou de conflit entre les héritiers, il faudra parfois des années pour que la succession soit enfin liquidée. En effet, dans la mesure où l’hoirie doit prendre ses décisions à l’unanimité, un seul héritier, même minoritaire dans la succession peut ainsi bloquer celle-ci des années durant. De tels problèmes peuvent être palliés en ayant recours à un exécuteur testamentaire indiqué dans le testament ou le pacte successoral.
L’exécuteur testamentaire a justement pour rôle de représenter la volonté du testateur dans le cadre de la succession et de gérer celle-ci jusqu’à son partage. Il s’occupe de préparer l’inventaire des biens, de procéder à la liquidation du régime matrimonial si cela est nécessaire, de régler les factures, de payer les impôts, de verser les legs, de préparer le partage successoral et de s’efforcer de trouver des compromis en cas de divergences entre les héritiers. Il prend en outre toutes les mesures nécessaires pour protéger les actifs successoraux dans l’intervalle (administration des biens immobiliers, vente des titres en cas de chute sur les marchés financiers, etc.).
L’intervention d’un exécuteur testamentaire est ainsi en particulier indiquée dans des situations où il y a un nombre important d’héritiers, une inexpérience de leur part, ou un risque de conflit latent entre eux, des biens immobiliers, des actifs situés à l’étranger, des questions juridiques complexes à régler, ou tout autre risque de retard dans la liquidation de la succession.
Au vu de ses responsabilités et de ses pouvoirs, un exécuteur testamentaire doit être choisi avec soin, compte tenu notamment de ses compétences et de son expertise. Il doit également idéalement être accepté par les héritiers tout en conservant son indépendance. Il n’est généralement pas recommandé de choisir comme exécuteur testamentaire un héritier, même expérimenté, au vu des risques de conflits d’intérêts mais plutôt un expert neutre qui saura éviter les longues et coûteuses procédures judiciaires. Le coût investi en vaut la peine ! En outre, il est judicieux de désigner un exécuteur testamentaire suppléant, au cas où la personne souhaitée n’accepterait pas le mandat, décèderait avant son terme, ou renoncerait à cette fonction.
Après l’ouverture du testament par l’autorité compétente, il est demandé à la personne désignée comme exécuteur testamentaire dans un testament ou un pacte successoral d’accepter ou de renoncer à son mandat. Si elle l’accepte, elle recevra une attestation qui l’autorisera à représenter la communauté héréditaire.
Les collaborateurs d’Onyx Trust, tous avocats inscrits au Barreau suisse, fonctionnent régulièrement comme exécuteurs testamentaires de successions nationales ou internationales.
Qu’est-ce qu’un pacte successoral ?
Le pacte successoral est, après le testament, la deuxième forme de disposition pour cause de mort, qui est toutefois bien moins courante et généralement réservée aux situations successorales complexes. Offrant certes une grande sécurité juridique, mais compte tenu de son caractère contraignant et onéreux pour les parties, il devrait être réservé aux situations lorsque le but recherché ne peut pas être atteint par un testament.
Un pacte successoral est un contrat pour cause de mort conclu entre le de cujus (appelé le disposant) et un ou plusieurs tiers (le(s) cocontractant(s)) relatif à la succession du premier. Il présente ainsi deux caractéristiques, à savoir de lier le disposant (contrairement au testament) et de régler sa succession. Il est donc un acte juridique bilatéral ou multilatéral entre vifs qui produit des effets au moment du décès, en sachant que le disposant au moins doit prendre un engagement ferme. Si le cocontractant ne fait qu’accepter la prestation, on parle de pacte successoral unilatéral. Les deux parties peuvent également être disposantes et se favoriser mutuellement ou favoriser des tiers. En ce cas, on est en présence d’un pacte successoral bilatéral, fréquent entre époux ou partenaires.
On distingue deux types de pactes successoraux : le pacte d’attribution et celui de renonciation. Dans le premier cas, le de cujus prend des dispositions pour cause de mort, qui le lient, en faveur du cocontractant ou d’un tiers, par exemple en instituant des héritiers qui n’ont pas cette qualité de par la loi ou en désignant des légataires.
Dans le cadre d’un pacte de renonciation, un héritier présomptif renonce à ses futurs droits dans la succession, généralement un héritier réservataire et souvent moyennant une contre-prestation (on parle alors de pacte onéreux). Un exemple classique de pacte de renonciation se présente lorsque les enfants communs d’un couple marié renoncent à la succession du parent qui décèdera en premier en échange d’une institution d’héritier par lequel le conjoint survivant institue les enfants comme héritiers de l’ensemble de ses biens.
Il ressort de ce qui précède que le pacte successoral présente les avantages suivants : par un pacte de renonciation, le de cujus peut venir en aide à un héritier au-delà de sa quotité disponible et prévenir par la même occasion tout litige qui pourrait naître après son décès avec l’héritier réservataire renonçant. Grâce au pacte d’attribution, le de cujus peut, moyennant généralement une contre-prestation de la personne favorisée, régler d’entente entre les héritiers et lui, des situations qui engendreraient des conflits une fois le décès intervenu (ce qu’un testament ne pourrait pas ou difficilement adresser).
De quoi faut-il tenir compte lors de la conclusion d’un pacte successoral et quelles sont les différences par rapport à un testament ?
Le pacte successoral constitue le seul instrument juridique de l’ordre juridique suisse permettant de valablement éluder les règles sur la réserve héréditaire, ce qu’un testament n’autorise pas. En effet, par un pacte de renonciation, votre héritier réservataire renonce totalement (ou partiellement) et définitivement à ses expectatives successorales (généralement moyennant une contre-prestation).
Par ailleurs, en concluant un pacte d’attribution vous disposez de vos biens pour cause de mort d’une manière contraignante. Ainsi, à la différence d’un testament, il n’est pas possible de révoquer cet acte unilatéralement. En d’autres termes, un retour en arrière n’est pas possible sans le consentement du cocontractant (sauf dans des cas exceptionnels si celui-ci donne au disposant une raison de le déshériter ou si l’un des deux ne respecte pas ses accords contractuels). Il s’agit là d’un point essentiel et la conclusion d’un pacte successoral doit ainsi être mûrement réfléchie par le de cujus, pouvant notamment créer des difficultés si la situation personnelle ou financière des contractants évolue.
En revanche par rapport à un testament, il est possible de prévoir des règles beaucoup plus étendues. Le contenu du pacte successoral ne doit toutefois pas être contraire aux mœurs, impossible ou arbitraire.
En outre, bien que vous continuiez à disposer de vos biens à votre guise même après la signature d’un pacte successoral, depuis le 1er janvier 2023 et l’entrée en vigueur du nouveau droit des successions, les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage peuvent être attaquées par le cocontractant si elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral et n’ont pas été réservées dans ce document (par le biais de l’action en réduction applicable par analogie). De son côté, le cocontractant reste lui libre de répudier la succession ou de renoncer à l’avantage que lui confère le pacte.
Comment conclure un pacte successoral ?
Contrairement au testament, le pacte successoral ne peut être conclu qu’en la forme authentique, à savoir par devant notaire en présence de deux témoins, selon la même procédure que pour le testament public. Tant la forme principale que secondaire sont admises (voir ci-dessus).
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus peut disposer pour cause de mort par pacte successoral. A la différence du testament, les personnes sous curatelle doivent obtenir le consentement de leur curateur. S’agissant du cocontractant qui ne dispose pas pour cause de mort, les règles ordinaires sur la capacité civile s’appliquent (ainsi un mineur capable de discernement peut conclure un pacte successoral sans le concours de son représentant légal si le pacte est conclu à titre gratuit). Pour le reste, les dispositions en matière contractuelle s’appliquent.
Un pacte successoral peut être conclu non seulement entre deux, mais également un nombre supérieur de parties. Il peut contenir des charges ou des conditions et plus généralement peut porter sur toute disposition pour cause de mort qui n’est pas par nature unilatérale, comme la nomination d’un exécuteur testamentaire ou une exhérédation par exemple. Si le pacte contient de telles clauses, il doit clairement indiquer que celles-ci peuvent être révoquées au gré du disposant.
Les parties contractantes peuvent déposer le pacte successoral au domicile du disposant, à la banque, chez un notaire ou un avocat, ou dans tout autre lieu de leur choix. Contrairement au testament public, il n’y pas d’obligation de dépôt officiel des pactes successoraux. Le notaire doit toutefois éventuellement conserver l’original de l’acte conformément aux dispositions du droit cantonal. Les pactes successoraux peuvent également être enregistrés au Registre Suisse des Testaments administré par la Fédération Suisse des Notaires (FSN), à Berne, de manière à être retrouvés plus facilement. Le Registre ignore cependant toujours le contenu des dispositions enregistrées.
Lorsque les parties du contrat s’accordent pour mettre fin au pacte successoral, il n’est pas nécessaire de faire appel à un notaire pour cette procédure. Il suffit que les parties consignent leur décision par écrit et la signent. En revanche, si les parties souhaitent modifier le pacte successoral, les mêmes conditions de forme que pour sa constitution s’appliquent. Les clauses testamentaires figurant dans le pacte successoral (par exemple l’exhérédation ou la nomination de l’exécuteur testamentaire) sont révocables par le seul testateur.